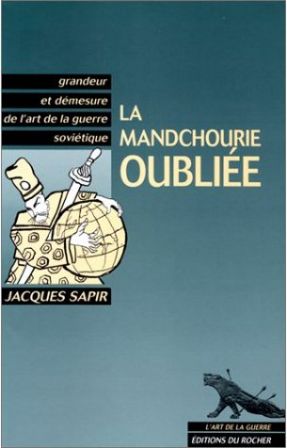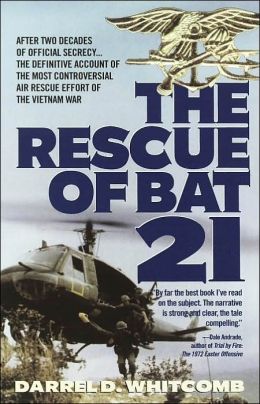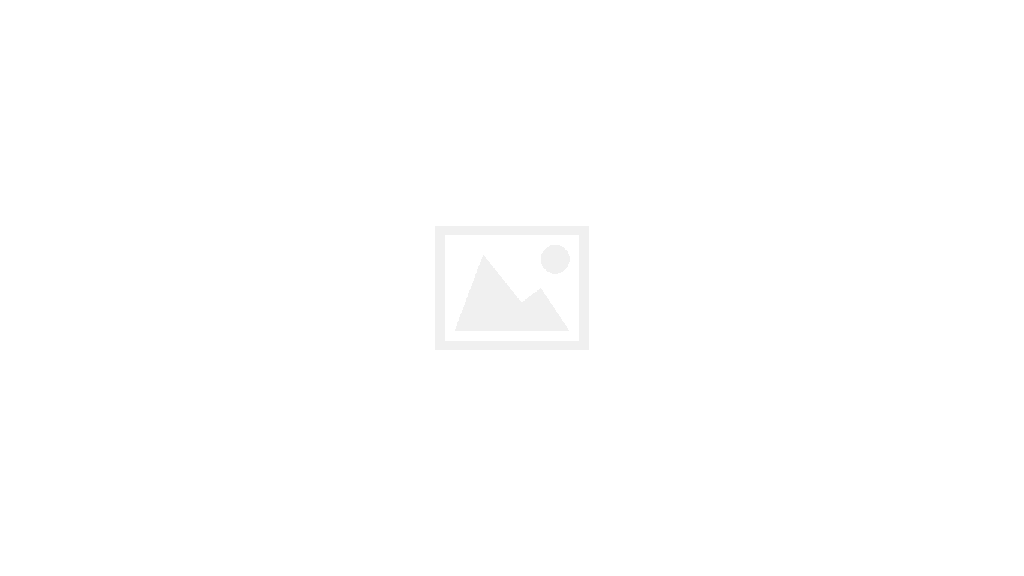Cet ouvrage collectif paru en 2003 rassemble un panel d'officiers américains (14) autour de l'étude d'exemples remarquables du combat urbain sur une période comprise entre 1938 et 1968. Le but est de présenter des cas précis de combats urbains et d'en tirer les leçons. Cela dans la perspective de guerres menées, de plus en plus, à l'intérieur des villes. Les deux auteurs qui ont assuré la direction de l'ouvrage rappellent d'ailleurs dans la préface que pendant la guerre froide, l'US Army avait prévu de mener nombre de combats urbains en cas d'invasion soviétique de la RFA. Et pourtant, la doctrine militaire américaine de cette époque peine à reconnaître le caractère parfois inévitable de tels affrontements, conseillant de l'éviter. Evidemment, la parution de cet ouvrage est liée aux attentats du 11 septembre 2001 et à la "guerre contre le terrorisme" menée par les Etats-Unis qui voient un renouveau des affrontements en ville. Le livre est d'ailleurs contemporain de l'invasion de l'Irak en 2003... le propos est donc américanocentré, et pas forcément dans le bon sens du terme.
Comme souvent dans les ouvrages collectifs, les chapitres sont de qualité inégale. Le premier article consacré à la bataille de Tai-erh-Chuang, en Chine, en 1938, qui voit la défaite d'un corps japonais devant les nationalistes et qui met en lumière les failles de l'armée impériale, est desservi par l'absence de cartes. C'est dommage car le propos montre bien que les nationalistes chinois ont su faire preuve d'ingéniosité et de bravoure contrairement à une image trop répandue.
L'article sur Stalingrad est très intéressant. L'auteur ne privilégie pas la dimension tactique uniquement et le côté allemand mais interroge aussi la performance soviétique et sa dimension opérative. La 62ème armée de Tchouïkov a parfaitement rempli le rôle qui était le sien en attirant les Allemands dans le combat de rues et en résistant jusqu'à la limite de céder, mais sans jamais rompre. Les Allemands ont sous-estimé la détermination de leur adversaire et n'ont pas compris que le facteur essentiel était le temps, non l'espace. Les Soviétiques ont mis en oeuvre des tactiques hors-normes par rapport à la guerre conventionnelle qu'ils pratiquaient. L'auteur montre le processus en trois phases : l'Armée Rouge fait preuve de sa détermination (exemple de la bataille du silo à grains), change ses tactiques pour passer à ce que les Allemands ont appelé la "Rattenkrieg", et gagne du temps en vue de la contre-offensive (combat dans l'usine Barricade). Trop confiante, la Wehrmacht n'a pas su comprendre qu'elle n'avait ni le temps ni les moyens de s'engluer dans la bataille urbaine de Stalingrad, et elle a failli. Malheureusement pas de cartes, là encore, même si la topographie de Stalingrad est plus familière, en général, pour le lecteur déjà intéressé. C'est tout de même l'article le plus percutant de l'ensemble, sans doute, sur un sujet pourtant éculé.
L'article sur le soulèvement de Varsovie en août 1944 est mis en avant par l'auteur comme un exemple précoce d'affrontement entre une insurrection et une armée conventionnelle. La durée des combats malgré l'ampleur de la répression allemande s'explique selon lui par le moral très élevé des Polonais, la création d'une structure clandestine éprouvée et à l'incapacité initiale des Allemands à faire face au combat urbain, malgré l'expérience l'année précédente du ghetto de Varsovie. C'est ainsi que la Wehrmacht ne pense pas au départ que les insurgés puissent utiliser le réseau des égoûts. Elle y laisse au total quelques 20 000 hommes.
L'article sur la bataille d'Arnhem est sans doute l'un des plus originaux de l'ensemble, en insistant sur la problématique du combat de rues mené par les forces aéroportées. Il met en lumière l'inadéquation entre ce type de combats et les carences en moyens blindés, en renseignement, en reconnaissance et en rapidité d'exécution rencontrées par les Britanniques. Le commandement et les communications sont également fondamentales, or ici ces deux aspects ont fait défaut, tout comme le ravitaillement et la présence d'armes antichars en nombre.
L'article suivant porte sur la bataille de Troyes, en 1944, un épisode méconnu de la poursuite en France à l'été 1944 et qui implique la 4th US Armored Division,qui cherche à s'emparer des ponts sur la Seine. En fait, l'essentiel des combats a lieu à l'extérieur de la ville, les Allemands n'ayant pas suffisamment organisé la défense à l'intérieur. En conséquence, les atouts américains jouent à plein.
L'article sur la bataille de Budapest (1944-1945) est assez bon et parvient aussi à faire la part des choses entre Allemands et Soviétiques. A la fin, on trouve une conclusion qui fait un parallèle intéressant avec le soulèvement de 1956, dans lequel prennent part d'ailleurs des vétérans du siège de la Seconde Guerre mondiale des deux côtés.
J'ai déjà utilisé l'article sur la bataille d'Aschaffenbourg dans un billet précédent, pour le supplément de mon propre écrit paru dans Batailles et Blindés n°53, je n'y reviens pas. En revanche il me semble que l'auteur surestime quelque peu la performance des Américains et sous-estime au contraire le caractère acharné de la résistance allemande.
L'article sur la bataille de Manille (1945) est manifestement trop court et dépourvu de cartes utiles. Il met en revanche l'accent sur le rôle central de l'infanterie, la combinaison des armes également employée par les Américains dans le Pacifique et l'importance du soutien de feu.
De la même façon, l'article sur la bataille de Berlin (1945) laisse un goût d'inachevé, bien qu'il soit plus conséquent. On aurait souhaité davantage de considérations sur les tactiques utilisées, en particulier du côté soviétique, et moins le récit de la bataille elle-même.
La période post-Seconde Guerre mondiale commence par un article sur la bataille de Jaffa (1948) conduite par l'Irgoun contre les Arabes et l'armée britannique. Ou comment une force inférieure en nombre et en matériel domine le combat urbain grâce à la combinaison des armes, l'innovation tactique, le commandement fractionné en très petites unités, le tout conduit par un acteur non-étatique.
L'article sur la bataille de Séoul (1950) est intéressant en ce sens qu'il évoque un affrontement complètement passé à la trappe au profit du débarquement à Inchon et de la poursuite menée en Corée du Nord. Elle met pourtant en exergue de nombreuses leçons toujours valables dans les conflits contemporains.
L'étude sur la bataille de Hué (1968) est équilibrée entre récit et analyse, mais se focalise uniquement sur les Américains et négligent grandement les Sud-Viêtnamiens, vus de manière presque caricaturale, tandis que la deuxième partie n'inclue pas les Nord-Viêtnamiens et le Viêtcong. En revanche l'auteur souligne les problèmes liés au commandement, au renseignement, à la manoeuvre, à l'utilisation des feux et à la logistique, notamment, qu'ont rencontré les Américains.
Le dernier article très court sur l'emploi de chars M48A3 Patton des Marines à Da Nang-Hoi An pendant l'offensive du Têt aurait mérité d'être regroupé avec celui sur Hué, car il n'apporte pas grand chose en soi.
L'article de synthèse consacré à l'évolution de la doctrine du combat urbain dans l'armée américaine montre bien que le changement décisif a lieu en 1944 : c'est seulement à partir de cette année-là que les manuels de campagne commencent à donner des conseils sur ce type de combat, notamment pour l'utilisation des blindés et des appuis. La doctrine est certes révisée après la bataille de Séoul, en 1952, mais ne change pas fondamentalement jusqu'au Têt, dont les leçons sont intégrées dans un manuel de 1970, puis en 1976, en lien avec la nouvelle stratégie dite Active Defense en Europe.
La conclusion tente de tirer des leçons générales de tous les exemples évoqués : combat facilité par la familiarité avec les villes, importance des chars et armes antichars portables, utilisation des armes antiaériennes en combat urbain, appui-feu de l'artillerie et de l'aviation, manoeuvre en trois dimensions, nécessité de pousser la combinaison des armes au plus petit échelon possible (section voir escouade), importance de la logistique et du commandement. Mais au final, les combats urbains ne se ressemblent pas vraiment, chacun gardant ses caractéristiques propres.
Un ouvrage inégal, au final,desservi par le manque de cartes et d'illustrations (les bibliographies sont données dans les note à la fin de chaque article), où l'on prendra le meilleur pour négliger le reste.