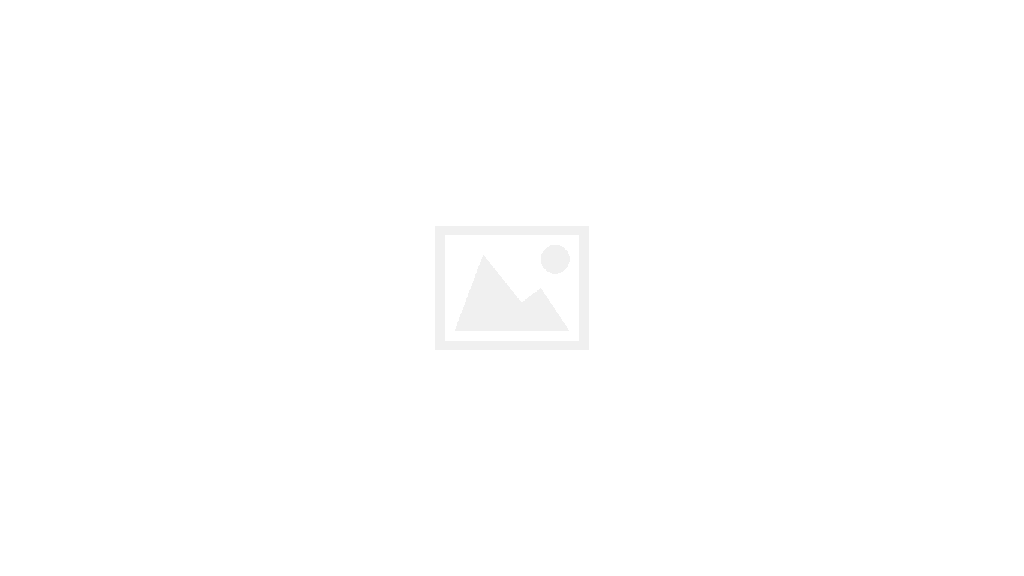Orléans
a connu plusieurs sièges ou batailles importantes durant l'histoire
de France. On pense bien sûr à celui mis par Attila devant la ville
en 451 pendant sa campagne en Gaule.
Le siège de 1428-1429, lui, est passé à la postérité grâce à
l'intervention de Jeanne d'Arc. La ville est d'ailleurs, dès
l'époque, l'épicentre du culte de la Pucelle, bien que celle-ci n'y
soit en définitive pas restée très longtemps. Le siège lui-même
est souvent éclipsé par la présence de Jeanne, que d'aucuns voient
comme celle qui a sauvé le royaume de France d'une chute prochaine
aux mains des Anglais. S'il est vrai que l'apparition de Jeanne d'Arc
a galvanisé les énergies et a été savamment orchestrée par le
roi et son entourage, sur le plan militaire, le siège d'Orléans est
intéressant à étudier car il recèle plusieurs caractéristiques
importantes de l'art de la guerre à la fin du Moyen Age, alors en
pleine transition. Retour sur un siège pas comme les autres.
La
« maudite guerre »
« La
pitié qui était au royaume de France » : c'est ce
que répond Jeanne d'Arc à ses juges, à Rouen, le 15 mars 1431,
quand ils lui demandent ce qui lui enseignait l'archange saint
Michel. Il faut dire que le royaume de France est alors victime,
comme l'Angleterre d'ailleurs, d'une dépression démographique, due
non pas à une dénatalité mais à une surmortalité provoquée par
les retours réguliers de l'épidémie de peste, apparue en
1347-1349. Une certaine paupérisation de la population se fait jour,
mais ne concerne pas tout le monde : les princes, de grands
seigneurs, vivent bien, non pas par leurs revenus propres mais par la
confiscation d'une fiscalité d'ordinaire réservée au souverain.
Le
royaume de France est alors, c'est une banalité de le dire, un monde
chrétien, où l'encadrement des populations par l'Eglise est étroit.
Cependant, l'Eglise est déchirée, entre 1378 et 1418, par le
schisme pontifical entre Rome et Avignon. L'élection de Martin V ne
met pas fin immédiatement au schisme puisque le pape doit affronter
un concile qui entend bien commencer une « réformation »
qu'il estime nécessaire. Si l'on se trouve aussi dans une société
d'ordres, c'est un monde relativement ouvert, comme le montre le
parcours de Jeanne d'Arc.
La
guerre de Cent Ans, ainsi qu'on l'a baptisée au XIXème siècle,
prend un nouveau cours à la fin du XIVème siècle. Après la phase
de reconquête initiée par le roi français Charles V, mort en 1380,
aucun traité ne vient changer la situation sous Charles VI, bien que
des tentatives de rapprochement soient engagées avec le roi anglais
Richard II. Mais, en 1392, Charles VI connaît sa première crise de
démence. Le dauphin Louis, né ensuite en 1397, est trop jeune pour
régner. Tout l'édifice monarchique français, monocratique, est
ébranlé. De l'autre côté de la Manche, Richard II est renversé
(1399) puis exécuté par Henri IV, petit-fils d'Edouard III, qui
cherche d'abord à assurer son pouvoir en Angleterre mais qui n'est
ni pacifiste, ni francophile.
En
France, le contrôle du pouvoir chancelant oppose deux oncles et le
frère du roi : Jean, duc de Berry, Philippe le Hardi, duc de
Bourgogne et Louis, duc d'Orléans. C'est surtout l'affrontement
Orléans-Bourgogne qui est d'importance. A la mort du Hardi en 1404,
son fils, le nouveau duc Jean Sans Peur, sentant la fragilité de sa
position par rapport au frère du roi, n'hésite pas à faire
assassiner Louis d'Orléans en plein Paris dans la nuit du 22 au 23
novembre 1407. Pour beaucoup de contemporains, c'est le début d'un
cataclysme politique et militaire. De fait, le meurtre ouvre une
véritable guerre civile entre Armagnacs (du nom du comte d'Armagnac,
soutien des Orléans) et Bourguignons. Jean Sans Peur, vainqueur de
ses sujets liégeois révoltés à Othée en 1408, justifie son acte
par un éloge du tyrannicide. Dès 1411, dans sa lutte contre les
Armagnacs, il fait appel à un contingent anglais. Les Armagnacs
l'imitent dès l'année suivante.
Jean
Sans Peur ne peut faire cependant adopter son ordonnance de
réformation (dans le sens de retour à la tradition) du royaume en
1413. La même année monte sur le trône anglais Henri V, fils
d'Henri IV, qui entend bien récupérer son dû en France. Dès 1415,
il débarque en Normandie, s'empare non sans mal de Harfleur puis
cherche à gagner Calais en évitant l'armée française. Intercepté
à Azincourt, Henri défait l'armée royale dans un des plus grands
désastres, pour la France, de la guerre de Cent Ans. La conquête ne
commence cependant qu'en 1417 par la Normandie, soumise après la
chute de Rouen en 1419. Pendant ce temps, le duc de Bourgogne a
installé un gouvernement parallèle à Troyes avec la reine
française Isabeau de Bavière, et entre dans Paris en mai 1418. Les
Armagnacs réussissent à faire sortir le dauphin Charles de la
capitale ; devant la menace anglaise, le duc de Bourgogne accepte de
rencontrer le dauphin à Montereau, le 10 septembre 1419. Son
assassinat en forme de vengeance pour le meurtre du duc d'Orléans,
entrepris à l'instigation d'anciens proches de ce dernier, jette son
héritier Philippe le Bon dans les mains des Anglais.
Henri
V fait signer au roi Charles VI défaillant le traité de Troyes, en
1420, qui déshérite le dauphin Charles et fait de lui le souverain
de France et d'Angleterre. Mais il faut l'appui des Bourguignons,
réticents, et surtout écraser le dauphin qui n'a pas baissé les
armes. Même s'il s'est brouillé avec un allié potentiel, le duc de
Bretagne Jean V, Charles reprend le contrôle de la partie sud du
royaume, tient des places dans le Bassin Parisien, remporte avec
l'aide de renforts écossais des victoires notables contre les
Anglais comme celle de Baugé (1421), où périt le propre frère
d'Henri V, le duc de Clarence. La situation change brusquement avec
le décès imprévu d'Henri V (31 août 1422) suivi dans la tombe,
quelques mois plus tard, de Charles VI (21 octobre). Si le dauphin
Charles devient Charles VII, il n'a pas été sacré et ses finances
sont au plus mal, même s'il dispose de troupes expérimentées.
L'année 1423 est équilibrée : succès anglais à Cravant,
victoire française à La Gravelle.
En
1424, Charles VII a rétabli son contrôle sur les finances et a reçu
des renforts militaires : 2000 chevaliers et écuyers, 6000 bons
archers et 2000 porteurs de haches des Highlands, des Ecossais
commandés par le comte de Douglas et celui de Buchan. Teodoro di
Valperga amène de Lombardie 600 lances et 1000 fantassins. Une
taille d'un million de livres tournois doit servir à financer la
reconquête de la Normandie, province riche et l'une des clés du
royaume. Mais l'offensive française vient mourir à la bataille de
Verneuil, le 17 août 1424, une des plus féroces batailles de la
guerre de Cent Ans selon les chroniqueurs du temps, dont certains
disent qu'elle fut encore plus acharnée qu'Azincourt. Bedford, frère
d'Henri V devenu régent de France pour son jeune neveu Henri VI,
doit lui-même se dégager à coups de hache. Si les pertes sont
lourdes côté français, elles ne le sont pas moins du côté
anglais. Charles VII n'a cependant plus d'armée ou presque après
Verneuil.
Yolande
d'Aragon, la belle-mère de Charles VII, s'assure alors le soutien du
frère du duc Jean V de Bretagne, Arthur de Richemont, qui est
intrônisé connétable de France (mars 1425). C'est aussi un geste
pour tenter une négociation avec les Bourguignons tout en écartant
les anciens proches du duc d'Orléans, les Armagnacs qui sont
insupportables au duc Philippe le Bon. Arthur de Richemont ne
remporte pas malheureusement de succès militaire et n'hésite pas à
faire assassiner les conseillers du roi qu'il juge trop gênants,
comme Pierre de Giac. En juin 1427, Charles VII le remplace par
Georges de la Trémoille, lui aussi ancien proche des Bourguignons.
Cette année-là, La Hire et Dunois, Bâtard d'Orléans, deux grands
capitaines de Charles VII, chasse les troupes anglaises qui
assiégeaient Montargis et Louis d'Estouteville met en déroute une
armée anglaise de 2000 hommes sous les murs du Mont-Saint-Michel.
Mais aucun de ces succès n'est décisif. Une guerre civile larvée
continue avec Arthur de Richemont et le régent Bedford s'attaque aux
possessions de Yolande d'Aragon en Anjou. En juin 1428, Salisbury,
frère de Bedford, débarque en France avec une nouvelle armée levée
en Angleterre, tandis que les états du sud du royaume pressent
Charles VII de négocier, ce que celui-ci veut éviter à tout prix.
L'intervention de Jeanne d'Arc va rallumer, plutôt que susciter, une
ferveur dynastique qui commençait à s'éteindre, et transcender les
intrigues qui déchirent la cour de Charles VII.
![]()
Jeanne
d'Arc devient la Pucelle
Jeanne
d'Arc est née dans ce que l'on appelle le « Barrois
mouvant », la partie du duché de Bar rattachée
féodalement au royaume de France, à la lisière du Saint-Empire.
Les seigneurs de Domrémy sont plutôt, cependant, dans l'orbite du
duc de Lorraine. Le village est à l'écard de la grande route entre
Boulogne et Strasbourg, qui passe par Toul et Grand. Charles II de
Lorraine a été proche des Bourguignons mais se tient dans une
prudente réserve dans les années 1420 : la ville de
Neufchâteau, non loin de Domrémy, sert de refuge à tous ceux qui
sont hostiles au traité de Troyes. Le duc de Bar étant mort à
Azincourt, des prétendants tenant du roi Charles VII et des
Bourguignons s'affrontent pour le titre. Une bataille a lieu ainsi à
Maxey, en 1419, le village voisin de Domrémy. Les Anglais occupent
Guise en 1424 pour menacer Vaucouleurs, la seule place qui dépend
directement, dans la région, de Charles VII, dirigée par son
capitaine Robert de Baudricourt. La guerre est donc bien présente
dans l'enfance de Jeanne : en 1428, Domrémy est brûlée et
ravagée.
Jeanne,
probablement née en 1412, porte le nom de son père, et non celui de
sa mère comme c'est la coutume traditionnellement. Ce n'est pas une
bergère, élément qui a été rajouté par la suite : elle
reste à la maison où elle file la laine, et peut aller aux champs,
comme toutes les jeunes filles de l'époque, mais c'est surtout la
fille d'un notable. Jacques d'Arc est le doyen du village, cité dans
les documents après l'échevin et le maire. Jeune paysanne plutôt
aisée, Jeanne a un destin tout tracé : d'ailleurs son père la
fiance sans lui demander son avis avec un homme de la région...
alors qu'elle se fait remarquer par sa piété. Dès l'été 1424,
elle entend les premières voix dans le jardin de son père. Les
apparitions, régulières, se font plus pressantes à partir de
l'arrivée en France de l'armée de Salisbury, à l'été 1428. Elle
dit plus tard être visitée par saint Michel, puis par les saintes
Catherine et Marguerite. Les habitants de Domrémy ont d'ailleurs
probablement eu vent de ces apparitions avant son départ.
Les
Anglais devant Orléans
On
connaît assez bien les événements liés au siège d'Orléans, qui
démarre en septembre 1428, notamment grâce au Journal du siège
d'Orléans, notes prises dans les années 1460 par un témoin
oculaire, complété par d'autres sources. Les Anglais et les
Bourguignons sont plutôt avares de commentaires, surtout les
premiers. Autres sources d'importance : les documents comptables
des armées, qui ont été en partie conservés dans les deux camps
et qui apportent de précieuses informations.
Thomas
de Salisbury débarque en France en juin 1428. Avec lui, 450 hommes
d'armes, 2250 archers. C'est l'un des chefs de guerre les plus
expérimentés du côté anglais : il a été à Azincourt, à
Verneuil, il a participé à la conquête de la Normandie. C'est lui,
aussi, qui a été chassé devant Montargis en septembre 1427 par des
capitaines français tout aussi brillants : le Bâtard
d'Orléans, Raoul de Gaucourt, gouverneur d'Orléans, qui avait
dirigé la défense de Harfleur en 1415 face à Henri V ; le
seigneur de Villars, des capitaines gascons comme La Hire et
Xaintrailles. Salisbury, lui, compte bien faire sauter le verrou
d'Orléans et prendre ensuite toutes les places françaises sur la
Loire, afin de protéger définitivement Paris et d'entamer
l'offensive contre le « royaume de Bourges ».
Bedford, le régent, aurait préféré achever la conquête de
l'Anjou. Concentrée à Chartres, l'armée anglaise progresse
rapidement et s'empare, le 5 septembre, de Meung-sur-Loire, à une
dizaine de kilomètres d'Orléans. Elle met ensuite le siège devant
Beaugency, tandis que les soudards pillent la collégiale royale de
Notre-Dame-de-Cléry. Le 8 septembre, Salisbury paraît pour la
première fois sous les murs d'Orléans. Pour priver la ville de
secours, il procède à un encerclement méthodique sur 10 à 20 km
de rayon. Beaugency tombe le 25 septembre ; à la fin du mois,
le nord et l'ouest d'Orléans sont bloqués. John de la Pole,
lieutenant de Salisbury, s'occupe de l'est : il prend Jargeau le
5 octobre, Châteauneuf le lendemain. Le 7, Olivet, au sud d'Orléans,
est investie, et une reconnaissance est lancée sur les défenses de
la ville le soir-même. Orléans est désormais assiégée.
Orléans,
située sur la rive droite de la Loire, est alors une grosse ville
pour l'époque, peut-être 30 000 habitants avec les faubourgs.
Protégée par un rempart et une trentaine de tours, ainsi que par le
donjon de la Tour Neuve construit sous Philippe Auguste, Orléans
dispose d'un pont de 350 m à 19 arches qui la relie à la rive sud
de la Loire. Au milieu, l'île Saint-Antoine, où un fortin a été
construit en 1417 après une incursion anglaise -la bastille
Saint-Antoine. Au niveau de la 18ème arche, on trouve deux tours
solidaires qui protègent l'accès au pont, la bastille des
Tourelles. Ville royale par excellence jusqu'à Philippe Auguste,
Orléans compte aussi une prestigieuse université de droit civil et
c'est le coeur des terres des Orléans . Charles, le fils du duc
assassiné par Jean Sans Peur, a été capturé à Azincourt et il
est prisonnier en Angleterre.
![]()
Charles
VII connaît l'importance de la place. Dès juin 1428, il autorise
les habitants à prélever des taxes sur des marchandises et le sel
pour financer le renforcement des remparts. Le 7 septembre, plusieurs
centaines d'hommes arrivent à Orléans, commandés par le Bâtard,
La Hire et Xaintrailles. Dunois, Bâtard d'Orléans, prend en charge
la défense avec Raoul de Gaucourt. La garde est doublée. Chaque
porte est munie d'une cloche pour sonner l'alerte. Au débouché du
pont, après les Tourelles, les habitants construisent une levée de
terre et un fossé pour en défendre l'accès. Mais l'atout de la
ville, c'est son artillerie. Orléans entretient 12 canonniers
principaux qui ont la responsabilité de 70 pièces, de la
couleuvrine aux gros canons. Montargis en a envoyé un qui porte le
nom de cette ville ; un autre canon est baptisé « Rifflart »,
ou celui qui érafle. Les bourgeois d'Orléans ont fait faire une
bombarde. L'artillerie joue un rôle considérable pendant le siège :
elle tue plusieurs chefs anglais, dont Salisbury et son neveu Richard
Grey. Elle a même ses héros : Jean de Monteclair, dit le
Lorrain, est un expert de la couleuvrine. Lorrain installé à
Angers, Charles VII l'envoie à Orléans. C'est en quelque sorte un
ancêtre des snipers modernes : il tue à distance avec
sa couleuvrine, use de malice en faisant croire aux Anglais qu'il a
été touché avant de se relever. Jean d'Aulon raconte qu'il lui
désigne, pendant l'assaut sur la bastille des Augustins, un Anglais
qui anime la défense, que Jean Monteclair abat immédiatement, ce
qui permet d'emporter la place.
Raoul
de Gaucourt dispose, en septembre, de 5000 hommes pour la défense,
plus les quelques centaines entrés à la dernière minute. Mais les
effectifs fluctuent tout au long du siège. En mars 1429, il y a par
exemple 500 hommes d'armes et 400 hommes de trait. Cependant, les
troupes envoyées régulièrement par Charles VII permettent non
seulement de tenir la place mais aussi de mener des sorties contre
l'assiégeant. La cohabitation entre soudards et bourgeois n'est pas
facile au départ, mais le siège soude les volontés. Même les
femmes de la ville participent à la défense, une caractéristique
que l'on retrouve fréquemment lors des sièges de la fin du Moyen
Age.
Côté
anglais, les effectifs ne sont pas très nombreux, mais correspondent
aux capacités financières et logistiques de l'époque. Aux 2 700
hommes initiaux de Salisbury s'ajoutent les 400 hommes d'armes et 1
200 archers fournis par Bedford, la levée féodale en Normandie
disponible au printemps 1429 (200 hommes d'armes, 600 archers) et le
contingent bourguignon dont on ignore le nombre. En novembre, moment
où les opérations stagnent, il n'y a que quelques centaines
d'Anglais devant Orléans. Le contingent bourguignon se retire en
avril 1429. Au maximum, il n'y a pas eu plus de 5 à 6 000 Anglais en
face de la ville. Et en réalité, on y trouve beaucoup de Français :
sujets du duc de Bourgogne et Normands en particulier. Outre
Salisbury et son neveu, il y a parmi les chefs les frères La Pole,
Talbot, Thomas de Scales, William Neville, William Glasdale, tous
expérimentés par les combats en France. Bien préparés, les
Anglais disposent eux aussi d'une abondante artillerie. Une pièce de
gros calibre, baptisée Passe, envoie des projectiles de
plusieurs dizaines de kilos. Le ravitaillement avec Paris est
solidement tenu.
Le
12 octobre, Salisbury lance une première attaque sur la ville
elle-même. Les Anglais arrivent avant la fin des travaux du
boulevard au-delà du fort des Tourelles : les habitants
incendient un faubourg et le couvent des Augustins. Mais les
assaillants s'y installent et le couvent devient le quartier général
anglais. Le 17 octobre, l'artillerie anglaise installée à cet
endroit bombarde les Tourelles. D'autres canons, placés sur la levée
de Saint-Jean-le-Blanc, bombarde les murailles de la ville. En une
journée, ils tirent pas moins de 124 boulets ! Le 21 octobre,
une première attaque anglaise sur le boulevard des Tourelles échoue,
avec de lourdes pertes (120 tués selon les Français). Les Anglais
entreprennent alors de creuser une mine sous le boulevard, mais les
Français la détectent et évacuent l'ouvrage en l'incendiant.
Abandonnant les Tourelles qu'ils jugent en mauvais état, les
Français construisent alors un nouveau boulevard devant la bastille
Saint-Antoine, le boulevard de Belle-Croix. Les Tourelles sont
évacuées le 23 octobre et les Anglais y entrent le lendemain.
William Glasdale prend la tête des hommes placés là.
Salisbury,
qui observe la ville depuis une fenêtre des Tourelles le 24 octobre,
est atteint par un boulet de canon ou une balle de couleuvrine tirée
depuis Orléans. Transporté à Meung-sur-Loire, il y meurt trois
jours plus tard. Décontenancés par la mort de leurs chefs, les
Anglais, peut-être aussi en prévision de l'hiver, replient dès le
8 novembre une partie de leurs troupes dans les villes proches. Si
Glasdale garde le commandement sur la rive sud, au nord, celui-ci est
collectif, Talbot semblant dominer. Bedford, qui s'est rapproché à
Chartres depuis la mort de Salisbury, n'intervient cependant pas
outre mesure, preuve qu'il était opposé au siège. En novembre,
le siège se limite au pilonnage de l'artillerie anglaise. Le 25
octobre, des renforts français sont arrivés : plusieurs
centaines d'hommes d'armes et d'arbalétriers, des fantassins
italiens commandés par Jean de Brosse, seigneur de Boussac et de
Saint-Sévère, maréchal de France, Jean de Bueil, Jacques de
Chabannes, Pierre d'Amboise, La Hire. Venue de Blois, l'armée a
suivi la rive en évitant les places tenues par les Anglais. Le siège
n'est pas établi au sens strict.
Début
décembre, la situation évolue. Le 1er, la garnison anglaise des
Tourelles reçoit le renfort de 300 hommes commandés par Thomas de
Scales et Talbot. Le 7, avec de l'artillerie supplémentaire, ils
tentent un coup de main sur le boulevard Saint-Antoine, qui échoue,
notamment parce que les préparatifs anglais sont visibles depuis le
beffroi de la ville, qui signale toutes les attaques. Les Orléanais
placent ensuite une grosse bombarde pour pilonner les Tourelles. Noël
voit une trève entre les deux camps. Quelques jours plus tard, une
joute oppose deux chevaliers gascons de la compagnie de La Hire à
deux Anglais. Le 29 janvier 1429, La Hire rencontre même Lancelot de
Lisle, le maréchal anglais, mais on ne sait pas ce qu'il en sort ;
en revanche de Lisle est tué par un boulet de canon en revenant vers
ses lignes... Car le 30 décembre, une armée anglaise de 2 500
hommes apparaît sur la rive nord, pour commencer l'investissement de
la place. Les Orléanais l'ont bien compris et tentent une sortie,
pendant laquelle Jacques de Chabannes est blessé. Les Anglais,
encore insuffisamment nombreux pour entreprendre un véritable
blocus, s'installent d'abord à l'ouest, sur la route de Blois d'où
peuvent provenir les renforts français, dans les ruines de l'église
Saint-Laurent. Le 1er janvier, ils attaquent la porte Renard, celle
de la route vers l'ouest. Les assiégés font une sortie mais ils ont
le dessous. Les Anglais reviennent le lendemain et le 4 janvier, ils
attaquent à la fois la porte Renard et le pont à partir des
Tourelles, mais sont rejetés. Les pertes sont légères mais les
combats deviennent quotidiens : le siège commence réellement.
Le
ravitaillement et les renforts arrivent cependant à pénétrer assez
faciilement dans la ville. Le 3 janvier, 950 cochons et 400 moutons y
sont entrés. Le 5, Louis de Culant, amiral de France, entre par le
même chemin : par Blois, sur la Sologne et le port Saint-Loup.
Le 10, c'est un convoi de poudre et de vivres qui arrive de Bourges.
Les 8 et 9 février, 1500 combattants arrivent à Orléans avec Raoul
de Gaucourt, Guillaume d'Albret, William Stuart, frère du connétable
d'Ecosse, Gilbert Motier de la Fayette, maréchal de France. Mais ces
voyages ne sont pas sans risques : le 9 février, le Bâtard de
Bar, qui veut aller à Blois, est capturé par les Anglais. Ceux-ci
n'ont cependant jamais pu complètement isoler Orléans. Ils prennent
même des vignerons de la ville qui tentent d'entretenir leurs
parcelles ! Pire, certains de leurs convois sont capturés,
comme celui du 3 avril. Pour prendre Orléans, les Anglais n'ont que
deux solutions : l'assaut ou le blocus. Faute d'effectifs ou en
raison de la solidité des défenses, ils commencent par la deuxième
option.
Ils
construisent d'abord un boulevard en aval du fleuve, sur l'île
« Charlemagne », puis un autre sur la grève de la
rive sud, pour circuler tranquillement entre leurs positions.
Lancelot de Lisle, qui commance ces ouvrages, est cependant tué le
29 janvier. Puis ils construisent un autre boulevard pour compléter
l'encerclement. Le 15 janvier, les chefs français tentent une
sortie, pour gêner les travaux, contre le camp principal de
Saint-Laurent : c'est l'échec. Le lendemain, John Falstolf
amène 1200 hommes, du ravitaillement et des munitions. Plus
nombreux, les Anglais cherchent à empêcher les convois de passer :
le 18, ils saisissent près de Jargeau l'un d'entre eux et le bateau
qui servait à franchir le fleuve, renseignés par des villageois.
Les défenseurs cherchent à reprendre le bateau mais perdent 22 tués
et le tireur d'élite Jean de Monteclair manque d'être pris.
Charles
VII n'est pas resté inactif depuis le début du siège : tous
les grands capitaines ou presque de l'armée fançaise y sont. Le roi
envoi en octobre un chirurgien pour soigner les blessés. Surtout, il
cherche à rassembler de l'argent et à obtenir l'alliance des
Ecossais. Des messagers ou des capitaines font fréquemment
l'aller-retour pour le tenir informé du déroulement du siège. Le
roi confie enfin une armée de plusieurs milliers d'hommes au comte
de Clermont, venu d'Auvergne. Le 10 février, les Orléanais
apprennent qu'un important convoi de ravitaillement doit rejoindre
l'armée anglaise venant de Paris, avec plus de 300 chariots. Dunois
veut s'en emparer et soumet l'idée au comte de Clermont, au
connétable John Stuart d'Ecosse et à Louis d'Amboise, qui donnent
leur accord. L'opération est périlleuse car il faut prélever les
meilleurs défenseurs de la ville pour faire la jonction avec le
comte de Clermont, avant d'attaquer le convoi.
Le
11 février, la plupart des chefs français, menant 1500 hommes,
quittent Orléans. Au même moment, le comte de Clermont part de
Blois avec 2500 hommes. Les deux groupes doivent faire leur jonction
à Rouvray-Saint-Denis, à 40 km au nord d'Orléans. Le groupe
orléanais y arrive en premier et campe sur place. Le 12 février,
dans l'après-midi, Dunois apprend l'approche imminente du convoi,
escorté par John Falstolf, le prévôt de Paris Simon Morhier, 1600
hommes d'armes et les arbalétriers des milices parisiennes. La Hire
veut attaquer immédiatement pour conserver l'effet de surprise mais
Dunois demande d'attendre le comte de Clermont, qui l'a exigé par
courrier. Or les Anglais repèrent les Français, installent leurs
chariots en cercle et plantent des pieux dans le sol pour se
protéger. Arbalétriers et archers anglais sont placés chacuns sur
un flanc, les hommes d'armes étant au centre. En face, les
mercenaires gascons sont contre les Parisiens, les Ecossais contre
les archers anglais et les hommes d'armes face à leurs homologues.
L'armée française n'arrive pas à conserver sa discipline et le
connétable d'Ecosse entraîne le reste des troupes à l'attaque.
C'est un massacre : les archers anglais s'en donnent à coeur
joie et les survivants sont cueillis par une sortie des hommes
d'armes anglais. Le comte de Clermont, arrivé trop tard, refuse de
prendre part aux combats. Les Français perdent 3 à 600 tués dont
le connétable d'Ecosse, son frère et d'autres grands seigneurs. Les
survivants, conduits par La Hire et Xaintrailles, se replient sur
Orléans. Cette journée reste connue sous le nom de « détrousse
des Harengs », les vivres du convoi étant constituées de
poisson en ce temps de carême. Le convoi arrive d'ailleurs dans le
camp anglais le 17 février.
Le
comte de Clermont, qui vient dans la ville assiégée, en repart dès
le 18 février. Beaucoup de personnages importants, et 2000 hommes,
la moitié de la garnison, partent avec lui : Louis de Culant,
et même La Hire. Le Bâtard, Poton de Xaintrailles et le maréchal
de Saint-Sévère, qui restent, semblent abattus : ils proposent
aux habitants la reddition, ceux-ci refusent et mandent à la place
une ambassade au duc de Bourgogne. Début mars, un trou assez large
pour laisser passer un homme est découvert dans le rempart. Le
lendemain, Dunois doit faire pendre deux hommes qui n'ont pas
respecté le sauf-conduit, preuve que la discipline se relâche et
que le moral flannche. Des Anglais se déguisent même en femmes pour
pénétrer dans la ville ! La situation est pourtant loin d'être
désespérée. Pour échapper à la surveillance du beffroi et finir
le siège, les Anglais cherchent à creuser un profond fossé. Le 3
mars, les assiégés réussissent à interrompre les travaux par une
sortie : Jean de Monteclair tue 5 Anglais avec sa couleuvrine
dont Richard Grey, le neveu de Salisbury. Le 8, plusieurs centaines
d'Anglais arrivent de Jargeau et de la Beauce. Le 10, ils occupent
l'ancien monastère Saint-Loup, à l'est de la ville, qui domine le
fleuve, et en font une bastille avec parapet et fossé. Le 20, un
nouveau fortin, « Londres », est construit.
Manifestement les Anglais cherchent à asphyxier Orléans par une
ceinture de bastilles. Au début du mois d'avril, ils en construisent
une autre, « Rouen », qu'une sortie des assiégés
le 9 ne parvient pas à détruire. Un convoi d'argent pénètre
pourtant dans la ville le 13. Les Anglais répliquent en construisant
un nouvel ouvrage, « Paris », entre les 15 et 20
avril, mais une sortie parvient à faire rentrer un nouveau convoi le
16.
Les
escarmouches continuent en parallèle. Début avril, les Orléanais
lancent un raid sur Meung : le capitaine anglais est tué et du
bétail ramené. Le 12 avril, 20 Anglais sont capturés dans l'église
Saint-Marcel. Le 16, 50 hommes d'armes français venus de Sologne
lancent un coup de main sur les Tourelles : ils font 15
prisonniers, et les assiégés tuent 3 sentinelles lors d'une sortie.
La détermination des défenseurs semble alors renforcée : il
faut dire que dès la fin février, comme le rappelle Dunois lors du
procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc de 1456, ils ont eu vent
de l'arrivée d'une Pucelle qui doit lever le siège et faire sacrer
le roi à Reims. Partie de Vaucouleurs le 13 février, Jeanne est en
effet passée à Gien le 18 ou le 19, ce qui confirme le témoignage
de Dunois.
De
Vaucouleurs à Orléans
Jeanne
cherche alors par tous les moyens à quitter Domrémy pour mener à
bien sa mission. Elle saute sur la première occasion pour aller
rencontrer le capitaine de Vaucouleurs, Robert de Baudricourt, qui
l'éconduit. Puis elle va voir le duc Charles II de Lorraine,
intrigué par la Pucelle, qui lui donne sa bénédiction. Baudricourt
s'incline, suivant aussi les habitants de Domrémy, et Jeanne part le
12 février, journée de la « détrousse des Harengs »,
accompagnée d'une escorte conduite par Jean de Metz et Bertrand
Poulengy. L'expédition n'a rien d'une mission commando derrière les
lignes ennemies, mais le voyage reste périlleux. Jeanne arrive à
Chinon le 23 février. On prend quelques précautions, probablement,
avant de lui faire rencontrer Charles VII, qui est convaincu. Après
confirmation de sa virginité, elle passe devant une commission de
théologiens à Poitiers. Ceux-ci finissent par accepter ses dires,
même si elle inverse l'attendu en déclarant que le signe montrant
la pertinence de ses paroles sera la reconquête d'Orléans... mais
d'ailleurs en quoi consiste exactement sa mission ? Deux points
sont sûrs : lever le siège d'Orléans et faire sacrer le roi.
Ce sont les deux objectifs premiers. Mais Jeanne aurait aussi évoqué
la reprise de Paris et la libération du duc d'Orléans, captif en
Angleterre.
On
ne sait pas grand chose sur les préparatifs de Jeanne pour la
guerre. En revanche, le royaume de Bourges met en oeuvre une
formidable campagne de communication, comme on dirait aujourd'hui,
pour faire connaître cette Pucelle qui prend la tête de l'armée
afin de délivrer Orléans. On ressort de vieilles prophéties qui
annonçaient la venue d'une vierge chargée de mettre fin aux maux du
royaume. On la qualifie de prophétesse et, à ce moment-là, de
bergère, tout en évitant soigneusement la question des voix, qui
dérange le clergé y compris dans le camp de Charles VII. Jeanne est
de plus dotée d'une « maison militaire » :
un écuyer, Jean d'Aulon, deux hommes d'armes, Jean de Metz et
Bertrand de Poulengy, deux pages, dont Louis de Coutes. Il y a aussi
deux hérauts, D'Ambleville et Guyenne, et sans doute deux frères de
Jeanne, Jean et Pierre, ainsi que son confesseur, Jean Pasquerel, et
le clerc Mathelin Raoul, qui tient les comptes. Jeanne reçoit une
armure mais, surtout, se fait confectionner des drapeaux : un
pennon avec une Annonciation et un étendard qui devait probablement
porter une représentation de l'Apocalypse avec l'héraldique royale
et les mots « Jhesu Maria », selon le culte du
Saint Nom alors diffusé par des franciscains comme Bernardin de
Sienne. Dès le 22 mars, à Poitiers, elle a adressé une lettre aux
Anglais, en forme de défi, qui se termine en appel à la croisade
après la libération du royaume -une mission supplémentaire dont
elle s'investit aussi.
Le
siège d'Orléans est levé
Dès
la fin du mois de février, donc, les défenseurs d'Orléans ont
connaissance de la Pucelle. Deux envoyés reviennent fin mars-début
avril avec les informations récentes. Bedford commet alors une
erreur en humiliant le duc de Bourgogne, venu lui soumettre l'offre
de négociation des Orléanais. Le 17 avril, le contingent
bourguignon se retire. Dans la nuit, les défenseurs saluent le
départ en menant une sortie qui aboutit à des combats sanglants.
Les Anglais reçoivent cependant des renforts et construisent un
nouveau boulevard. Bedford n'a plus de réserves et doit demander des
troupes en Angleterre, qui mettront du temps à arriver. Côté
français, des hommes entrent encore : le 24 avril, le Bâtard
de Masqueran avec 40 hommes d'armes ; le 25, Alain Giron, un
Breton, avec 100 combattants ; le 28, Florent d'Illiers,
capitaine de Châteaudun assiégé, se jette dans Orléans avec les
400 défenseurs, dont le frère de La Hire. Les Anglais interceptent
pourtant un convoi destiné à la ville. La situation est dans
l'impasse : les assiégeants ne peuvent emporter la décision,
mais les assiégés ne peuvent pas lever le blocus.
Jeanne
arrive à Blois le 25 avril. Un gros convoi doit parvenir à Orléans
sous escorte, avec Gilles de Rais, le maréchal de Saint-Sévère et
la Pucelle : 3000 hommes, 60 chariots de vivres et 435 de
bétail. L'armée longe la rive de la Sologne, presque à l'image
d'une croisade : on chante le Veni Creator Spiritus,
Jeanne a chassé les prostituées et fait confesser les hommes, et a
interdit la rapine. Dans la nuit du 28 au 29 avril, le convoi
approche du sud d'Orléans. Dunois vient à sa rencontre avec La
Hire. L'entrevue est orageuse. Jeanne accepte d'embarquer cependant
avec le ravitaillement et quelques troupes pour rentrer plus vite
dans la ville, au lieu d'attaquer tout de suite comme elle le
voudrait. Son entrée dans la ville a un effet certain sur le plan
psychologique. Le lendemain 30 avril, les chefs décident d'attendre
le reste de l'armée avant de passer à l'assaut. La Hire et Florent
d'Illiers tentent pourtant une sortie infructueuse contre l'ouvrage
« Paris ». Jeanne envoie encore des sommations aux
Anglais, qui l'insultent copieusement sur les remparts.
A
ce moment-là le dispositif anglais est achevé. Autour de la ville,
d'ouest en est, le camp Saint-Laurent puis les bastilles Londres,
Rouen, Paris, à l'est la bastille Saint-Loup ; au milieu du
fleuve, sur l'île Charlemagne, un boulevard ; plus au sud, sur
l'autre rive et la grève, la bastille du Champ-Saint-Pryvé ;
le fort des Tourelles et le couvent des Augustins, et plus à l'est,
la levée de Saint-Jean-le-Blanc. Les Anglais, trop peu nombreux,
sont dispersés dans ces bastilles et n'ont pas de réserves. Le 3
mai, 2 000 hommes partent de Blois et arrivent le lendemain dans
Orléans par la rive nord, couverts par une sortie des assiégés.
Mais Jeanne n'est pas tenue informée des opérations par les chefs
français. Des combats éclatent ce jour-là près de la bastille
Saint-Loup, un peu isolée dans le dispositif anglais. Les Français
sont d'abord victorieux puis ont le dessous. Jeanne, qui se réveille
en sursaut, accourt sur les lieux et galvanise les assiégés, qui
finissent par emporter la bastille. Beaucoup d'Anglais périssent et
il n'y a quasiment pas de prisonniers. Ce n'est pas en soi un
miracle : la bastille était peu défendue, puisque les sources
évoquent 110 à 190 Anglais tués et 10 à 40 capturés, les
Français perdant 2 morts. Talbot a bien fait une sortie depuis la
bastille Paris pour aider Saint-Loup mais, averti par le beffroi, le
maréchal de Saint-Sévère est lui aussi sorti pour le contrer.
Le
5 mai est jour de trêve car jour de l'Ascension. Un conseil de
guerre à Orléans réunit tous les chefs français... sauf Jeanne,
encore une fois tenue à l'écart. Les Français décident d'attaquer
simultanément le camp de Saint-Laurent et les Tourelles. Jeanne
finit par se faire révéler le plan : elle envoie une dernière
missive aux Anglais sur une flèche tirée dans leurs positions. Dans
la nuit du 6 mai, elle traverse le fleuve avec les soldats qui
s'emparent sans combats de la levée de Saint-Jean-le-Blanc,
abandonnée par les Anglais qui se sont réfugiés aux Augustins. Un
premier assaut sur cet ouvrage échoue : Jean d'Aulon et Raoul
de Gaucourt couvrent la retraite. Surviennent alors Jeanne et
La Hire qui repoussent une sortie des défenseurs des Augustins,
avant de s'emparer de haute lutte de l'ouvrage. Les survivants se
réfugient aux Tourelles.
Le
7 mai, Jeanne, blessée la veille par une chausse-trappe, veut
prendre les Tourelles. Les capitaines sont contre : selon
certaines sources, ils demandent même à Raoul de Gaucourt de fermer
les portes pour empêcher Jeanne de sortir de la ville ! Mais
celle-ci les fait fléchir. L'assaut initial sur les Tourelles est
repoussé, les Anglais luttant pied à pied. Jeanne, toujours au
premier rang, est blessé au cou. Au soir, Dunois veut sonner la
retraite. Mais Jeanne s'entête, son étendard est porté en avant,
les défenseurs du pont sortent du boulevard Belle-Croix jettent des
planches et attaquent les Tourelles de ce côté, menés par un
chevalier de l'Hôpîtal, frère Nicolas de Giresme. Les Anglais
fléchissent, évacuent le boulevard, tandis qu'une partie du
pont-levis s'effondre, emportant plusieurs chefs anglais dont
Glasdale, qui périt noyé. On ne sait pas si cette destruction est
provoquée par le tir d'une bombarde ou par un bateau rempli de
matières inflammables qui a bien été jeté sur les Tourelles. Les
pertes anglaises sont lourdes, 3 à 600 morts, et la bastille est
finalement tombée.
Le
lendemain, 8 mai, les Anglais se déploient en ordre de bataille
devant la ville. Les assiégés font de même : tous les chefs
sont là. C'est un dimanche. Les deux armées s'observent pendant une
heure. Jeanne refuse d'engager le combat le Jour du Seigneur.
Finalement, les Anglais abandonnent et se replient sur Meung,
poursuivis par La Hire et Ambroise de Loré qui, avec 120 lances,
s'emparent des bagages et d'une partie de l'artillerie. Le Bâtard de
Bar en profite pour s'échapper. Les Orléanais démantèlent les
ouvrages anglais. Les 8 et 9 mai, des processions ont lieu dans toute
la ville. Jean Gerson, fameux théologien, achève quelques jours
plus tard le traité qu'il consacre à Jeanne par cette phrase :
« Cela a été fait par le Seigneur » . Thomas
Basin, lui, conclut ainsi sur l'épisode : « Dès lors
la pointe de fer de la flèche anglaise fut émoussé et ne pénétré
plus comme auparavant , dès lors le cours de la Fortune fut
changé... » .
Conclusion
Charles
VII va faire de Jeanne d'Arc, contrairement à ce qui s'est sans
doute passé, la figure centrale de la reconquête d'Orléans.
L'issue brutale du siège, décidée en quelque jours, combinée à
l'effort de propagande royal, suscite un véritable choc dans le
royaume. Le duc de Bretagne, spécialiste des louvoiements entre les
deux camps, revient vers Charles VII. Mais les Anglais ne sont pas
encore défaits : Jeanne, cependant, au côté des chefs de
guerre du roi, reconquiert les villes au fur et à mesure, Jargeau,
Meung, Beaugency, avant la victoire de Patay, le 18 juin 1429. La
victoire est totale et ouvre la voie à l'expédition du sacre.
L'impulsion décisive est ainsi donnée à la phase finale de la
guerre de Cent Ans. Charles VII, sacré roi à Reims, a désormais
l'initiative, et ne la lâchera plus. Sur le plan militaire, outre le
rôle de l'artillerie, le siège d'Orléans montre combien les deux
armées en présence restent encore profondément médiévales,
malgré des germes de modernité.
Pour
en savoir plus :
Philippe
CONTAMINE, Olivier BOUZY, Xavier HELARY, Jeanne d'Arc. Histoire et
dictionnaire, Bouquins, Paris, Robert Laffont, 2012.









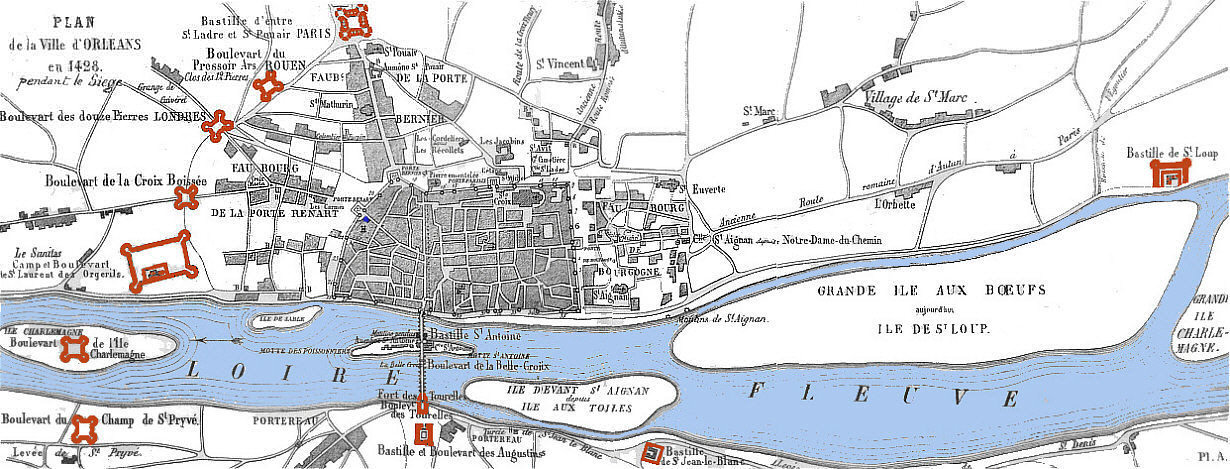








.jpg)