Sur L'autre côté de la colline, vous pouvez trouver depuis deux jours l'article de David François consacré à la guerre d'indépendance turque. Ce conflit, assez oublié, a pourtant participé au redécoupage du Proche-Orient au lendemain de la Première Guerre mondiale, dont on sent évidemment certaines conséquences aujourd'hui, en pleine guerre civile syrienne. Bonne lecture !
↧
L'autre côté de la colline : la guerre d'indépendance turque (David François)
↧
Histoire & Stratégie n°17, supplément : Les blindés américains dans l'offensive du Têt
Pour remettre en perspective l'offensive du Têt, je vous renvoie à mon livre sur le sujet.
Avant
le déclenchement de l'offensive du Têt, la plupart des formations
blindées des quatre zones tactiques du Sud-Viêtnam sont en position
pour repousser une attaque. Les unités américaines sont placées à
l'extérieur des villes, pour bloquer les routes d'infiltration et
encaisser le premier assaut. Les unités sud-viêtnamiennes sont
placées dans les villes, ou à côté, pour anticiper les
soulèvements dans les centres urbains. Mais les formations blindées
s'attendent davantage à des tirs d'artillerie indirects ou des
embuscades, comme de coutume, et non à une offensive généralisée
de l'ampleur du Têt. Comme le montre trois exemples différents, les
blindés vont faire la preuve, durant le Têt, de leur utilité comme
force de réaction, faisant souvent basculer le cours de la bataille
par leur intervention.
A
21h00, le 30 janvier 1968, le lieutenant-colonel Otis, commandant du
3rd Squadron, 4th
Cavalry, reçoit l'ordre de porter secours à la base aérienne
de Tan Son Nhut, au nord de Saïgon. Otis désigne le capitaine
Virant, commandant de la Troop C, pour ce faire. La Troop
C est à Cu Chi, à 25 km au nord-ouest de Saïgon ; une de ses
sections protège le pont Hoc Mon, à 10 km en avant. A 4h15, Otis
reçoit l'ordre de courir sus à un régiment viêtcong qui a
attaqué à la base ; la Troop C se met en route en un
quart d'heure, passe sous le commandement opérationnel de la base
aérienne, doit rencontrer un guide au sud du pont pour approcher de
Tan Son Nhut. Jusqu'au pont, Otis survole la colonne en hélicoptère
au-dessus de la route n°1, lâche des fusées éclairantes pour
décourage les embuscades.
A
6h00, la Troop C, en approchant de la base, est pris sous un
violent tir d'armes automatiques et de RPG, et cherche à couper
l'ennemi en tronçons à l'endroit où la route n°1 rencontre la
porte sud-ouest de Tan Son Nhut. 100 Viêtcongs se retrouvent isolés
à l'intérieur et le reste à l'extérieur. Dans les premières
minutes de l'attaque, plusieurs blindés sont détruits et les pertes
sont lourdes ; le capitaine Virant est blessé à la tête. La
Troop C demande des renforts à Cu Chi. Otis fait diriger le
1st Squadron de la Troop C,
qui gardait toujours le pont, et l'Air cavalry troop, pour
renforcer l'unité malmenée : de son hélicoptère, il
distingue déjà 4 chars et 5 véhicules blindés en feu. Les
gunships apportent cependant rapidement leur soutien et deux
hélicoptères de la Troop D se posent pour laisser des
munitions, qui commencent à manquer aux troupes au sol. Le 1st
Platoon arrive à 7h15 : Otis le dirige sur la piste, puis
vers le sud jusqu'au flanc gauche de la Troop C, pour attaquer
vers l'ouest.
La
Troop B, qui garde un autre pont à 47 km de là, reçoit elle
aussi l'ordre de gagner le champ de bataille. Arrivée en 45 mn, elle
exécute une manoeuvre pour se mettre en parallèle du flanc nord de
l'attaque viêtcong, près de l'usine textile Vinatexco. Les
véhicules avancent en ligne pour prendre de flanc une force estimée
à 600 soldats adverses. Le Viêtcong est écrasé entre les
Troops B et C, l'artillerie et les gunships. La
bataille atteint son paroxysme à 10h00, puis prend la forme d'un
nettoyage systématique entre 13h00 et 22h00. 300 morts sont
décomptés sur le champ de bataille, et 24 Viêtcongs sont
pris. A 14h00, Otis entre à Tan Son Nhut.
Une
autre bataille importante du Têt se joue autour du complexe
logistique de Long Binh et de la base aérienne de Bien Hoa, au
nord-est de Saïgon. Dans la nuit du 30 janvier 1968, le 2nd
Battalion du 47th (Mechanized)
Infantry se déplace à Long Binh pour servir de force de
réaction rapide à la 199th Light
Infantry Brigade. L'attaque commence à 1h00, le 31 janvier. La
compagnie B arrive au dépôt de munitions à 6h00 : le temps de
se coordonner avec les défenseurs, elle est prise à partie par des
snipers qui détournent l'attention des sapeurs qui placent
des chargents dans certains bunkers de munitions. Les fantassins
mécanisés tentent d'éliminer à la fois les charges, les sapeurs
et les snipers. A 7h50, plusieurs bunkers finissent par
exploser et 4 hommes sont tués. Le reste de la journée voit la
compagnie continuer le nettoyage du dépôt.
La
compagnie C arrive quant à elle devant le QG du IIIème corps
sud-viêtnamien, violemment attaqué, à 5h54. Les mitrailleuses
embarquées couvrent une attaque de flanc qui se termine en un combat
bâtiment par bâtiment. Au prix de 8 blessés et d'un véhicule
blindé perdu, la compagnie se déplace ensuite vers la prison à
l'est de Bien Hoa. A 17h30, après un combat acharné, les Américains
font reculer le Viêtcong et reviennent au QG du IIIème corps
pour en assurer la sécurité. La compagnie A, elle, va appuyer la
199th Brigade près du village de Ho
Nai, sur la route n°1. L'attaque ennemie menace les installations à
l'est de Bien Hoa : la compagnie et le QG de bataillon
rejoignent le 4th Battalion, 12th
Infantry et le 2nd Battalion, 3rd
Infantry, pour attaquer au nord de la route n°1. Artillerie,
gunships et véhicules blndés préparent l'assaut qui aboutit
à 42 cadavres viêtcong et à un mouvement vers le post de Long Binh
au crépuscule.
Le
31 janvier, la Troop A, 3rd Squadron, 5th
Cavalry tient le rôle de force de sécurité pour la Fire
Support Base Apple,à 28 km à l'est de Bien Hoa, sur la route
n°1. A 2h30, le capitaine Garretson reçoit l'ordre de laisser son
3rd Platoon et de foncer sur Bien Hoa.
En chemin, à Trang Bom, les blindés tombent dans une embuscade
montée par une compagnie adverse. Le combat dure 5 minutes, les
blindés se contentant de passer à travers en tirant de toutes leurs
armes. Arrivés à un pont en dur à 18 km à l'est de Bien Hoa, un
premier char traverse, mais l'ouvrage saute juste après lui. Les
ACAV n'ont aucun mal à traverser à gué, mais les autres chars
doivent rester sur la berge. Arrivés dans Bien Hoa, les blindés se
retrouvent au milieu de deux compagnies adverses ! La première
volée de roquettes détruit deux véhicules, avant que les
Américains ne reprennent l'avantage. Il reste alors 1 char et 8
ACAV. Le lieutenant-colonel Bartley, qui commande le squadron, arrive
alors au-dessus de la colonne en hélicoptère et la guide jusqu'à
la base de Bien Hoa, faisant échouer une embuscade le long de la
route en déplaçant les blindés dans son dos. Rattachés à un
bataillon de la 101st Airborne Division
héliporté dans la base de Bien Hoa, les blindés combattent
toute la journée ; 2 ACAV sont perdus, le char reçoit 19 coups
de RPG et doit changer d'équipage deux fois ! La Troop A
a perdu 5 tués et 23 blessés.
Dans
la province de Vinh Long, dans le delta du Mékong, l'offensive du
Têt commence à 3h00 le 31 janvier, quand le Viêtcong
attaque la ville de Vinh Long et la base de la cavalerie
sud-viêtnamienne, à 95 km au sud-ouest de Saïgon. Le 3rd
Squadron, 2nd Armored Cavalry Regiment,
se dégage rapidement à sa base et envoie des troupes au QG du
régiment, durement pressé. Après avoir également dégagé la
place, le squadron part défendre l'aérodrome, tandis que les
hommes du QG protègnet la partie sud-ouest de la ville. Le 3rd
Squadron nettoie le périmètre extérieur de l'aérodrome, puis
revient dans la ville, où il se heurte à forte partie. Il progresse
néanmoins et fait la jonction avec le 43rd
Ranger Battalion de l'ARVN, lequel finit par le laisser seul dans
le combat de rues. Une compagnie de Forces Régionales refuse
d'avancer et la nuit venue, le Squadron doit se replier sur
les zones sécurisées.
Le
lendemain, sans davantage d'infanterie, le squadron mécanisé ne
peut mener le combat de rues nécessaire pour nettoyer la ville. Dans
la nuit du 1er février, les soldats sud-viêtnamiens du 3rd
Battalion, 15th Infantry, arrivent par
bateau, et les combats reprennent le lendemain, avec l'appui de
gunships américains. L'infanterie mécanisée et une
compagnie de Rangers nettoient enfin l'ouest de la ville et le
Viêtcong se replie. Il aura fallu 5 jours de combat aux
Sud-Viêtnamiens pour mener à son terme le combat urbain.
Pour
en savoir plus :
General
Donn A. STARRY, MOUNTED COMBAT IN VIETNAM, VIETNAM STUDIES,
DEPARTMENT OF THE ARMY, WASHINGTON. D.C., 1978, p.114-127.
↧
↧
François BURGAT et Bruno PAOLI (dir.), Pas de printemps pour la Syrie. Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise (2011-2013), Paris, La Découverte, 2013, 357 p.
Près de trois ans après son déclenchement, la révolution syrienne n'est toujours pas achevée. Elle s'est même transformée en véritable guerre civile. A l'appel de deux spécialistes français, François Burgat et Bruno Paoli, un panel de 28 auteurs, chercheurs et autres, ont accepté de contribuer à cet ouvrage collectif pour mieux cerner les enjeux de la crise syrienne. C'est parce que je m'intéresse moi-même de très près au conflit syrien depuis six mois (voir ici) que j'ai fait l'acquisition de cet ouvrage, qui me semblait important.
Les éditeurs rappellent en introduction qu'évaluer les "printemps arabes" se heurte non seulement à la spécificité nationale, mais aussi à l'infléchissement politique de ces derniers. La violence est réapparue, à la fois dans les régimes autoritaires qui cherchent à maintenir ou à reconquérir leur pouvoir, mais aussi chez ceux qui les combattent. Ceux qui prédisaient l'émergence d'une nouvelle société civile semblent aujourd'hui bien "défaits" -tout est relatif- par ceux qui, au contraire, annonçaient une dérive sectaire que l'on peut apercevoir en Syrie. Le livre se construit en deux grandes parties : la première vise à faire comprendre la spécificité du contexte syrien, d'abord, la seconde le caractère régional et international, ensuite, de la crise. Seul bémol au propos, comme le rappel le duo d'éditeurs : les contributions ont pour la plupart été écrites au printemps 2013, en tout cas avant l'été, l'engagement massif du Hezbollah, les attaques chimiques du 21 août et l'offensive rebelle en pays alaouite. Le conflit progresse, évolue, et les événements les plus récents ne sont donc pas pris en compte.
Pour François Burgat, la fabrication de la guerre civile tient d'abord à la capacité du régime à diviser pour mieux régner, le tout appuyé sur une répression impitoyable. L'équipe dirigeante au pouvoir, renouvelée par Bachar depuis son accession au sommet en 2000, a été moins démunie que d'autres pour faire face à la révolution. Dès après les manifestations de Deraa, le régime commence à jouer la carte de la confessionnalisation. Or, au départ, la contestation a été loin de se limiter aux sunnites. Le régime invoque une "punition" infligée, par djihadistes interposés, par l'Occident, pour son soutien à l'Iran et au Hezbollah. Bachar se rallie ainsi les alaouites, les chrétiens, tandis que les Druzes restent neutres ; les Kurdes sont instrumentalisés pour ne pas rallier l'opposition. Il faut dire que la composition de la société syrienne est très différente d'autres pays des "printemps arabes" ; seul l'autoritarisme du régime a maintenu la coexistence confessionnelle. Le régime libère sciemment des prisonniers de droit commun ou des djihadistes emprisonnés depuis les années 2000 pour faire évoluer l'insurrection. La crise syrienne a la particularité de s'être rapidement internationalisée. Damas a su se construire un rempart diplomatique, à l'inverse de la Libye. Russie, Hezbollah et Iran sont des soutiens de poids. En outre, les régimes rescapés des "printemps arabes" n'ont pas perdu voix au chapitre, comme le montre l'exemple égyptien. Bachar réunit ainsi ses amis et les ennemis de ses ennemis. Et les Occidentaux n'ont pas soutenu suffisamment l'opposition pour lui permettre de l'emporter sur le plan militaire. Il faut dire aussi, comme le montre Wladimir Glasman, que l'appareil sécuritaire est un des piliers du régime. Depuis les massacres de Hama, l'armée et surtout les services de renseignement sont fondamentaux dans la survie du régime. Les moukhabarat ont progressivement supplanté le parti Baas et se sont complexifiés : Sécurité militaire, Sécurité aérienne, Sécurité générale, Sécurité politique, rivaux, mais omniprésents. En 2005, il y avait peut-être 65 000 agents permanents et des centaines de milliers d'autres à temps partiel - 1 pour 257 habitants. L'armée est elle-même surveillée et en 2011, elle se contente d'ouvrir la voie aux renseignements qui mènent la répression. Les alaouites sont majoritaires dans l'appareil de renseignement, mais aussi dans la Garde Républicaine, les prétoriens du régime, même si ce n'était pas forcément le cas sous Hafez el-Assad, qui avait su s'entourer de sunnites, comme Mustapha Tlass. Bachar, depuis 2000, a resserré les rangs et mobilisé tous les moyens pour s'imposer sur le plan médiatique. Dès 2011, avec l'aide de l'Iran, le régime dispose d'une armée électronique pour pister les opposants, diffuser de fausses rumeurs pour discréditer les manifestants et effrayer les autres. Il contrôle l'accès au terrain des journalistes étrangers, met en avant les chrétiens face aux médias occidentaux. Si l'armée est engagée tout de suite, c'est qu'elle seule a les moyens de montrer au monde que le régime tient le pays. Les moukhabarat ciblent d'abord les activistes politiques de longue date, et commettent des crimes atroces à des fins évidentes de dissuasion. L'engagement des milices dites shahibas confirme l'orientation répressive et sectaire du régime.
Pour François Burgat et Romain Caillet, le régime a agité dès le début l'épouvantail de la confessionnalisation et de la radicalisation djihadiste, bien commodes pour s'ériger en "rempart contre l'islamisme". Les sunnites, qui constituent 75% à 80% de la population, ont joué un rôle important dans les premières manifestations via les mosquées. La religiosité plus prononcée des sunnites les ont aussi désignés comme cibles, très rapidement, par le régime, qui se souvient de Hama. Au sein du champ islamiste des rebelles, il y a en réalité plusieurs composantes. Certaines formations se rapprochent des Frères Musulmans. On trouve les salafistes, eux-mêmes divisés. Les quiétistes rejettent toute forme d'action armée ou d'engagement politique. Mais ils ont pris les armes en 2011 dans une logique minimale : contre le régime syrien. Les djihadistes, au contraire, Syriens ou étrangers, ne voient le pays que comme un champ de bataille du djihad. La militarisation de l'insurrection, avec la formation de l'Armée syrienne libre (ASL), a accentué la confessionnalisation sunnite de la résistance. Il faut dire aussi que la Syrie se distingue des autres pays des "printemps arabes" par le fait que le pouvoir n'avait pas composé politiquement avec les sunnites, traitant toute manifestation de religiosité par la force. En outre, en 2011, le traitement des manifestants par l'armée a été différent selon la confession. Les pertes humaines le reflètent. La guerre a contribué à exacerber la religiosité des sunnites. Les salafistes dit "inclusifs" ont pris les armes mais ne pratiquent pas la stigmatisation ou l'exclusion confessionnelle (Abdelkader Saleh, par exemple, le défunt chef de Liwa al-Tawhid). Il y a en revanche d'autres groupes qui pratiquent un confessionnalisme plus sectaire. Le tableau est compliqué par le fait que le régime a développé, au début, des groupes radicaux factices pour décrédibiliser l'opposition ; il l'a déjà fait au Liban ou en Irak pour servir ses intérêts. Les djihadistes, quant à eux, débordent le cadre syrien : ils veulent construire un Etat religieux transnational. Ils se caractérisent par une proportion plus importante de volontaires étrangers et par le recours à l'attentat suicide. Ils emploient abondamment, dans leurs discours et leurs écrits, une terminologie sectaire. La montée en puissance du front al-Nosra, de janvier 2012 jusqu'à avril 2013, témoigne de leur force. Ils se sont imposés sur le terrain dès la bataille d'Alep à l'été 2012. Leur expérience tactique, leur professionnalisation, leur motivation et surtout leur intégrité, pour les populations civiles, ont fait la différence. En face, Bachar el-Assad a lui aussi mobilisé l'étendard religieux et des milliers de combattants chiites, au printemps 2013, sont accourus pour défendre le régime. Les alaouites de Turquie, de l'ancienne province de Hatay cédée en 1939, dirigés par Mihrac Ural, s'en sont pris aux camps de réfugiés syriens et ont probablement commis des massacres sectaires en Syrie. Si victoire de l'insurrection il y a, elle se fera donc, probablement, sans le soutien occidental. Matthieu Rey montre que la révolte, au départ, dans les quartiers, n'est pas confessionnelle, et même ensuite, en 2012, les minorités sont partagées. Les lieux de la construction historique du parti Baas sont devenus des foyers de révolte ( Derra, Deir es-Zor, Lattaquié) et la répression démesurée décrédibilise complètement la violence régalienne. Thomas Pierret explique combien les oulémas avaient gagné en puissance dans la décennie précédant la guerre civile, qui a ébranlé leur autorité. Les baasistes ont systématiquement exclu les oulémas du pouvoir et ont mis en avant, après les massacres de Hama, ceux qui avaient été d'une loyauté sans faille. La fragilisation du pouvoir syrien dans les années 2000 avait amené celui-ci à faire quelques concessions. Revigoré à partir de 2008, le régime tente de reprendre le contrôle des religieux. Dans les villes rebelles, les oulémas rejoignent rapidement les rangs de l'insurrection. A Damas et Alep, relativement préservées jusqu'en 2012, les oulémas se sont divisés entre loyalistes et rebelles. De jeunes oulémas prônent le réformisme politique. Certains, anciens alliés du régime, se sont également retournés contre lui. La bourgeoisie sunnite, qui a peur de perdre beaucoup à la faveur de la guerre civile, a fourni nombre d'oulémas qui se réfugient par contrecoup dans un prudent attentisme. L'espace vide est investi par les salafistes, exilés ou à l'étranger, traditionnellement rejetés. La scène religieuse est donc devenue plus ouverte et plus fragmentée. Caroline Donati présente le "Groupe de non-violence de Daraya", au sud de Damas, un mouvement réformiste islamique non-violent. Les chababs (jeunes) de Daraya se retrouvent autour de la mosquée Anas Ibn al-Malek et partagent la morale soufie, l'islam salafiste, un certain égalitarisme et une philosophe politique, les rendant inclassables pour les soufis et le régime. La répression les oblige à la clandestinité, voire l'exil. La militarisation de l'insurrection leur fait jouer un rôle de modération des combattants, même si leur expérience reste très localisée. Les oppositions syriennes, comme le montre Nicolas Dot-Pouillard, restent divisées. Non pas en raison de la coupure intérieur-extérieur, peut-être moins prononcée qu'on ne le dit. Mais parce que les buts de guerre ne sont pas définis : quelle stratégie pour mettre à bas le régime ? La militarisation du conflit depuis 2012 rend la négociation avec le régime beaucoup plus compliquée, car elle ravive des lignes de fracture, d'autant que le régime a repris l'ascendant au printemps 2013, ce qui écarte la possibilité de négociations d'égal à égal. La question de la lutte armée elle-même fait débat. La Coalition Nationale Syrienne reste ainsi une coquille d'opposition fantômatique. Le régime, quant à lui, a fait la preuve de sa résilience. Bruno Paoli revient sur les alaouites, 10 à 12% de la population, minoritaires sur le plan national, mais majoritaire dans la "montagne alaouite". L'origine historique du groupe, entre les Xème et XIIIème siècle, est mal connue. Ils survivent à la répression des puissances régionales, comme les Mamelouks, puis les Ottomans. Le mandat français (1920-1946) leur donne la première occasion de s'émanciper, par la création d'un éphémère état alaouite et l'engagement dans l'Armée française du Levant. L'indépendance de 1946 ne les sort pas de leur position marginale. En revanche, ils investissent massivement le parti Baas et l'armée. A partir de la prise du pouvoir d'Hafez el-Assad en 1970, le régime est plus celui d'un clan et d'une clientèle que des Alaouites à proprement parler. Les fidèles contrôlent l'appareil sécuritaire ; depuis la mi-2012, le gouvernement est majoritairement alaouite, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. L'intégration des alaouites dans le tissu social syrien est récente. La communauté a souffert des réformes de Hafez, préoccupée par "l'assimilation". L'Etat a même encouragé la création de mosquées, y compris dans les pays alaouites. Mais l'identité alaouite reste fondée sur le complexe minoritaire, la peur de domination sunnite, vue comme islamiste. Il semble bien qu'avant Deraa, une première manifestation ait eu lieu à Banias, en plein pays alaouite, en mars 2011, avec participation de membres de cette minorité. Malgré la carte confessionnelle jouée par le régime, pour souder les rangs, Assad n'a pas que des amis dans sa propre communauté. En mars 2013, une réunion d'opposants alaouites a été organisée au Caire. Malgré cela, les exactions commises dans les deux camps ont renforcé les fractures. Et les alaouites sont présents aujourd'hui dans les grandes villes : une bande côtière refuge paraît donc un peu illusoire, d'autant qu'elle aurait besoin d'un hinterland, la région de Homs, où les combats sont justement les plus acharnés. Et les alaouites restent attachés à l'unité de la Syrie. Arthur Quesnay et Cyril Roussel expliquent pourquoi les Kurdes syriens sont une communauté unie sur des spécificités culturelles et sociales, mais divisée sur les plans politique et territorial. Ils constituent 10% de la population mais sont répartis entre trois zones de peuplement, sans continuité territoriale. Avec qui se battre, et contre qui ? Depuis la fin du mandat français, les pouvoirs en place n'ont pas eu la même stratégie à l'égard des Kurdes. La répression a été très vive dans les années 1960. Le sentiment communautaire est renforcé par la marginalisation ou l'instrumentalisation, déjà sous Hafez el-Assad, de la communauté kurde. Le Parti Démocratique du Kurdistan, dès sa création en 1957, est réprimé, d'autant plus que Damas soutient ensuite le PKK contre la Turquie, jusqu'en 1998-1999. Les mouvements sociaux kurdes prennent alors le relais des partis politique, ce qui débouche sur une mobilisation spontanée à Qamishli en 2004. C'est ce qui se produit encore en 2011, et les Kurdes se mobilisent dans une logique nationale, et non communautaire. Mais la stratégie communautaire du régime et le refus du dialogue avec les Kurdes de l'insurrection sunnite a confessionnalisé les rapports. Dès l'automne 2011, le Parti de l'union démocratique (PYD), branche syrienne du PKK réfugiée en Irak, revient en Syrie et fait sentir son poids. Pour lutter contre cette hégémonie, le Conseil National du Kurdistan Syrien est créé dès octobre 2011 avec l'appui du Kurdistan irakien. Le PYD utilise la force militaire pour mettre en avant son objectif autonomiste. Il négocie avec le régime pour réinvestir les trois zones de peuplement kurde, neutraliser la contestation et éloigne les rebelles. Le régime s'est volontairement retiré et le PYD a rempli le champ devenu vide. En plus de l'YPG, sa branche militaire, le PYD tente de bâtir le contrôle administratif des territoires sous son contrôle, non sans mal. Dans le Golan, annexé par Israël en 1981, près de 15 ans après sa conquête, les 20 000 Druzes ont été secoués par la révolution. Mounir Fakher Eldine rappelle que le Golan est agité comme une Alsace-Lorraine par le clan Assad dès 1973. Les premières manifestations en 2011 ont provoqué une réaction du régime, qui a tenté par tous les moyens de les museler. Sans y parvenir complètement. Samir Aïta propose les fondements socio-économiques qui ont poussé à la révolte : c'est le symbole pour lui d'un "tsunami des jeunes" dans les petites villes et les banlieues des grandes métropoles, de la politique migratoire entraînée par la sécheresse, et de la libéralisation économique depuis 2005, le tout accru par l'arrivée massive de réfugiés irakiens en 2006-2007. Les raisons sont donc multiples. En outre les sanctions internationales ont perturbé le commerce extérieur mais paradoxalement renforcé des mécanismes qui alimentent le régime, et ont affaibli l'opposition. La société syrienne est épuisée : elle comptait déjà au moins 12% de personnes sous le seuil bas de pauvreté et 34% sous le seuil haut, surtout au nord et à l'est, premières zones "libérées". Le pays ne tient plus que par les aides extérieures, de part et d'autre.
Cécile Boëx entame la partie sur les nouveaux d'action et de mobilisation en parlant de la vidéo. Les manifestations spontanées, en 2011, se sont progressivement organisées et ont incorporé des enregistrements audiovisuels. Comme il n'y a pas de journalistes sur le terrain, les protestataires jouent un rôle important. La dimension sacrificielle est souvent mise en avant. Le sit-in féminin à domicile, en particulier dans les grandes villes où il est risqué de manifester, est devenu populaire. La vidéo filme des actes symboliques contre le pouvoir, sert à transmettre des méthodes. Les groupes armés, après la militarisation, utilisent beaucoup la vidéo pour faire des annonces officielles (défections, etc). Mais l'arme est à double tranchant. L'armée électronique du régime surveille ces vidéos, même si le régime lui mise avant tout sur les médias qu'il contrôle de longue date. Les stratégies de communication et de diffusion sont donc différentes selon les acteurs. Les slogans aussi ont leur importance dans la révolution : Jamal Chehayed en a rassemblé un échantillon. L'appartenance religieuse, la dénonciation du régime, le retournement de ses propres slogans en font partie. Les chants aussi, selon Simon Dubois, se construisent selon un discours élaboré. Les mélodies populaires, par exemple, sont systématiquement réutilisées. Gilles Dorronsoro, Adam Baczko et Arthur Quesnay, qui sont allés en Syrie, ont étudié les institutions du gouvernorat d'Alep. Les rebelles essaient en effet de créer des institutions dans les zones libérées. En janvier 2013, il n'y avait pas de fragmentation territoriale entre groupes armés, et les insurgés ont un imaginaire très marqué par l'Etat. Les groupes armés ont survécu dans les zones où le régime était faible, des régions sous-administrées, loin des villes et près des frontières. Le conflit change d'échelle à l'été 2012 avec la prise de toute la zone frontalière avec la Turquie. Un groupe comme Liwa al-Tawhid, qui apparaît justement à ce moment-là, est forcé de créer des institutions plus centralisées. La première autorité mobilisée est la justice, qui devient un travail collectif. Un tribunal civil est créé à Alep à l'été 2012, suivi d'une police civile et d'une police militaire. Mais des cours locales ont résisté à l'intégration. Le problème est que les institutions manquent de ressources et sont dépendantes de l'extérieur ; en outre, certains groupes comme le front al-Nosra n'y participaient pas. La question humanitaire, en Syrie, est devenue majeure. Laura Ruiz de Elvira Carrascal rappelle qu'au moins 7 millions de Syriens ont besoin d'une aide humanitaire. A l'été 2013, on comptait déjà 4 millions de personnes déplacées et au moins 2 millions de réfugiés, dont 1,2 millions en Jordanie. La solidarité locale, la diaspora syrienne et les organisations humanitaires s'activent, mais la prise en charge des réfugiés par les pays voisins est difficile, et risque d'entraîner des déstabilisations.
Vincent Geisser montre pourquoi le Liban est sans doute le plus exposé aux effets déstabilisateurs du conflit syrien. La répercussion est paradoxale, car anxiogène, mais aussi fédératrice, autour d'un renouveau du discours national libanais. Si le gouvernement s'est largement dissocié de la guerre en Syrie, il n'en demeure pas moins que certains acteurs libanais utilisent à leur profit le conflit. C'est plus d'ailleurs une question politique que confessionnelle. Rien ne le montre mieux que les positions différentes des chrétiens. Le général Aoun soutien ainsi le régime, au nom de la défense de l'Etat et de l'hostilité au communautarisme. Le nouveau patriarche maronite du Liban, élu en mars 2011, au début de la révolution, a été accusé d'avoir une posture favorable au régime syrien. Les partis chrétiens du 14 mars (Forces libanaises et Kataeb), au contraire, soutiennent les insurgés. On voit bien que les stratégies sont plus politiques que confessionnelles, même si ce dernier facteur est bien présent. Les sunnites libanais, quant à eux, développent une stratégie de minorité active. La menace fantasmée d'une invasion chiite et l'antagonisme historique ne s'illustrent nulle part ailleurs mieux qu'à Tripoli. Le courant salafiste, qui se modèle d'ailleurs sur le Hezbollah, a trouvé l'occasion de s'affirmer avec la guerre civile syrienne et déborde le clan Rafiri. La stratégie des sunnites, minorité active, reproduit celle des mouvements chiites Amal et Hezbollah dans les années 1980 et 1990. En face, les soutiens d'Assad sont hétéroclites. Le Hezbollah distingue astucieusement, dans son discours, "bonnes" et "mauvaises" révolutions, ce qui justifie le soutien au régime, tout comme la mise en scène de la "menace salafiste". De nombreux groupuscules pro-régime s'activent au Liban : la branche libanaise du Parti Baas, le Parti Syrien National Social, le Parti Démocratique Arabe de Tripoli et sa milice, les Chevaliers Rouges. La guerre civile syrienne renforce le statu-quo au Liban ce qui n'empêche pas nombre d'habitants de se dire qu'ils sont passés à côté des printemps arabes... La réaction irakienne initiale, ambigue, à la révolution syrienne, reflète les divisions profondes de la société. Les dirigeants étaient parmi les seuls à penser en 2011, néanmoins, que le conflit durerait et affecterait la scène régionale. Les Kurdes d'Irak se retrouvent fragilisés par la crise syrienne. Les sunnites irakiens, qui soutiennent majoritairement l'insurrection, sont tentés entre l'appartenance nationale ou confessionnelle. En outre, le conflit syrien a relancé l'EII, devenu en avril 2013 l'EIIL, et le cycle de violences est revenu dans certaines provinces irakiennes. Enfin, l'Irak accueille au moins 200 000 réfugiés syriens et voient les anciens réfugiés irakiens revenir sur son sol, en raison du conflit... La Turquie, après le désamorçage de l'épineuse question du PKK en 1999, s'était rapprochée de la Syrie, jusqu'en 2011. Elle attend en conséquence l'été 2011 avant de couper les ponts, constatant l'échec de négociations ou de mains tendues. Le pays accueille au moins un demi-million de réfugiés, non sans mal, d'autant que les alaouites du Hatay ne les considèrent pas comme les bienvenus... Ankara suit aussi de près le devenir des Kurdes syriens. Le régime a cependant survécu, et tous les liens n'ont pas été coupés. La Turquie a ainsi pris le contre-pied de sa stratégie d'avant la révolution, qui la faisait se démarquer des pays occidentaux. Elle a également renforcé les liens avec les pays du Golfe (le Qatar) et même avec l'Egypte de Morsi, jusqu'à sa chute. Mais le conflit syrien divise aussi l'opinion publique turque. Le mouvement palestinien est entrelacé avec le devenir de la Syrie : plus de 500 000 Palestiniens y vivent comme réfugiés, et l'opposition à Israël est commun aux deux entités. Pendant la guerre au Liban Hafez el-Assad a pourtant affronté l'OLP, avant que l'axe de la résistance ne reprenne ses droits dans les années 1990-2000. Dès mars 2011, de jeunes Palestiniens participent au mouvement de contestation, et la fracture s'étale au grand jour dès le mois de juin. En 2012, le Hamas rompt avec le régime syrien et quitte le pays, tandis que le FPLP-Commandement Général, lui, combat aux côtés de l'armée. Le Jihad Islamique, contrairement au Hamas, est plus favorable au régime, au nom de la lutte contre Israël. Le rapport à Israël détermine donc pour bonne part le positionnement. Quoiqu'il en soit, les Palestiniens apparaissent, plus que jamais, divisés par le conflit. Pour l'Iran, d'après Bernard Hourcade, l'acte fondateur de la relation avec la Syrie est le soutien que celle-ci lui apporte dès 1982 dans la guerre contre l'Irak. La dimension religieuse est réelle, mais marginale : l'alliance est avant tout politique. Au départ, l'Iran n'est pas hostile aux printemps arabes, même si les islamistes de la force Qods des Gardiens de la Révolution et autres s'activent pour relancer leur discours politico-religieux. Ce n'est qu'après le soutien de plus en plus prononcé de l'Occident puis des pays du Golfe que l'Iran soutien sans réserve le régime syrien, plus sur une logique nationaliste qu'islamiste. L'élection du président Rohani en juin 2013 conforte le camp de ceux qui pensent que la crise syrienne est l'occasion de négociations, et non d'un affrontement. Car la stabilité de la région dépend aussi de la capacité des deux acteurs régionaux majeurs, l'Iran et l'Arabie Saoudite, à négocier. La Jordanie, souligne Jalal al-Husseini, a été lourdement affectée par la guerre en Syrie : refugiés nombreux, économie en berne. Les réfugiés sont regardés, depuis l'été 2012, avec davantage d'hostilité. La Jordanie maintient un discours d'équilibre, mais le roi Abdallah, en novembre 2011, avait été le premier chef d'Etat à demander le départ de Bachar el-Assad. Depuis avril 2013, la Jordanie laissait acheminer des armes via son territoire, et penchait ainsi plutôt du côté des rebelles, mais la posture pourrait bien changer.
Nicolas Dot-Pouillard montre que même un journal comme Al-Akhbar, favorable au Hezbollah dans la scène libanaise, a connu des tensions, car l'équipe voulait donner la parole aux opposants du régime syrien. Les gauches arabes, de la même façon, sont clivées : elles demandent le départ d'Assad mais restent sceptiques sur le soutien apporté par les monarchies du Golfe à l'insurrection. La solution, pour elles, est politique, et pas militaire. La dynamique islamiste dans certains pays des printemps arabes a refroidi bien des ardeurs. D'autant que le régime syrien passe encore pour le camp de l'anti-impérialisme. Alain Gresh pense que la crise syrienne illustre surtout l'incapacité des Etats-Unis et des autres pays occidentaux à emporter l'adhésion de la communauté internationale, notamment en raison du recul de l'influence américaine et de la montée en puissance d'autres acteurs. Les pays émergents ont montré une grande méfiance face à un processus qui apparaît pour eux dominé par les Etats-Unis et les pays occidentaux. La Russie cherche à retrouver son statut de grande puissance, mais elle est liée aussi, historiquement, à la Syrie. Et le précédent libyen a laissé des traces à Moscou. La Russie retrouve sa place sur la scène diplomatique. La Chine, qui n'a pas d'intérêts majeurs en Syrie, est dans le sillage de la Russie. Claire Beaugrand souligne quant à elle qu'une lecture confessionnelle du rôle de l'Arabie Saoudite et du Qatar serait pour le moins réductrice. D'autant que les pays du Golfe étaient plutôt en bons termes avec la Syrie avant 2011. Pour l'Arabie Saoudite, la Syrie faisait contrepoids à l'Irak jusqu'en 2003. Le Qatar, lui, s'est installé à la faveur des crises au Liban et via le soutien de la France, en 2006 et en 2008. La violence de la répression du régime en 2011 change la donne. L'Arabie Saoudite tente d'abord d'éviter la contagion révolutionnaire puis d'encadrer l'aide aux rebelles. Le Qatar cherche lui à se positionner comme intermédiaire entre l'Occident et l'islamisme. Le Qatar, qui soutient les Frères Musulmans, agit plus ouvertement que l'Arabie Saoudite. Critiqué pour son aide militaire et la construction de l'opposition extérieure, le Qatar a été marginalisé, à l'été 2013, par l'Arabie Saoudite, qui reprend le flambeau. L'aide saoudienne arrive d'ailleurs plutôt par le sud. Le Qatar perdra peut-être son rôle d'acteur régional ; l'Arabie Saoudite, elle, peut sortir renforcé de la crise syrienne. On compte de 10 à 15 millions de Syro-Libanais en Amérique latine, au Brésil, en Argentine et au Vénézuela essentiellement. Bachar el-Assad a réactivé les liens par une tournée tonitruante dans ces trois pays en juin 2010. Majoritairement, les communautés en exil ont pris position en faveur du régime syrien, notamment au Vénézuela, au nom d'une vision anti-impérialiste de l'histoire. Au Brésil, le soutien est plus discret. En Argentine, la présence d'une forte et ancienne communauté alaouite et l'influence du Parti syrien national social ont incontestablement joué. La diplomatie syrienne a continué les visites en 2012. Comme l'Iran, la Syrie maintient donc une présence en Amérique latine, ce qui entraîne en retour une certaine politisation des communautés en exil.
Incontestablement, et malgré l'absence d'une conclusion, l'ouvrage fera date. C'est sans doute, en français, la meilleure synthèse sur le conflit syrien entre 2011 et l'été 2013. Comme tout ouvrage collectif, il est parfois inégal, mais sur les 25 contributions, nombre d'entre elles valent le détour. La première partie, "La fabrication de la guerre civile", qui occupe les deux tiers de l'ensemble, se concentre sur le contexte syrien. C'est sans doute la plus inégale, mais on y trouve d'excellents articles, comme celui sur les ressources sécuritaires du régime, sur les alaouites, en particulier. Globalement, la deuxième partie, plus réduite, est plus efficace, en dépit du manque de place pour certains articles qui réduit les contributions. La remise en perspective de l'impact de la crise au Liban, le rôle de l'Irak ou de la Turquie, la place de l'Iran ou de l'Arabie Saoudite et autres monarchies du Golfe, celle des diasporas, sont remarquablement bien analysées. On aurait peut-être souhaité davantage de place consacrée à l'insurrection armée, qui finalement n'apparaît que dans un seul article, ce qui est peu. Globalement, aussi, la situation militaire est relativement évacuée : il est vrai qu'elle est complexe, que le conflit est encore en cours, mais il y avait à dire, et ce dès le printemps 2013, de nombreux articles ou ressources étaient disponibles. Il est dommage que l'article sur les ressources sécuritaires n'ait pas été prolongé par un autre sur les forces militaires du régime. Les absents sont aussi les volontaires étrangers, dans les deux camps, évoqués dans le même article que l'insurrection, mais finalement non abordés en soi. Mis à part ce léger bémol, on ne peut que saluer l'effort accompli, qui aide à mieux cerner les acteurs et les défis de la crise, comme l'annonçait le sous-titre.
↧
All men are brothers (Dong kai ji) de Cheh Chang et Ma Wu (1975)
Chine, sous la dynastie Song. Les 108 bandits, qui combattaient les officiers corrompus du pouvoir, obtiennent leur pardon de l'empereur. Celui-ci les envoie combattre un usurpateur, retranché dans la forteresse de Hangzhou. 7 volontaires s'infiltrent dans la ville, puissamment défendue, pour servir d'espions et trouver un moyen de faire pénétrer l'armée de l'empereur dans la place. Mais l'un d'entre eux, Tornade Noire, ne peut s'empêcher d'attaquer les soldats de l'usurpateur : découverts, les 7 hommes sont pris au piège dans la ville. Un seul d'entre eux parvient à gagner l'extérieur pour donner les informations nécessaires à la victoire de l'armée impériale...
All men are brothers (parfois aussi appelé Seven Soldiers of Kung Fu), sorti en 1975, suit de trois ans Water Margin (La Légende du Lac), du même réalisateur, avec les mêmes acteurs. Le tout est inspiré d'une légende chinoise (les 108 bandits) et d'un roman-fleuve, Water Margin. Les deux volets ont en fait été tournés l'un après l'autre, mais décalés dans leur sortie sur grand écran. On arrive quand même à s'y retrouver sans avoir vu le premier épisode, d'autant qu'un petit moment du film, après l'introduction, mentionne les épisodes qui se sont déroulés entretemps. La trame de l'histoire est donc le rachat des 108 bandits qui se mettent au service de l'empereur Song pour affronter l'usurpateur Fang La.
Originalité du film dans le genre wu xia pian, quasiment toutes les scènes se déroulent en extérieur, avec la ville fortifiée comme décor. On reste fidèle au genre avec énormément de combats, entre quelques-uns des 108 bandits (les 7 infiltrés dans la ville plus d'autres à l'extérieur) et une débauche de figurants, qui opèrent à mains nues ou avec armes blanches. Le scénario n'est par conséquent par très épais, et le studio Shaw Brothers en rajoute dans les effets sanguinolents, comme lors du combat final contre l'usurpateur où le plus brave des 108 bandits combat avec un bras en moins (!). A noter que John Woo avait participé comme assistant réalisateur à Water Margin, mais n'est pas présent pour All men are brothers. Bref, un film dans la lignée des Shaw Brothers à conseiller aux amateurs du genre, ou à ceux qui veulent se détendre après un bon soir de travail (comme moi).
↧
Steven J. ZALOGA et Hugh JOHNSON, T-54 and T-55 Main Battle Tanks 1944-2004, New Vanguard 102, Osprey, 2004, 48 p.
Ce volume de la collection New Vanguard d'Osprey, qui se focalise sur l'étude du matériel militaire, est encore une fois signé Steven Zaloga, le spécialiste de l'Armée Rouge et du matériel soviétique (en plus d'être également un bon connaisseur du matériel américain). Et pour cause : il s'agit ici de traiter la série des chars T-54/T-55, qui a été aussi répandu à travers le monde depuis la guerre froide que le fusil d'assaut AK-47, dont le créateur est mort récemment. On les retrouve encore sur les champs de bataille de la guerre en Syrie, dans les deux camps.
Au départ, c'est un bureau de dessin de l'usine n°173 de Nijni-Tagil, qui produit le T-34, et qui décide de trouver un remplaçant au T-34/85, dès 1944. On prend comme base le T-34, surblindé à l'avant en enlevant le mitrailleur de caisse, toujours armé d'un canon ZIS-S-53 de 85 mm. Le T-44, qui approche le Panther en termes de performances, ne fait que 65% du poids de ce dernier. 20 exemplaires sont produits en 1944 à l'usine de Kharkov réinstallée, 965 en 1945 et 1 823 en tout jusqu'en 1947.
Dès 1944, on a cependant testé sur le prototype du T-44 des canons plus gros, de 100 puis 122 mm. L'Obiekt 137, lancé en 1945, adapte la tourelle pour embarquer le canon de 100 mm et porte le blindage frontal à 200 mm. Le nouveau T-54 est complété à Nijni-Tagil fin 1945 : bon pour le service en avril 1946, l'usine de Nijni-Tagil le produit dès 1947 et celle de Kharkov l'année suivante. Malgré tout, des problèmes de jeunesse font que la production du T-34/85 prend le pas jusqu'en 1950. Le premier T-54 embarque en effet presque deux fois moins d'obus. La tourelle est redessinée, les mitrailleuses SG-43 de côté remplacées par des mitrailleuses incorporées au char, des chenilles plus larges sont adoptées. Une troisième usine, à Omsk, se consacre à la production. Le T-54 modèle 1951 est produit à 11 700 exemplaires. Le T-54A bénéficie des observations faites sur les Sherman du Lend-Lease et sur les M26 ou M46 capturés en Corée, notamment pour un stabilisateur amélioré afin de mieux tirer en mouvement. La Pologne et la Tchécoslovaquie, avec l'autorisation de Moscou, remplacent la production des T-34/85 par celle des T-54 : 2 855 sont produits par la première jusqu'en 1964 et plus de 2 500 pour la seconde jusqu'en 1966. La Chine copie aussi le T-54A sous le nom de Type 69. De nombreuses versions sont développées à partir du char, qui reçoit aussi des améliorations, comme une mitrailleuse antiaérienne de 14,5 mm sur la version M. En tout, plus de 40 000 T-54 sont construits (24 750 en URSS, 5 465 dans les pays alliés, 9 000 en Chine), sans compter les versions spécialisées sur châssis.
Le T-55 répond au besoin d'un char capable de survivre à un champ de bataille "vitrifié" par des explosions nucléaires. Accepté en mai 1958, il est produit jusqu'en 1962. Le temps de production est court car un officier iranien fait défection avec son M60A1 en janvier 1961 et les Soviétiques, impressionnés par le nouveau canon de 105 du char -lui-même tiré des observations faites sur le T-54 en Hongrie pendant la révolte de 1956-, développent un T-55 armé d'un nouveau canon de 115 mm, qui deviendra le T-62. Seule l'usine d'Omsk continue à produire le T-55 jusqu'en 1977, notamment pour l'exportation. Au total, plus de 30 000 chars sont produits en URSS, 7 000 en Pologne de 1964 à 1979, la Tchécoslovaquie plus de 8 500 de 1958 à 1982 et 400 en Roumanie. La durée de vie des chars étant assez courte (il faut une révision complète après 7 000 km), les régiments de chars soviétiques ne font participer qu'une partie des chars aux entraînements pour conserver leur capacité de combat : tous les dix ans, la révision a lieu dans les usines prévues à cet effet, à Kiev, Lvov et Kharkov. LesT-54 sont progressivement portés au standard M et les T-55 reçoivent aussi des améliorations dans les années 1970.
Sur les deux modèles de chars, l'Armée Rouge développe des chars lance-flammes et des engins de déminage. Sous Khrouchtchev, obsédé par l'avènement des missiles antichars, les Soviétiques tentent de développer un char lance-missiles à Léningrad, à partir d'un T-55 : c'est le projet "Typhon". Il est abandonné en 1964. En 1988, les T-54/55 forment encore 36,5% du parc soviétique, les T-62 25%, et la proportion est encore plus importante dans les pays alliés. Suite à l'expérience en Afghanistan, où les T-55, nombreux dans les unités engagées, ont souffert des RPG et des mines, un programme de modernisation est lancé notamment pour améliorer la protection face à ces menaces. Les T-55M et AM bénéficient de nombreuses améliorations. Le projet Drozd prévoit un système de défense actif contre les missiles antichars avec des roquettes et un équipement électronique pour intercepter et détruire les missiles lancés contre le char en vol. Il n'est finalement adopté que par l'infanterie de marine soviétique, car le coût, élevé, est le même que s'il s'agissait de choisir des T-72. 250 exemplaires sont produits mais stockés. Le blindage réactif Kontakt fait partie des dernières améliorations apportées par les Soviétiques au T-55. Les Israëliens, qui en capturent dès 1967, développent leurs propres versions, les Tiran, avant d'utiliser le châssis du char pour le véhicule blindé Achzarit. L'Irak ou la Finlande développent aussi des versions modifiées, et l'usine d'Omsk tourne encore pour apporter des modifications à l'exportation. En Chine, le Type 59, copie du T-54, est produit dès 1958 dans une usine à l'ouest de Pékin, jusque dans les années 1980. Après avoir capturé un T-62 pendant les escarmouches contre les Soviétiques de 1969, les Chinois produisent le Type 69 qui ressemble plus au T-55. La Chine exporte le Type 59, notamment au Pakistan.
Le T-44 n'a pas été engagé au combat contre les Allemands. Le T-54 connaît son baptême du feu en 1956 lors de la répression de l'insurrection hongroise : plusieurs sont détruits dans les combats de rue à Budapest. Les Britanniques, qui ont observé le char, vont donc développer un nouveau canon de 105 mm. Plus de 20 000 T-54/55 sont exportés, plus 6 000 copies chinoises. L'Egypte et la Syrie emploient massivement ces chars pendant les guerres israëlo-arabes dès 1967, mais la qualité des équipages israëliens fait souvent la différence. Les blindés sont aussi de la partie dans les conflits entre l'Inde et le Pakistan, puis sont utilisés par le Nord-Viêtnam en 1972 et avec plus de succès en 1975. En Afrique, les Etats issus de la décolonisation emploient de préférence le T-55, bon marché. On le retrouve en Angola, au Tchad. En Amérique latine, il est même utilisé lors du conflit au Nicaragua ! L'Irak en dispose dans la guerre contre l'Iran, puis pendant les deux guerres du Golfe. Il sert aussi dans la guerre en Yougoslavie, dans le Caucase, bref, il est encore loin d'avoir disparu des champs de bataille...
Comme toujours, le format (une trentaine de pages à peine) permet surtout d'insister sur la dimension technique, la naissance et l'évolution du blindé. On reste sur sa faim par contre quant à l'utilisation du char sur le champ de bataille et le lien avec la doctrine soviétique, les conceptions d'emploi, etc. Néanmoins, cette petite base est solide, claire, avec une bibliographie d'ailleurs essentiellement russe, car il est vrai que même en anglais, les ouvrages sur les T-54/55 ne sont pas légion. Le tout complété par les illustrations habituelles.
↧
↧
Qiu XIAOLONG, Mort d'une héroïne rouge, Paris, Seuil, 2001, 502 p.
Shanghaï, 1990. Deux pêcheurs découvrent un cadavre de jeune femme dans un canal isolé à la périphérie de la ville. L'inspecteur Chen, étoile montante de la police locale, membre du parti, qui vient d'obtenir une promotion et un appartement indépendant, et poète à ses heures, et son adjoint, Yu, sont chargés de l'enquête. Malheureusement pour eux, l'affaire prend un tour politique quand ils découvrent que la décédée, Hongying, était une Travailleuse Modèle de la Nation. Une fille discrète et célibataire qui est pourtant morte étranglée après avoir eu des rapports sexuels. Ils vont vite découvrir qu'à Shanghaï, on peut facilement mener une double vie...
Qui Xiaolong est né à Shanghaï. En 1966, son père est arrêté pendant la Révolution Culturelle par les Gardes Rouges. En 1976, il entre à l'université et étudie la littérature anglo-américaine. Pendant les événements de la place Tienanmen, en 1989, il est aux Etats-Unis : associé aux opposants, il ne peut plus revenir en Chine. Il enseigne ensuite à la Washington University de St-Louis.
L'enquête policière de ce roman est surtout un prétexte à une bonne dose d'humour et de dérision concernant la Chine communiste de l'ouverture économique, mais du verrouillage politique. On y découvre plus sur la vie quotidienne des habitants de Shanghaï et celle de ses policiers que sur les fils d'une intrigue criminelle finalement assez légère. Il faut dire aussi que c'est le premier volume de la série (qui en compte 8 à ce jour), l'auteur prend donc le temps de camper son personnage principal, son univers et l'ambiance générale de son histoire. Rafraîchissant, en tout cas.
↧
Sur Facebook
Pour mémoire, je rappelle que vous pouvez suivre l'actualité du blog, de mes publications, coups de gueule et autres réflexions charmantes (mdr) sur la page Facebook du blog, cliquez sur l'image ci-contre pour y accéder et n'hésitez pas à "liker", ça fait toujours plaisir!
Idem pour la page du livre L'offensive du Têt, que je remets à jour depuis peu, cliquez sur l'image ci-dessous pour y atterrir. Le blog est progressivement actualisé également.
↧
Convoi vers la Russie (Action in the North Atlantic) de Lloyd Bacon (1943)
Pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pétrolier conduit par le capitaine Steve Jarvis (Raymond Massey) est coulé dans l'Atlantique Nord par un U-Boot. Jarvis et le premier officier, Joe Rossi (Humphrey Bogart), ainsi que quelques membres d'équipage, grimpent dans un canot. Quand l'équipage du U-Boot les filme, les marins invectivent les matelots allemands, qui éperonnent le canot. Les survivants sont secourus après 11 jours passés sur l'océan...
Convoi vers la Russie, réalisé en pleine Seconde Guerre mondiale, devait être au départ un documentaire. Mais avec les images de plus en plus nombreuses, la Warner en fait un film avec comme conseiller technique Richard Sullivan, un jeune officier de 23 ans dont le navire a été torpillé par un U-Boot. L'US Navy ayant interdit le tournage en mer en raison des risques, il a fallu tout faire en studio. Le film a d'ailleurs été intégré dans la formation des marins de la marchande en raison de son caractère pédagogique, sur certains points. D'authentiques avions allemands et soviétiques ont été utilisés pour le tournage.
Le film n'est sans doute pas un des plus fameux dans la carrière d'Humphrey Bogart. La dimension patriotique, évidente en contexte de guerre, est bien présente, mais on notera l'attention portée aux détails -comme l'insistance sur le fait de ne pas être trop bavard à terre pour les marins, afin d'éviter de transmettre des informations aux éventuels espions nazis. On insiste aussi sur la coopération interalliée, y compris avec les Soviétiques -certaines scènes ont même un air de convoi PQ-17... si le film est long, il ne peut tricher complètement avec la réalité, comme le montre les scènes où les marins de la Navy doivent former les marchands à l'utilisation des pièces d'artillerie montées sur le Liberty Ship. Et ce même si l'on distingue facilement les montages maquettes. A noter que Raoul Walsh et Don Siegel ont participé à la réalisation.
↧
Publication : Les deux faces de Janus. Les soldats américains à Joigny et dans l'Yonne (1944-1945)
Vous pouvez commencer à découvrir à partir d'aujourd'hui un article en plusieurs parties que j'ai signé pour une agence privée de valorisation du patrimoine de la ville de Joigny, dans l'Yonne : Au fil de Joigny.
Il est issu de la rencontre, assez fortuite, avec M. Bertrand Urban, le président de la société en question. Cet article porte sur un moment qui constitue en quelque sorte une "zone grise" dans l'histoire du département pendant la Seconde Guerre mondiale : l'après-libération jusqu'au départ des troupes américaines cantonnées dans l'Yonne après la fin de la guerre, d'août 1944 à décembre 1945. Plus précisément, la question était de voir comment s'était passée la cohabitation entre Français à peine libérés et tout juste soumis à l'autorité du Gouvernement Provisoire de la République Française, qui s'installe après la Libération, et soldats américains qui cantonnent dans l'Yonne à partir de ce moment-là. La première partie, que vous pouvez lire ici, présente rapidement le parcours du département pendant la guerre jusqu'à la Libération, afin de mieux comprendre ce qui suit.
Pour réaliser cet article, je me suis inspiré de travaux d'historiens tout à fait pertinents sur le sujet, et notamment la fameuse somme publiée par l'ARORY (Association
pour la Recherche sur l'Occupation et la Résistance dans l'Yonne) en 2006. Vous pouvez consulter la fiche de lecture de cette ouvrage que j'ai mise en ligne ici même, là. Je vous encourage à consulter le site de l'ARORY, que j'ai indiqué en lien ci-dessus, et qui offre des compléments tout à fait utiles à l'ouvrage ainsi qu'aux autres publications de l'association. La ville de Sens propose également en ligne le livret d'accompagnement de l'exposition permanente de l'ARORY, L'Yonne dans la Seconde Guerre mondiale, qui tourne dans le département : à télécharger ici.
J'ai également utilisé des ouvrages portant sur les unités américaines elles-mêmes, et notamment le livre de Stephen Ambrose sur la Easy Company, 2nd Battalion, 506th PIR de la 101st Airborne Division, puisque l'unité a stationné dans l'Yonne en 1945. Vous pouvez également trouver la fiche de lecture de cet ouvrage ici. L'article inclut également des témoignages américains collectés par mes soins et qui illustrent cette période de cohabitation en 1945.
J'aurais probablement l'occasion de revenir plus avant sur ce sujet dans les prochains jours. Bonne lecture !
↧
↧
L'autre côté de la colline : perdre la guerre froide (1/2) (Jérôme Percheron)
Jérôme Percheron, qui nous avait proposé un article sur une bataille de la guerre en Angola au début du blog collectif L'autre côté de la colline, récidive avec la première partie d'un article dédié à la guerre froide, vue sous un angle global. Il ne prétend pas à l'exhaustivité, c'est plutôt un rappel, basé sur certaines sources, du déroulement général de cette période importante, vue à travers les deux camps. Bonne lecture !
↧
Jean Lopez et Lasha Otkhmezuri, Joukov. L'homme qui a vaincu Hitler, Paris, Perrin, 2013, 732 p.
Avertissement :étant donné les réactions houleuses la dernière fois que j'ai évoqué un livre de Jean Lopez, sur la recension du livre de Jacques Sapir, La Mandchourie oubliée, je préfère prévenir de suite que tout commentaire malveillant sera mis sans autre forme de procès à la corbeille, car je n'ai pas envie de m'embêter avec ce genre de problème cette fois-ci. Avis aux amateurs : vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la recension, mais si vous voulez intervenir, vous le faites de manière constructive, argumentée sans polluer le billet. Merci d'avance.
Jean
Lopez, depuis quelques années, s'est imposé comme une référence
française incontournable sur l'histoire militaire du front de l'est
pendant la Seconde Guerre mondiale. Quasiment inconnu en 2008 à la
sortie de son premier livre sur Koursk chez Economica
(« ancien capitaine de la marine marchande, rédacteur en
chef d'un magazine de vulgarisation », selon le quatrième
de couverture), il est devenu, au rythme de quasiment un ouvrage par
an, Stalingrad, puis Berlin, un des « meilleurs
spécialistes français du conflit germano-soviétique »
(toujours selon le quatrième de couverture, celui du Berlin),
puis, avec sa deuxième édition du Koursk en 2011 et son ouvrage sur
la bataille de Korsun/Tcherkassy, « journaliste et
historien ». Car entretemps, en mars 2011, Jean Lopez a
lancé Guerres et Histoire, magazine de vulgarisation en
histoire militaire qui a rencontré un grand succès. Ce n'est
d'ailleurs plus comme historien qu'il se présente sur le quatrième
de couverture, mais comme fondateur et directeur de la rédaction de
Guerres et Histoire.
Le
choix du sujet de ce nouveau livre est habile. Il n'y a en effet
aucune synthèse française ou presque, récente, et même ancienne,
sur Joukov, l'un des principaux chefs militaires soviétiques de la
Grande Guerre Patriotique. Jean Lopez peut donc espérer facilement
combler un vide dans la bibliographie sur le sujet. Par ailleurs, le
manque patent de spécialistes français issus du monde universitaire
à propos de la dimension militaire du conflit germano-soviétique
peut augurer d'un bon accueil de la critique, ce qui s'est
effectivement produit, que ce soit dans la presse quotidienne ou
celle plus spécialisée, comme le magazine L'Histoire,
ou bien encore sur différents sites web. Or, comme les
ouvrages précédents, la biographie de Joukov par Jean Lopez, si
elle comporte d'incontestables qualités, souffre aussi de plusieurs
défauts, qui empêchent de la présenter comme la référence
« ultime », qualificatif que l'on emploie un peu
trop volontiers concernant ses livres – Jacques Sapir l'avait déjà
noté, en son temps, dans
sa recension du Berlin
.
L'avant-propos,
qui explique les enjeux la biographie, reflète cette contradiction.
On ne peut qu'aquiescer à l'idée selon laquelle le front de l'est a
été, indubitablement, le front essentiel du conflit. Idem pour la
confusion entre la vie de Joukov et celle du parti communiste et de
l'URSS jusqu'à l'époque de Brejnev. De même, l'une des questions
fondamentales qui se pose est bien de savoir comment Joukov a
surmonté la tension entre le besoin d'une armée efficace et les
entraves posées par le parti et la direction soviétiques, très
suspicieux à l'égard des militaires, considérés comme des
« bonapartistes » en puissance. Pour Jean Lopez,
Joukov a ce rôle ambigu d'avoir à la fois contribué au désastre
de 1941 tout en sauvant, pour ainsi dire, l'URSS de la défaite. Sa
biographie s'organise, de manière assez logique, en trois parties :
de la naissance à la Grande Guerre Patriotique, le conflit lui-même
et l'après-guerre jusqu'à la disparition en 1974. Il est d'autant
plus intéressant de s'attacher à Joukov qu'effectivement, la Russie
contemporaine valorise la Grande Guerre Patriotique, moment clé
d'unité nationale, et par contrecoup la figure de Joukov. Pour
réaliser sa biographie, Jean Lopez s'est fait aider par plusieurs
personnes à même de lui donner accès à l'abondante production
russe -absente en revanche de ses précédents ouvrages-, comme une
collaboratrice moscovite, Inna Solodkova. Cet avant-propos soulève
en revanche deux problèmes que l'on retrouvera tout au long de la
biographie. D'abord, Jean Lopez attribue les succès de l'Armée
Rouge, en particulier dans la seconde moitié de la guerre, à Joukov
seul. Est-ce véritablement pertinent ? On verra que l'on peut
s'interroger. Ensuite, Jean Lopez se présente à nouveau, comme il
peut le faire dans le magazine Guerres et Histoire ou dans ses
précédents ouvrages, en « chasseur de mythes »,
prêt à démonter la légende noire et la légende dorée de Joukov.
Malheureusement cette posture, qui relève plus du journaliste que de
l'historien à proprement parler, se retrouve tout au long du livre
avec des jugements de valeur qui n'ont pas forcément leur place dans
un récit qui se veut, quand même, dans le droit fil d'une méthode
historienne.
Cette
tension entre points forts et points faibles se manifeste dès la
première partie de l'ouvrage. Joukov est né en 1896 dans le village
de Strelkovka, à 110 km de Moscou, dans le gouvernement de Kalouga.
Il n'est pas issu d'un milieu paysan miséreux comme il a cherché à
le faire croire. Il bénéficie même d'une éducation primaire
rendue possible par les dernières réformes d'un tsarisme
chancelant. En 1908, il est envoyé à Moscou chez un oncle fourrier,
l'oncle Micha, que les mémoires soviétiques noircissent à dessein.
A la déclaration de guerre, en 1914, Joukov ne rejoint pas l'armée
russe, sans doute pour conserver une situation relativement bonne.
Mais la guerre prélève son tribut et il est finalement mobilisé en
juillet 1915. Joukov intègre la cavalerie, où il est formé et
entraîné. Nommé sous-officier, il ne participe pas aux grandes
opérations des années 1915-1916, comme l'offensive Broussilov. Il
connaît son baptême du feu en août 1916, mais il est rapidement
blessé et évacué. Quand il revient, fin 1916, l'atmosphère a
changé dans la troupe, qui gronde contre le tsar et son régime,
tout comme la population. Joukov n'a pas joué un grand rôle dans
son unité au moment de la révolution de février 1917 et de ce qui
s'ensuit. Son choix politique n'est pas plus arrêté au fil de
l'année, là encore contrairement à ses déclarations postérieures.
On
est frappé cependant de constater que Jean Lopez, qui affirme
plusieurs fois qu'il n'est pas question dans son ouvrage de traiter
de la guerre sur le front de l'est ou des révolutions de 1917, s'y
prend de manière un peu trop rapide, survole certains sujets, comme
l'état de l'armée tsariste, ses performances, son historique (d'où
vient-elle ? Comment pense-t-elle?) avant la guerre. Dans la
bibliographie, il est très clair qu'il manque des références sur
ces sujets, que ce soit sur la dimension politique ou
économico-sociale expliquant les révolutions, ou bien sur
l'histoire et la pensée militaire de l'armée russe tsariste, en
particulier de la fin du XIXème siècle à 1914 (pas de B.W.
Menning, de T. Dowling, de D. Schimmelpenninck, par exemple). Le
portrait qu'en brosse Jean Lopez comprend donc un certain nombre de
généralités peu étayées, sujettes à débat.
En
septembre 1918, après être revenu chez lui, Joukov finit par
s'engager dans la cavalerie rouge. Là encore, Jean Lopez, qui s'en
défend -précisant que ce n'est pas l'objet du livre- survole assez
rapidement la guerre civile russe, moment pourtant très important
pour l'histoire militaire soviétique et tout simplement pour
l'histoire mondiale tout court. Dès mars 1919, Joukov entre au
parti, dans une nouvelle Armée Rouge qui cherche également à
éduquer ses recrues -sans doute plus massivement que ne l'avait
voulu le tsar. Joukov combat contre les cosaques blancs du Don, puis
sur la Volga, où il est à nouveau blessé. Devenu chef d'escadron
en novembre 1920, il traque le bandit Kolesnikov dans la région de
Voronej, puis participe à l'écrasement de la révolte de Tambov, en
1921, répression impitoyable coordonnée par Toukhatchevsky. Ce
n'est qu'à la fin de ce chapitre que Jean Lopez revient enfin sur
les caractéristiques de la guerre civile russe, plus pour insister
sur sa brutalité et sa barbarie et les prémices d'une « guerre
totale » que sur son déroulement militaire ou pour
développer précisément l'impact sur la façon d'envisager la
guerre chez les Soviétiques.
Joukov
reste dans l'armée après la victoire remportée par les bolcheviks,
même si celle-ci décroît en proportion avec le retour à la paix.
L'Armée Rouge est également traversée par deux débats sur sa
composition -miliciens ou professionnels- et sa fonction -soutien à
l'économie socialiste ou véritable outil de défense. Frounzé
contrebalance Trotsky et le résultat est une armée mixte, que
Frounzé veut étroitement associer à l'industrialisation de l'URSS,
annonçant Toukhatchevsky. Commandant d'un régiment de cavalerie,
Joukov part à l'école de cavalerie de Léningrad en 1924, où il
croise déjà Rokossovsky et quelques autres. L'Armée Rouge
s'enferme dans un marasme, notamment parce que le corps des officiers
n'a rien de solide. Joukov appartient plutôt au groupe de ceux qui
recherchent la professionnalisation de l'Armée Rouge mais en
militant pour ce faire auprès du Parti : ce seront pourtant les
premières cibles des purges, mais les survivants s'imposeront après
1945. Joukov, dans sa vie de garnison, est également « coincé »
entre sa vie sentimentale agitée et déjà deux femmes qui comptent.
En 1929, Joukov approfondit ses connaissances militaires en suivant
le cours avancé pour les officiers supérieurs à Moscou. C'est là
qu'il découvre la gestation, déjà bien en train, du fameux art
opératif soviétique. Il a une affection, en particulier, pour l'un
des penseurs importants de la discipline, Triandafillov. La
présentation de l'art opératif par Jean Lopez est une reprise de
celle des ouvrages antérieurs, et n'apporte rien de véritablement
neuf.
Quatre
hommes jouent ensuite un rôle important dans l'ascension de Joukov :
Rokossovsky, qui prend la tête de la 7ème division de cavalerie
dont fait partie Joukov, Timochenko, Boudienny et Vorochilov. Promu à
l'inspection de la cavalerie aux côtés de Boudienny, il y rencontre
Vassilievsky, son complice de la Grande Guerre Patriotique. Il côtoie
aussi, pour la première fois, Toukhatchevsky, une autre figure de
légende du renouveau théorique de l'Armée Rouge. En 1933, Joukov
prend la tête de la 4ème division de cavalerie en Biélorussie,
qu'il va s'efforcer de remettre en condition pour la guerre. Il
affronte Isserson, un autre penseur important de l'art opératif
(curieusement Jean Lopez utilise le livre de Harrison sur ce
théoricien, mais pas celui du même auteur sur l'art opératif
soviétique, pourtant important), lors de manoeuvres en 1935. Joukov
se distingue lors des manoeuvres de 1936 en Biélorussie qui tentent
de mettre en oeuvre « l'opération en profondeur »
chère aux théoriciens de l'art opératif. Arrivent ensuite les
grandes purges avec l'exécution, en juin 1937, de Toukhatchevsky et
de l'essentiel des commandants de l'Armée Rouge. A nouveau, Jean
Lopez ne veut pas trop s'y attarder, or c'est un sujet d'une
actualité criante sur le plan historiographique. Joukov craint
probablement pour sa vie, d'autant qu'il a des liens avec
Ouborévitch, un des officiers passés par les armes dès le début.
Il est interrogé par un commissaire de son district, Golikov, qui
devient en quelque sorte sa bête noire. Sur les raisons des purges,
Jean Lopez y revient finalement, sans véritablement trancher entre
les différentes hypothèses. Mais on constate encore une fois
certaines lacunes en termes de contextualisation, ou plutôt une
contextualisation qui est mal faite, faute de références
appropriées : Jean Lopez n'est pas un spécialiste de l'URSS et
de ses différents aspects, hors histoire militaire, cela se ressent.
Joukov,
qui passe au travers des purges, devient commandant d'un corps de
cavalerie puis commandant adjoint du district militaire de
Biélorussie dès 1938. Appelé à Moscou le 24 mai 1939, Joukov est
envoyé combattre les Japonais en Extrême-Orient. On l'a
probablement choisi parce que sa réputation est alors connue des
survivants des purges qui sont restés en place ou ont accédé à de
nouvelles responsabilités. Etroitement surveillé, Joukov est en
fait chargé d'infliger une correction aux Japonais pour les
dissuader de renouveler des coups de sonde qui ont commencé dès
1931 et l'annexion de la Mandchourie. Il en fait pourtant le
prototype de ce que seront certaines opérations soviétiques de la
Seconde Guerre mondiale. On est étonné d'ailleurs de voir que Jean
Lopez ne s'attarde pas un peu plus sur la dimension aérienne de la
bataille de Khalkin-Gol, pourtant assez bien travaillée aujourd'hui
(plusieurs ouvrages en anglais sont consacrés à la question), et
qui préfigure largement, par exemple, le déroulement de Barbarossa
sur le plan aérien -il faut dire aussi que les ouvages de Jean Lopez
se concentrent beaucoup sur l'aspect terrestre, le Koursk par
exemple ayant été réédité en 2011 notamment pour faire des
ajouts sur la dimension aérienne. On note aussi que la carte, p.191,
qui représente la contre-offensive de Joukov à partir du 20 août
est relativement vague (pas d'unités précises, par exemple).
La
victoire écrasante de Joukov débouche sur l'armistice du 15
septembre 1939, qui écarte de fait le Japon de toute nouvelle
manoeuvre en Extrême-Orient, même si l'armée du Kwantung n'a pas
perdu l'oreille de l'empereur. En revanche, l'affirmation selon
laquelle l'adversaire japonais se limiterait à un « tigre
de papier » est dans doute un peu trop forte. Joukov ne
revient de Mongolie qu'en mai 1940, après le déclenchement de la
Seconde Guerre mondiale et la conclusion de la guerre désastreuse
contre la Finlande, à laquelle il échappe. Il est nommé commandant
du district militaire de Kiev, le plus important de l'Armée Rouge.
Si la campagne de Pologne montre effectivement l'impréparation de
l'Armée Rouge, Jean Lopez passe sous silence qu'après la débâcle
initiale en Finlande, certains changements sont intervenus qui ont
contribué au succès final des Soviétiques, qui ne l'emportent déjà
pas seulement que par la force du nombre.
Devant
le succès allemand à l'ouest, qui annule les bénéfices de son
pacte avec Hitler, Staline remplace Vorochilov par Timochenko, qui
lance un train de réformes, en 1940, pour remettre à niveau l'Armée
Rouge. Trop tard, et trop peu. Selon Jean Lopez, le choix de définir
le secteur sud comme prioritaire relève de Staline et d'autres, dans
l'hypothèse d'une offensive contre l'Allemagne nazie, même si le
Vojd ne croit pas à l'agression allemande. La conférence de
décembre 1940 ne permet pas d'aborder les vrais problèmes -à quoi
ressemblera la période initiale de la guerre et comment y répondre.
Le fameux wargame de janvier 1941, où Joukov fait montre de
son coup d'oeil, valide le choix de l'Ukraine comme part essentielle
du dispositif militaire. Joukov est nommé par conséquence chef
d'état-major de l'Armée Rouge, pour appliquer cette stratégie de
contre-attaque par le sud. Le plan MP-41, construit en mars, table
sur l'hypothèse, politique, qu'il n'y aura pas d'attaque en 1941. Le
plan de frappe préventive, conçu avec Timochenko en mai, est rejeté
par Staline. Joukov est mal à l'aise dans son rôle de chef
d'état-major. La tension est insupportable dans la semaine qui
précède l'attaque allemande du 22 juin. Il ne peut que suivre les
inquiétudes de Staline et sa marge de manoeuvre est limitée ;
il regrettera après la guerre de ne pas avoir fait plus.
Le
choc du 22 juin 1941 est terrible. Les penseurs militaires
soviétiques et historiens de la guerre froide le comparent
fréquemment à celui d'une frappe nucléaire. Joukov peine à avoir
une situation claire de l'ensemble du front le 22 juin. Dès le
lendemain, il part pour le front sud, où le dispositif le plus
puissant de l'Armée Rouge fait face au groupe d'armées de von
Rundstedt. Il n'y reste que trois jours, à peine le temps de lancer
le début du fameux « triangle sanglant », le
premier choc de blindés massifs en Ukraine, qui certes se termine en
désastre pour les Soviétiques, comme le rappelle Jean Lopez, mais
forge des chefs, comme Rokossovsky et à un niveau inférieur,
Katoukov, futur commandant de la 1ère armée de chars de Joukov. A
Moscou, Staline hurle sur l'état-major, Joukov est à bout de nerfs.
On arrive ensuite à un passage sans doute parmi les plus
contestables du livre : le moment où Staline, une semaine après
l'attaque, s'est enfermé dans sa datcha de Kuntsevo. Quand
les apparatchiks
viennent le chercher pour former le GKO, le Comité de Défense de
l'Etat, il est probable que le Vojd n'en peut mais.
L'effondrement n'a pas duré mais est probablement réel, comme le
soulignent plusieurs historiens (Françoise Thom notamment),
contrairement à ce que semble croire Jean Lopez qui pousse la
« chasse aux mythes » peut-être un peu trop loin
cette fois-ci.
Staline
se reprend vite néanmoins : création du GKO, puis de la Stavka
(en plusieurs étapes),
déménagement des usines, exécutions des chefs qui ont failli, la
machine « guerre totale » est en marche. Il
s'adresse dans un discours resté célèbre aux Soviétique, le 3
juillet, alors que c'est Molotov qui avait annoncé l'invasion
allemande le 22 juin. Sur le front ouest, Joukov applique la
quintessence du plan MP-41 : l'offensive à outrance, partout,
avec tout ce qui est disponible. Smolensk tombe le 16 juillet, mais
Joukov y lance contre-attaque sur contre-attaque, freinant
littéralement les Allemands par la force des baïonnettes. Limogé
de son poste de chef d'état-major, il met par écrit les prémices
de la réorganisation de l'Armée Rouge au vu des désastres
initiaux. La réduction du saillant de Yelnya, qui est l'oeuvre de
Joukov, est peut-être un succès symbolique et personnel, mais la
bataille a été très durement ressentie du côté allemand, comme
le montrent les témoignages analysés par David Stahel dans son
premier ouvrage (curieusement absent de la bibliographie de J.
Lopez). Dès l'été 1941, le doute s'installe dans la Wehrmacht,
sur le terrain, mais aussi à l'échelon supérieur -que l'on pense à
Halder. La bataille de Smolensk, à sa manière, représente déjà
quelque chose d'important. Joukov voit ensuite le front sud décimé
par l'entêtement de Staline, qui conduit à l'encerclement géant de
Kiev ; il en parlera beaucoup dans ses mémoires, bien qu'il n'y
ait pris aucune part. En septembre, Joukov est envoyé en urgence à
Léningrad : les Allemands sont aux portes de la ville. Ils ont
progressé à travers les Etats baltes, et essuyé là encore des
contre-attaques coûteuses mais efficaces, celles de Vatoutine, qui
usent le poing blindé, déjà faible, du groupe d'armées, plus
probablement, là encore, que ne le concède Jean Lopez. Joukov
arrive pour rétablir le moral, l'ordre et faire tenir le front. Il y
parvient d'autant mieux que les Allemands transfèrent des forces
pour l'offensive sur Moscou, dès la fin septembre ; ils
n'entreront jamais dans Léningrad.
L'opération
Typhon profite de la fragilisation du front ouest suite aux
contre-offensives incessantes d'août-septembre, côté soviétique,
et d'une défense mal organisée. Les encerclements de Vyazma et
Bryansk livre encore des centaines de milliers de prisonniers, mais
des dizaines de milliers d'autre échappent aux encerclements, les
Allemands manquant encore d'infanterie pour les sceller de manière
étanche, comme à Bialystok et à Minsk, les premiers chaudrons de
la campagne. Joukov, revenu à Moscou le 6 octobre, sauve la tête de
Koniev. Il va inspecter lui-même le front. Il s'y trouve une
« seconde épouse » de campagne. Les Panzer
reprennent leur marche et mi-octobre, ne sont plus qu'à une centaine
de kilomètres de Moscou. Guderian, cependant, s'est heurté à un os
non loin d'Orel, à Mtsensk : Katoukov, à la tête de la 4ème
brigade de chars, remporte un succès tactique certain EN DEFENSE,
preuve que l'Armée Rouge progresse, même dans ce domaine, ce qu'il
aurait été intéressant d'analyser, à travers cet exemple et
d'autres. Le culte de l'offensive n'empêche pas des adaptations
pragmatiques efficaces. Jean Lopez ne s'y attarde pas, il aurait pu
-l'ouvrage de R. Armstrong sur les commandants d'armées blindées
soviétiques, qui aurait été fort utile, ne figure d'ailleurs pas
dans la bibliographie. A Moscou, c'est la panique, car Staline n'a
pas encore choisi de demeurer ou non dans la capitale. Les scènes
d'affolement se multiplient dans la capitale. Mais dès le 19
octobre, le Vojd choisit de demeurer au Kremlin, et l'ordre
est rapidement rétabli. La météo freine les Allemands, de même
que la résistance de plus en plus efficace des Soviétiques, comme à
Toula. Staline, pour regonfler le moral, fait procéder à un défilé
symbolique, sur la Place Rouge, le 7 novembre, pour l'anniversaire de
la Révolution d'Octobre.
A
la mi-novembre, au prix d'une brutalité sans nom, Joukov a stoppé
l'offensive allemande sur Moscou. Sur son aile droite, le 1er
décembre, les Allemands sont même rejetés en arrière par la 1ère
armée de choc, une des nouvelles armées de réserve introduites
dans le dispositif soviétique depuis novembre. Joukov contient à la
fois les Allemands et prépare la contre-offensive. La tension est
énorme, comme l'illustre l'affaire du hameau de Dedovo, repris dans
le sang aux Allemands sur une simple confusion de Staline, qui hurle
à tout va. La contre-offensive, qui se déclenche le 4 décembre
1941, fixe au centre et déborde par les ailes. Mais les Soviétiques
ne peuvent pas exploiter la percée en profondeur. Joukov commence à
interdire les attaques frontales d'infanterie, néanmoins, favorise
la coopération interarmes. Il devient célèbre, s'impose dans les
médias : c'est le début du mythe. Mais dès le 5 janvier 1942,
Staline, grisé par les succès initiaux, déclenche une offensive
généralisée à l'ensemble du front, au lieu de limiter ses
ambitions. Joukov, comme les autres chefs militaires, n'a pas
bronché. Il n'arrive pas à encercler Viazma, plusieurs armées sont
encerclées et décimées par les Allemands qui ont reçu l'ordre
d'Hitler de tenir sur place... La victoire est incomplète quand le
front se stabilise le 20 avril 1942. Les Soviétiques n'ont pas su
choisi une seule direction générale pour l'attaquer ni coordonner
leurs efforts.
Staline
commet l'erreur, en 1942, de surestimer le potentiel allemand -qui a
diminué de moitié ou presque, et ne peut plus lancer qu'une seule
offensive-, de se tromper sur la direction privilégiée (Moscou au
lieu du sud) et de ne pas vouloir rester sur la défensive. Les
Soviétiques sont laminés en Crimée, puis à Kharkov, lors de
l'offensive conçue pour Timochenko. L'offensive Blau fonce
vers la Volga, et le Caucase, Hitler scindant ses forces en deux le
23 juillet 1942, croyant les Soviétiques à bout. Joukov, à l'été
1942, reste concentré sur la direction de Moscou et enchaîne
attaques et contre-attaques devant le fameux saillant de Rjev. Ce
faisant, il brise aussi dans l'oeuf une offensive allemande limitée,
même si c'est au prix d'un carnage sans nom. La situation au sud est
néanmoins critique : Joukov, nommé n°2 de Staline, s'envole
pour Stalingrad le 29 août. Les contre-attaques hâtives menées au
nord de la ville, début septembre, sont encore une fois sanglantes,
mais indéniablement, elles usent le potentiel allemand. Joukov et
Vassilievsky, pour Jean Lopez, sont bien les responsables du plan de
l'opération Uranus : simplement, c'est plutôt fin
septembre qu'au début, après que l'offensive allemande se soit
enlisée dans les décombres de Stalingrad. Joukov, c'est certain,
fait déplacer le centre de gravité de la pince nord de la tête de
pont de Kletskaïa à celle de Serafimovitch, plus à l'ouest. Peu
après, Staline abolit le double commandement des commissaires
politiques, réinstallé en juillet 1941. Joukov, lui, part
surveiller le déroulement de Mars, une nouvelle opération
contre le saillant de Rjev qu'il a programmé dès septembre.
L'attaque, déclenchée le 25 novembre, se termine sur un échec
cinglant. Elle a cependant immobilisé et consommé des forces
allemandes qui auraient pu être utilisées ailleurs, au sud.
Surtout, elle montre que l'Armée Rouge, et Joukov, ne sont pas
encore guéris des maladies de jeunesse de 1941.
Dans
la foulée de l'encerclement à Stalingrad, l'Armée Rouge commence à
lancer des offensives pour disloquer en profondeur le système
ennemi. Joukov, envoyé à Léningrad, parvient, en janvier 1943, à
rétablir un corridor terrestre via une nouvelle offensive difficile.
Staline le fait maréchal le 18 janvier. L'Armée Rouge renaît de
ses cendres, tel le phénix. Les épaulettes refont leur apparition,
les grades aussi. Les soldats entrent en masse dans le parti. Joukov,
qui fait partie de l'élite militaire, est choyé. Staline lui offre
même un train personnel. D'ailleurs Jean Lopez aurait pu, peut-être,
nous en dire un peu plus sur l'achat quasi « clientéliste »
du haut-commandement soviétique par Staline, puisqu'il est
finalement intégré dans la nomenklatura. Il a confiance
désormais dans ses officiers ; les représentants de la Stavka
obtiennent des compétences élargies pour coordonner les opérations
principales. On attendait d'ailleurs, ici ou un peu plus tard, des
perspectives plus larges sur l'économie de guerre soviétique, la
mobilisation de la société dans le cadre d'une guerre totale, etc,
qui ne viennent pas. Staline se laisse cependant encore une fois
griser par le succès : la contre-offensive générale, et son
volet sud, connaissent un échec devant le retour offensif de
Manstein. Joukov est envoyé pour consolider le front près de
Bielgorod. Celui-ci se stabilise en avril. La campagne de 1942 se
termine pour l'Allemagne et ses alliés sur un désastre encore bien
plus grand qu'en 1941, même si l'URSS a payé le prix fort pour y
parvenir.
Dans cette émission de la chaîne Histoire où J. Lopez intervient pour présenter son livre, on apprend de la bouche de S. Courtois que M. Lopez est un militaire (?), sans que celui-ci démente. En outre, Jean Lopez se fait reprendre par Mme Thom sur l'effondrement de Staline les 28-29 juin 1941, comme je l'évoquais ci-dessus. Enfin, il reprend des formules "chocs" tirées de son livre, qui font très "bonne presse", mais qui constituent, encore une fois, des généralités dont on pourrait se passer, et qui ne sont pas celles d'un historien : "Joukov a un niveau de CE2", "le chaos, le désordre, la nonchalance russe", "orgie de meurtres et de viols", "Staline agité du bocal, comme tous les chefs bolcheviks". Plus une ou deux petites erreurs ou points qui font débat, mais qui curieusement ne le sont pas dans le livre (deux divisions d'élite à Khalkin-Gol au lieu d'une seule, Joukov enlève l'initiative stratégique aux Allemands à Koursk alors que Jean Lopez semble concéder cette fois-ci dans le livre que c'est bien l'Armée Rouge qui a l'initiative stratégique à ce moment-là). En somme, la vidéo résume assez bien l'ouvrage (la présentation du Joukov commence à 13 mn).
Dans cette émission de la chaîne Histoire où J. Lopez intervient pour présenter son livre, on apprend de la bouche de S. Courtois que M. Lopez est un militaire (?), sans que celui-ci démente. En outre, Jean Lopez se fait reprendre par Mme Thom sur l'effondrement de Staline les 28-29 juin 1941, comme je l'évoquais ci-dessus. Enfin, il reprend des formules "chocs" tirées de son livre, qui font très "bonne presse", mais qui constituent, encore une fois, des généralités dont on pourrait se passer, et qui ne sont pas celles d'un historien : "Joukov a un niveau de CE2", "le chaos, le désordre, la nonchalance russe", "orgie de meurtres et de viols", "Staline agité du bocal, comme tous les chefs bolcheviks". Plus une ou deux petites erreurs ou points qui font débat, mais qui curieusement ne le sont pas dans le livre (deux divisions d'élite à Khalkin-Gol au lieu d'une seule, Joukov enlève l'initiative stratégique aux Allemands à Koursk alors que Jean Lopez semble concéder cette fois-ci dans le livre que c'est bien l'Armée Rouge qui a l'initiative stratégique à ce moment-là). En somme, la vidéo résume assez bien l'ouvrage (la présentation du Joukov commence à 13 mn).
Concernant
le choix de la défensive stratégique à Koursk, Jean Lopez semble,
dans cet ouvrage, concéder davantage que les Soviétiques ont
l'initiative des opérations sur le plan stratégique en 1943, et
choisissent la défense, ce qui n'était pas le cas dans les deux
éditions du Koursk. Joukov est aux premières loges, près de
Rokossovsky, pour voir l'échec de l'offensive allemande au nord du
saillant de Koursk. Il participe ensuite à la supervision de
Koutouzov, l'offensive sur le saillant d'Orel, dont le succès
initial est gâché, puis à Roumantsiev, la contre-offensive
délicate qui parvient néanmoins à reprendre Kharkov et à rejeter
les Allemands. Dans la course au Dniepr, Joukov plaide contre la
stratégie du large front de Staline : il a conscience de la
saignée opérée depuis 1941 dans les rangs soviétiques et en
outre, l'augmentation du potentiel blindé et motorisé de l'Armée
Rouge permet d'envisager d'autres solutions. Joukov veut coller au
plan initial, franchir le Dniepr au sud de Kiev et prendre la
capitale de l'Ukraine par cette direction. Mais les Soviétiques
s'enlisent à Boukhrine. Dès la fin octobre, Joukov acquiesce à une
solution par le nord, via la tête de pont de Lyutezh. L'offensive,
qui démarre le 3 novembre, est rondement menée et aboutit à la
chute de Kiev trois jours plus tard. Les Allemands ne peuvent plus se
maintenir sur le Dniepr.
Profitant
de l'opération d'encerclement à Korsun, Staline va pousser contre
Joukov son rival Koniev, qui sait aussi se mettre en valeur. Koniev,
fait maréchal le 20 février 1944, n'a cependant pas réussi à
rendre étanche la poche de Korsun, dont quelques milliers
d'Allemands parviennent à sortir. La rivalité est encore renforcée
par la mort de Vatoutine, le 29 février, tué par des partisans
ukrainiens nationalistes. Voilà Joukov revenu au commandement de
front (1er front d'Ukraine), à égalité avec Koniev et Rokossovsky.
Il se fait jouer par Manstein lors de l'encerclement de la 1.
Panzer Armee, qui réussit à se dégager vers l'ouest. Revenu à
Moscou en avril, Joukov participe à la mise au point de l'opération
Bagration, puis revient jusqu'à la fin mai au 1er front
d'Ukraine. L'offensive contre la Roumanie lancée par Koniev échoue,
alors que Joukov peaufine et élargit les préparatifs de Bagration.
Il inclut le 1er front d'Ukraine de Koniev qui doit intervenir dans
un second temps et dispose en particulier de l'essentiel des armées
blindées. Bagration, qui commence le 22 juin 1944, est l'une
des plus sévères défaites de la guerre pour les Allemands :
ceux-ci reculent de 600 à 700 km, perdent au bas mot 250 000 tués
et disparus, alors que les pertes soviétiques, cette fois-ci, sont
nettement inférieures. Dès le mois de juillet, Staline fait
comprendre à Joukov que les considérations politiques prennent le
pas sur les opérations militaires stricto sensu. Il reprend
la main sur l'armée en supprimant les représentants de la Stavka ;
surtout, il aiguise la compétition entre les chefs en déchargeant
Rokossovsky du 1er front de Biélorussie, destiné à prendre Berlin,
pour le confier à Joukov. L'axe principal de l'offensive vers le
coeur du Reich fait assez peu débat : il est au centre, à
travers la Pologne.
Le
portrait de la préparation de Vistule-Oder est repris du Berlin :
aucune nouveauté pour les connaisseurs, donc, et c'est dommage, car
plusieurs historiens russes ont entretemps publié sur le sujet,
comme Isaiev, ce qui aurait permis à J. Lopez de retravailler
certains points. En revanche, Joukov commence à être sur la
sellette dès le mois de décembre 1944, Staline faisant
progressivement constituer un dossier contre lui, au besoin.
L'offensive Vistule-Oder, déclenchée le 12 janvier 1945, est
fulgurante. Dès le 31 janvier, les premiers soldats soviétiques
franchissent l'Oder, au nord de Küstrin, à 65 km de Berlin. L'Armée
Rouge a avalé encore une fois 500-600 km et a éliminé plus d'un
demi-million de soldats allemands définitivement. Staline, et
Joukov, décident de s'arrêter temporairement sur l'Oder et de ne
pas pousser jusqu'à la capitale du Reich. L'absence de
renseignements humains en territoire ennemi fait surestimer la menace
sur les flancs. En outre, Staline est rendu prudent par les échecs
des années précédentes, et les troupes soviétiques devancent
largement, sur leur front, celles des Occidentaux. La logistique
soviétique est trop étirée et la discipline se relâche.
Le
passage sur les crimes de guerre commis par l'Armée Rouge en
Allemagne et dans les autres pays libérés est sans doute l'un des
plus contestables du livre. Jean Lopez reconnaît d'abord qu'aucune
étude sérieuse n'a été menée sur le sujet, ce qui est vrai. Mais
il avance ensuite des chiffres déjà évoqués dans son Berlin,
qui ne sont pas tirés de sources fiables (un vieux document de RDA,
l'étude de B. Johr qui prête à discussion). La vérité, c'est que
l'on peut reconnaître le caractère massif des viols, notamment,
leur déni par l'Armée Rouge, mais qu'on est bien en peine de
chiffrer quoique ce soit, d'autant plus que le sujet s'est évidemment
prêté à toutes les instrumentalisations pendant la guerre froide.
On voit là que Jean Lopez cède un peu facilement à des
généralisations abusives sur les comportements soviétiques. Idem
pour le fameux « effet Nemmersdorf » que Jean
Lopez avait mis en tête de son Berlin et dont plusieurs
historiens sérieux, comme Ian Kershaw, ont montré la relativité.
En outre, les Soviétiques reprennent en main les troupes et
fusillent, comme le fait notamment Koniev.
A
la fin mars, alors que le nettoyage des ailes de l'axe principal se
termine, en Poméranie, puis bientôt en Prusse-Orientale, les
Occidentaux entrent en Allemagne et progressent rapidement. Staline,
pour prendre Berlin au plus tôt, n'hésite pas à mettre à nouveau
en compétition Joukov et Koniev. L'opération de Joukov contre les
hauteurs de Seelow est donc préparée dans l'urgence, en à peine
quinze jours. Elle se heurte à une défense solide bâtie par un
spécialiste allemand du sujet, Heinrici. Joukov perd son
sang-froid : la ruse des projecteurs s'est retournée contre
lui, il engage les blindés de Katoukov trop tôt. Koniev, lui,
progresse au sud, vers Berlin. Il faut finalement trois jours entiers
à Joukov pour déboucher des hauteurs. Joukov lance ses chars pour
isoler la ville de Berlin par le nord et y entre dès le 21 avril.
Quatre jours plus tard, la ville est encerclée. Le 28 avril, Staline
tranche et laisse à Joukov le droit de s'emparer du Reichstag
et des autres bâtiments symboliques. C'est chose faite le 2 mai,
avec la reddition des forces allemandes. La comparaison entre les
chiffres des batailles urbaines donne lieu à de surprenants
parallèles avec Aix-la-Chapelle (les 1 000 tués Américains
semblent bien trop nombreux, à moins de compter ceux morts pour
encercler la ville...), et Okinawa (qui certes comporte un peu de
bâti mais n'a rien d'un combat urbain à proprement parler).
Joukov,
qui visite le Reichstag capturé le 2 mai, n'est pourtant pas
informé par Staline de la mort officielle d'Hitler, le 30 avril,
déjà vérifiée et confirmée. Il est pourtant le signataire de
l'acte de capitulation impliquant l'URSS, aux premières lueurs du 9
mai 1945, qui devient donc en URSS le jour anniversaire de la
victoire. Joukov participe aux rencontres avec les chefs militaires
occidentaux, Eisenhower au premier chef. Le 24 juin, Staline lui
accorde une place de choix au défilé de la victoire, sur la Place
Rouge. C'est sans doute l'apothéose de la carrière de Joukov.
Proconsul en Allemagne, adulé, vénéré même, Joukov ne voit pas
que Staline prépare déjà sa chute. Il continue à se servir en
Allemagne, à l'image de la troupe, qui pille largement -mais la
future RDA sera bien vite remise en état par les Soviétiques, pour
éviter une catastrophe alimentaire, notamment par l'action du
général Berzarine à Berlin, ce dont Jean Lopez ne parle pas. Or,
dès décembre 1945, Staline commence à faire le ménage, en
humiliant publiquement, successivement, Molotov, Beria et Malenkov.
Sous la torture, le maréchal de l'aviation Novikov dénonce Joukov,
que Staline envoie à Odessa en juin 1946. Jusqu'en 1948, Staline
continue de maintenir la pression sur le maréchal -qui fait un
malaise cardiaque en janvier. En février, il l'expédie à
Sverdlovsk, dans l'Oural. Joukov reste cependant persuadé que ses
malheurs ne sont pas le fait de Staline, mais bien d'Abakoumov et de
Beria, ce en quoi il se trompe ; le Vojd, d'ailleurs,
commence à minimiser les commémorations liées à la Grande Guerre
Patriotique, à en gommer les aspects trop dérangeants -comme les
mutilés, que l'on fait disparaître des rues.
La
réhabilitation de Joukov passe par sa participation à l'élimination
de Beria, après la mort de Staline en mars 1953. Adjoint du ministre
de la Défense puis ministre en titre à partir de 1955, Joukov doit
intégrer l'arrivée de l'armée nucléaire au sein de l'Armée
Rouge. Il fait réhabiliter les victimes militaires des purges, les
prisonniers détenus en Allemagne, réorganise les commandements de
l'armée et appuie pour la professionnalisation. Il abonde dans le
sens de Khrouchtchev pour la réduction des forces armées. A Genève,
en 1955, il revoit Eisenhower, devenu président des Etats-Unis. Au
XXème Congrès du PCUS, en 1956, Joukov appuie à fond la
déstalinisation lancée par Khrouchtchev. Dans l'affrontement en
Pologne, il prêche la modération. En Hongrie, il agit d'abord de
même ; en édifiant le Pacte de Varsovie, il avait créé un
corps d'armée spécial stationné en Hongrie. Il joue d'abord la
carte de la modération avec Mikoïan, puis, quand la situation
dégénère, il n'hésite pas à faire volte-face pour envoyer la
troupe. Joukov va adopter l'incorporation des armes nucléaires dans
le dispositif militaire soviétique mais ne néglige jamais les
forces conventionnelles. En juin 1957, une cabale est montée contre
Khrouchtchev autour de Molotov. Joukov contribue, par son énergie, à
sauver le Premier Secrétaire. Mais celui-ci ne peut pas laisser le
maréchal soviétique lui faire trop d'ombre. La disgrâce arrive en
octobre 1957 ; Koniev, le vieux rival, enfonce le clou. En mars
1958, Joukov est redevenu un pestiféré.
Il
s'attèle alors à ses mémoires, alors que l'histoire officielle de
la Grande Guerre Patriotique nie complètement ou presque son rôle
dans le conflit. L'arrivée au pouvoir de Brejnev en 1964 ne change
pas vraiment la donne. Certes, Joukov réapparaît dans une cérémonie
officielle dès 1965. Brejnev, s'il exalte la Grande Guerre
Patriotique, ne veut pas faire publier les mémoires de Joukov ;
il doit pourtant céder, en 1968, la diffusion se faisant également
en Occident. Joukov, attristé par la mort successive des femmes qui
ont compté dans sa vie, invalide, meurt en juin 1974. Il reste très
populaire jusqu'à la chute de l'URSS. Si Brejnev vante le rôle de
Staline dans la Grande Guerre Patriotique, Joukov est bien présent
dans la grande fresque cinématographique, Libération, de
Youri Ozerov. La Russie de Eltsine et surtout de Vladimir Poutine
remet elle aussi à l'honneur la Grande Guerre Patriotique et la
figure de Joukov. On peut regretter que Jean Lopez n'ait pas
développé davantage cette partie sur la mémoire et la postérité
du personnage, jusque dans les pays étrangers, en particulier.
La
conclusion est quelque peu déroutante : elle résume bien
l'esprit de l'ouvrage. L'auteur conclut sur l'idée que Joukov
appartient bien au panthéon des grands chefs militaires de
l'histoire russe et soviétique, et qu'il a contribué à sauver
l'URSS. Mais il s'interroge ensuite uniquement sur sa place dans
l'histoire militaire, pour encenser ses mérites par rapport aux
autres chefs soviétiques du conflit, et par rapport à ceux des
autres chefs des nations en guerre. Ce faisant, Lopez fait de Model
le meilleur général allemand du conflit, ce dont on pourrait
discuter. Pour finir, il attribue au duo Joukov-Eisenhower la palme
pour la défaite de l'Allemagne nazie. Si les deux personnages ont
effectivement eu un rôle important dans la victoire alliée, on ne
peut résumer celle-ci à eux seuls, tout comme il est peut-être
vain d'attribuer à Joukov le mérite quasi surhumain d'avoir conduit
l'Armée Rouge à la victoire. En réalité, et Jean Lopez s'en fait
l'écho à plusieurs reprises, avec Staline, la planification et donc
le succès est collectif, assez souvent -que l'on pense à
l'opération Uranus, où Joukov est probablement associé à
Vassilievsky. On voit aussi que Jean Lopez ne s'attarde pas pour
répondre sur des questions pourtant soulevées en introduction, et
qui auraient permis d'élargir un peu la perspective -la tension
armée/parti, en particulier, et le rôle politique que Joukov a été
amené à jouer après la guerre, par exemple, même si la dernière
partie de l'ouvrage, la plus courte, est peut-être la mieux ficelée.
A
mon tour de conclure cette fiche de lecture. Cette biographie de
Joukov par Jean Lopez comporte des qualités, et pas des moindres.
Elle est écrite dans un style clair, fluide, bien que la répétition
de certaines formules (« Il
n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage de traiter de... »,
pour en réalité le faire ensuite) ou de certains termes
(« roquer »)
puisse parfois agacer. Son mérite principal est indubitablement de
remettre à plat la chronologie de la vie de Joukov, de défaire les
mythes sur les épisodes phares, de montrer comment le personnage
s'est construit. Sur ce plan, la biographie est réussie. Elle
réhabilite quelque peu le genre de la biographie du chef militaire
de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, à trop vouloir montrer
Joukov comme le sauveur de l'URSS pendant la guerre, elle oublie que
le processus de décision a été, souvent, éminemment collectif,
sous l'ombre de Staline. Le Joukov sauveur et indispensable tel que
le décrit Jean Lopez est pertinent en 1941, quand Joukov se démarque
très nettement des autres chefs soviétiques par sa capacité à
coordonner l'action d'un front ou de plusieurs fronts. C'est déjà
moins le cas dès 1942 et surtout en 1943.
La
biographie conforte aussi les choix de l'auteur dans ses ouvrages
précédents, notamment celui de se démarquer d'une historiographie
militaire trop longtemps, il est vrai, centrée sur la vieille vision
germanocentrée. Mais ce caractère « neuf »,
en français uniquement, puisque le travail a déjà été fait en
anglais ou en allemand, ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt.
D'abord, on l'a dit, Jean Lopez se concentre étroitement sur
l'histoire militaire à partir de la figure de Joukov -et pas
complètement, comme on a pu le préciser sur l'armée tsariste ou la
guerre civile, notamment, qui sont abordées trop vites, de manière
trop peu circonstanciée. La bibliographie, faible au demeurant pour
un ouvrage de cette envergure (30 pages de notes, 10 pages de
bibliographie : à comparer à l'ouvrage de Nicolas Bernard, de
même taille) n'est pas organisée ; en revanche, on y voit très
bien les manques concernant les dimensions politiques de l'URSS, ou
de l'histoire socio-économique soviétique (comme les liens entre
le plan quinquennal, l'industrialisation et l'oeuvre de
Toukhatchevsky), remarquablement absentes du livre de Jean Lopez, et
ce y compris pendant la guerre. L'auteur ne consacre finalement que
fort peu de place à l'évocation de ces réalités : économie
de guerre, société en guerre, et pourquoi pas culture de guerre. De
ce point de vue, l'ouvrage de Nicolas Bernard, sorti à peu près en
même temps que cette biographie, dispose d'un avantage certain.
Outre le fait que le propos se limite à l'histoire militaire
stricte, on ne peut s'empêcher de constater un anticommunisme
latent, qui semble bien hors de propos depuis la disparition de
l'URSS. Comme s'il s'agissait de compenser le fait que l'on remette à
l'honneur la performance des Soviétiques -encore que Jean Lopez,
ici, soit un peu moins catégorique dans ses précédents travaux ;
manifestement, certaines critiques ont été entendues ou certains
commentaires lus...- l'auteur ne peut s'empêcher de verser dans une
touche d'anticommunisme très visible sur certains sujets, comme les
crimes de guerre de l'Armée Rouge, par exemple. Cela s'explique
aussi peut-être en partie par la bibliographie, qui comprend des
ouvrages comme celui de Robert Conquest, que l'on sait daté. Enfin,
Jean Lopez, en voulant à tout prix tordre le cou à la légende
dorée construite par Joukov et à la légende noire créée par ses
adversaires ou par les autorités soviétiques, s'arroge souvent le
rôle de juge, distribue les bons et les mauvais points, valorise ou
condamne : encore une fois, cela correspond davantage à la
posture du journaliste plutôt qu'à celle de l'historien.
Ces
différents facteurs combinés expliquent sans doute la pauvreté de
la conclusion. De manière générale, quand on a lu les ouvrages de
Jean Lopez et que l'on connaît un tant soit peu l'histoire et
l'historiographie du front de l'est, on est frappé de constater que
le travail de ce dernier, pour novateur qu'il soit en français
(novateur parce qu'il n'y a rien d'autre, ce qui commence d'ailleurs
à être déjà moins vrai), reste profondément dans la ligne d'une
ancienne « histoire-bataille »
telle qu'elle avait pu être dénigrée par les Annales (et tout est
relatif...). En réalité, Jean Lopez, en se cantonnant ou presque à
l'histoire militaire pure, actualise simplement les références
bibliographiques et livre en français, à sa propre sauce, le
travail historiographique réalisé depuis une trentaine d'années
-avec quelques trous néanmoins. On est donc loin d'une « nouvelle
histoire-bataille »,
utilisant des questionnements autres, l'apport de sciences annexes à
l'histoire, etc. Et l'on comprend mieux pourquoi l'histoire militaire
a du mal à être acceptée comme discipline à part entière par
l'histoire universitaire : le renouveau actuel de l'histoire
militaire, et Jean Lopez en est l'illustration, constitue en réalité
un retour aux sources de l'ancienne histoire-bataille, pour beaucoup.
Le public en est manifestement friand ; sur un plan
scientifique, cette tendance entraîne des réticences, et c'est bien
légitime. Car la démarche a ses limites. Certes, du point de vue de
l'auteur de la fiche de lecture, la critique est facile. La
conclusion finale serait peut-être qu'il serait temps de retrousser
nos manches pour proposer, aussi, une autre vision du front de l'est,
en dehors de la simple histoire militaire mâtinée de
sensationnalisme journalistique. Un ouvrage comme celui de Nicolas
Bernard, lui aussi non-historien universitaire mais qui ne s'est
jamais présenté comme tel, montre le chemin. Mais il reste encore
beaucoup à faire.
↧
Café Stratégique n°32 : Les révolutions arabes, trois ans après... (Jean-François Daguzan)
Le 32ème volet des Cafés Stratégiques sera consacré aux suites des révolutions arabes, qui ont commencé il y a maintenant trois ans, et qui ont débouché sur des situations bien différentes selon les pays concernés. C'est Jean-François Daguzan, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), et qui travaille notamment sur les problèmes stratégiques en Méditerranée et au Moyen-Orient, tout en dirigeant la revue Maghreb-Machrek, qui viendra en discuter le jeudi 13 février, à partir de 19h, au café Le Concorde.
P.S. : le mort arabe sur l'affiche signifie "révolution".
↧
Histoire et Stratégie n°17, supplément n°2 : Tonnerre roulant. Les blindés américains dans la guerre du Golfe
La
guerre du Golfe représente sans doute le zénith de l'arme blindée
américaine. Jamais celle-ci n'est arrivée sur le champ de bataille
aussi bien préparée qu'en 1990. La doctrine de l'armée américaine
a été profondément révisée depuis la fin de la guerre du Viêtnam
en 1973 et les blindés bénéficient d'un intérêt sans précédent.
Les M1A1 Abrams sont couverts par l'infanterie mécanisée,
l'artillerie autopropulsée, les sapeurs mécanisés et les
hélicoptères d'attaque. Après une intense campagne aérienne, les
blindés américains pénètrent au Koweït et traversent le désert
pour frapper les flancs et les arrières du dispositif irakien. En
moins de cinq jours, Saddam Hussein est contraint de retirer son
armée du Koweït pour sauver son régime. La guerre du Golfe
représente, in fine, la première guerre de mouvement
d'envergure pour l'arme blindée américaine depuis la Seconde Guerre
mondiale. La division blindée type est « éclairée »
par les M3 Bradley et les hélicoptères OH-58D du squadron de
cavalerie. Derrière suivent les trois brigades, qui possèdent
chacune plus de puissance de feu qu'une division blindée de la
Seconde Guerre mondiale, avec 2 ou 3 bataillons de chars M1A1 (58 chars
chacun) et un bataillon de véhicules blindés M2A2 (54 véhicules chacun). Sans compter
les unités de soutien, et un bataillon d'artillerie pour chaque
brigade, avec 24 M109A2, et plus de 250 véhicules en tout.
L'Aviation Brigade comprend deux bataillons d'AH-64 Apache,
une compagnie de UH-60 Blackhawk et une section d'OH-58D. En
mouvement pendant Desert Storm, une division blindée
américaine occupe de 25 à 45 km de front sur une profondeur de 80 à
150 km, avec 22 000 hommes et plus de 1 940 véhicules chenillés,
sans compter 7 200 véhicules à roues et les hélicoptères. La 3ème
armée américaine emploie deux corps pour attaquer la Garde
Républicaine irakienne. Pour le général Starry, un des fondateurs
de l'AirLand Battle, le corps d'armée est l'unité adéquate
pour appliquer la doctrine tactique de l'US Army. C'est aussi
le pont entre le tactique et l'opératif, ce qui va s'appliquer aux manoeuvres du
VIIème et XVIIIème corps. L'instruction des tankistes insiste
désormais sur le tir sur cibles multiples pour chaque char, en
mouvement et équipage enfermé à l'intérieur.
Entre
les 2 et 6 août 1990, l'armée irakienne de Saddam Hussein occupe,
par une opération rondement menée, le Koweït. Dès le 7 août, les
Etats-Unis expédient des appareils de l'USAF et la 82nd
Airborne Division en Arabie Saoudite, cette dernière arrivant
avec les M551 Sheridan du 3rd
Battalion, 73rd Armor. Le 13 août, le
président Bush envoie la 24th Infantry
Division (Mechanized) renforcée de la 197th
Infantry Brigade (Mechanized). Le 27 août, le général Luck,
commandant le XVIIIème corps, a suffisamment de blindés pour
résister à une offensive irakienne. Les Marines arrivent dès
le 14 août et la 101st Airborne Division
(Air Assault) trois jours plus tard. Début octobre, le 3rd
Amored Cavalry Regiment et la 1st
Cavalry Division sont dépêchés à leur tour : Luck aligne
alors 763 chars, 227 hélicoptères et pas moins de 1 500 véhicules
blindés. Les Marines continuent d'arriver ainsi que la 7th
Armoured Brigade britannique avec ses Challenger et ses
Warrior. Le 8 novembre, le président Bush annonce un
doublement du corps expéditionnaire pour lui donner une capacité
offensive, avec l'augmentation de la présence de l'USAF et des
Marines, et un VIIème corps renforcé. Les troupes déployées
sont un assemblage composite venant des unités basées en Europe :
Vème corps (3rd Armored Division),
VIIème corps (2nd Armored Cavalry
Regiment et 1st Armored Division),
plus la 1st Infantry Division qui
arrive du Kansas. En tout, 35 bataillons lourds, 7 bataillons
d'hélicoptères d'attaque, 24 bataillons d'artillerie automotrice :
la plus formidable force jamais déployée par les Etats-Unis. La 1st
Armoured Division britannique est rattachée à l'ensemble en
décembre. La 1st
Cavalry Division est assignée au VIIème corps et le
XVIIIème se déplace à l'ouest. La 1st
Cavalry revient dans la réserve du CENTCOM le 24 février, au
début de l'offensive terrestre, puis est affecté au VIIème corps
de nouveau le 26 février.
Début
décembre, la première unité du VIIème corps, le 2nd
Armored Cavalry Regiment, arrive en Arabie Saoudite. Les derniers
éléments, de la 3rd Armored Division,
n'arrivent eux qu'en février 1991, juste avant l'offensive
terrestre. Les M1 sont remplacés par des M1A1 et les M3 par des
M3A1. Le VIIème corps se déplace à l'est tandis que le XVIIIème
corps reste sur la côte. Les unités s'acclimatent tant bien que
faire se peut au climat désertique ; la 1st ID et la
1st Armoured Division britannique
préparent la percée des lignes irakiennes. Dans la troisième semaine
de février, le général Yeosock, qui commande la 3ème armée, fait
avancer les deux corps dans leur zone de rassemblement avancée. Il
fait déplacer le XVIIIème corps vers l'est en dissimulant le
mouvement aux Irakiens, alors que le VIIème corps répète l'assaut.
Yeosock peut compter sur plus de 2 000 chars et 1 500 véhicules
blindés, plus deux fois plus que Patton avant son mouvement durant
la contre-offensive des Ardennes. La cible du dispositif américain
est la Garde Républicaine irakienne, formation d'élite qui a mené
l'invasion du Koweït avec 3 divisions lourdes : Medina et
Hammourabi (blindées) et Tawakalna (mécanisée). Retirées du sud du
Koweït, ces formations sont en position centrale sur la ligne de
front. L'ensemble comprend plus de 800 chars T-72 et plus de 600
véhicules blindés BMP. Le flanc nord de la Garde Républicaine est
protégé par 3 divisions d'infanterie motorisée (Al Fawa,
Nabuchodonosor et Adnan), avec chacune au moins un bataillon de
chars. Les 10ème et 12ème divisions blindées, nouvellement
formées, sont aussi contrôlées par la Garde Républicaine. La
première est de peu de valeur, contrairement à la seconde, unité
d'élite de l'armée irakienne. Ces divisions doivent servir de
couverture à la Garde Républicaine, à l'est, menant l'attaque ou
parant une offensive adverse.
La
campagne aérienne de Desert Storm démarre le 16/17 janvier 1991, et
dure un bon mois. La campagne terrestre commence le 24 février 1991.
La 3ème armée a prévu, avec ses deux corps, une manoeuvre pour
bloquer l'autoroute 8, empêcher la Garde Républicaine de s'échapper
et la détruire purement et simplement. Le VIIème corps a la mission
principale. Si les Irakiens ne bougent pas, la 3ème armée a prévu
de faire pivoter à 90 degrés vers l'est ses deux corps d'armée. Le
VIIème corps doit d'abord percer la ligne irakienne tenue par les
divisions d'infanterie de deuxième ligne. Il doit ensuite rechercher
le contact avec la Garde Républicaine. Le général Franks, son
commandant, a organisé son effort en deux éléments. La 1st
ID doit percer le front, puis la 1st
Armoured Division britannique s'engouffrera dans la brèche pour
détruire les restes du VIIème corps irakien et protéger le flanc
droit du VIIème corps américain. La 1st ID rejoindra
ensuite le mouvement pour la destruction de la Garde Républicaine.
Le second élément, avec trois divisions, doit conduire une
manoeuvre d'enveloppement pour briser la Garde Républicaine en
tombant sur ses arrières.
La
1st Infantry Division attaque à 5h30
le 24 février. A 15h00, l'artillerie de la 1st ID tire 11
000 obus de 155 mm ou roquettes de MLRS sur les positions irakiennes.
La division entame le front irakien et devant cavalcadent les
bataillons de chars et les squadrons de cavalerie. Les
Américains contournent les positions fixes irakiennes, les attaquent
de flanc ou par l'arrière, remplissent les tranchées de sable avec
les bulldozers M9. A 16h16, 16 passages sont déjà prêts pour
l'exploitation. Au prix d'un mort et d'un blessé, la 1st
ID a pris les deux tiers de ses objectifs et 1 000 prisonniers.
Franks retient la reprise de l'assaut jusqu'au matin du 25 février,
pendant que la 1st Armoured Division
britannique se met en position. A 6h00, la 1st ID
repart à l'attaque, suivie dans l'après-midi par les 7 000
véhicules britanniques. Le 2nd Armored
Cavalry Regiment cherche le contact avec la Garde Républicaine
pour favoriser l'enveloppement. Ce régiment de reconnaissance a
avancé dès le 24 février de 40 km en territoire irakien. A 6h00,
appuyé par la 210th Artillery Brigade,
le régiment tombe sur des unités blindées et mécanisées de la
50ème brigade blindée, 12ème division blindée irakienne, suivie
par la 37ème brigade mécanisée, qui couvrent le déploiement de la
division mécanisée Tawakalna plus à l'est. Le bataillon irakien
est décimé par les TOW des AH-1 de la Troop O et des volées
de roquettes MLRS. Le colonel Holder, commandant du régiment, fait
reposer l'unité à la nuit : il sait qu'il est sur la route
d'au moins deux brigades irakiennes, il faut ravitailler en
munitions, et par ailleurs il veut se réorienter vers l'est pour
trouver le gros de la Garde Républicaine. Il mène néanmoins des
raids pendant la nuit pour maintenir la pression sur les Irakiens. A
2h00, le 26 février, une petite unité mécanisée irakienne attaque
le 3rd Squadron, dans
un secteur où l'on trouve des Bradley et des véhicules
de maintenance. Dans un combat confus, 9 MT-LB et un char irakien
sont détruits, 65 soldats capturés, mais 2 Bradley sont
endommagés et 2 M113 détruits, avec pertes humaines, probablement
en raison du feu ami, pour partie. Le régiment reprend la
progression dès le matin ; après avoir détruit des MT-LB et des
T-55 isolés, il signale le premier T-72 détruit à 7h13. Il entre
en contact avec le gros de la Garde Républicaine, dont le feu
d'artillerie précis endommage un char M1A1 à 8h45. A midi, le
1st Squadron a déjà détruit deux
douzaines de T-55 et une douzaine de véhicules blindés. A 3h30, le
2nd Squadron entre dans la zone de
sécurité de la division Tawakalna. Le capitaine McMaster, de la
Troop E, doit repousser une contre-attaque irakienne et
détruit la moitié du bataillon engagé. Le 3rd
Squadron aborde le même môle de résistance plus au sud. Il
repousse également une contre-attaque menée par une compagnie de
T-72. Le colonel Holder joue cependant la prudence car ses squadrons
ne peuvent emporter une position défendue par 6 ou 7 bataillons
irakiens. La Troop G du 2nd
Squadron bute sur un bataillon de la 18ème brigade mécanisée à
16h15, à 73 Easting. Un Bradley est détruit par un
obus irakien à 17h45. Une mêlée à courte portée se développe,
les combats sont furieux : la Troop G détruit au moins
deux compagnies de chars irakiens. Le régiment a accompli sa mission
en décelant le flanc gauche de la Tawakalna, détruisant la 50ème
brigade mécanisée, un bataillon d'infanterie mécanisée de la
18ème brigade mécanisée, et des centaines d'autres véhicules. La
1st ID prend le relais, passe à travers le régiment et
attaque la 9ème brigade blindée et les 18ème et 37ème brigades
mécanisées. A l'aube, les trois brigades irakiennes laissent sur le
terrain 200 chars et des centaines de véhicules blindés détruits.
Au nord, la 3rd Armored Division
détruit le dispositif central de la Tawakalna.
La
3rd Armored Division bouscule les
restes de la 50ème brigade blindée puis bute sur le dispositif
central de la Tawakalna à 16h30, le 26 février. Il y a 6
bataillons, 2 blindés et 4 mécanisés, de deux brigades (29ème
mécanisée et 9ème blindée), étalés sur 20 km. On trouve en
outre dans le secteur un bataillon de la 46ème brigade mécanisée,
12ème division blindée, et un bataillon de T-62, peut-être de la
10ème division blindée. En tout, 9 bataillons lourds irakiens
contre 10 américains. Le général Funk deploie sa division, en
gros, en V inversé en direction de l'est. La 2nd
Brigade forme la branche nord du V, la 1st
Brigade la branche sud, la 3rd
Brigade est au centre. Chaque brigade est soutenue par de
l'artillerie de la 42nd Field Artillery
Brigade. Une compagnie d'Apaches du 2nd
Battalion, 27th Attack Helicopter Regiment accompagne chaque
formation. Le commandant de division dispose des MLRS et au sud, le
4th Squadron/7th
Cavalryéclaire le dispositif en lien avec le 2nd
Armored Cavalry Regiment. La 1st
Brigade avance sur un front étroit de 5 km, en coin. A 17h00,
elle bute dans le bataillon renforcé, au nord du dispositif de la
9ème brigade blindée. La bataille dure jusqu'à 9h00, les Irakiens
tentant d'utiliser leurs T-72 pour envelopper les Américains. A
18h00, la Troop A du 4th Squadron
tombe sur un point fort irakien et doit se replier : dans la
confusion, un char M1A1 de la TF 4-34 Armor tire sur un
Bradley et tue un membre d'équipage, et le 2nd
Armored Cavalry Squadron, au sud, endommage un autre Bradley. 10
des 13 M3 ont été touchés par les Irakiens, avec en tout 2 tués
et 12 blessés. A 16h45, le 26 février, Funk fait avancer la 2nd
Brigade du colonel
Higgins avec quasiment toute l'artillerie de deux brigades en soutien
et le bataillon d'Apaches. A 22h00, la 2nd
Brigade entame le dispositif de la 29ème brigade mécanisée
irakienne. A 2h00, la première ligne défensive est brisée. Funk
introduit la 3rd Brigade qui
piétinait d'impatience en arrière : au matin du 27 février,
deux brigades blindés irakiennes ont été anéanties. La 1st
Armored Division détruit un bataillon de chars au nord du
secteur tenu par la Tawakalna. Le VIIème corps a fixé cette
division avec 6 brigades et un régiment de cavalerie blindé et l'a
enveloppé par le nord et par le sud avec deux autres brigades. Seule
l'application méthodique de la doctrine AirLand Battle, et la
magnifique performance des équipages de chars américains, sont
venues à bout de la résistance de la Tawakalna, qui n'avait pas un
moral de vaincu, loin s'en faut. La 1st
Armored Division approche, le 27 février, des positions de la
division blindée Medina.
Ce
jour-là, l'armée irakienne tente de repousser la percée vers
Bassorah, avec la division Medina. Au sud, sur 50 km, à l'ouest de
la frontière du Koweït, on trouve des éléments des 10ème, 12ème
et 17ème divisions blindées et d'autres unités. Le commandement
irakien cherche à tenir le plus longtemps possible pour évacuer le
Koweït. La 2ème brigade blindée de la division Medina compte sur
le mauvais temps qui paralyse l'action des A-10, notamment. Ses
positions sont mal préparées. A 12h17, les chars de la 2nd
Brigade de la 1st AD américaine ouvrent le feu sur
les Irakiens surpris entre 2 et 4 km de distance, avec les visées
thermiques. L'artillerie irakienne tire sur des coordonnées
pré-enregistrées, sans résultat : la contre-batterie
américaine des 155 pulvérise les batteries qui se sont dévoilées
en quelques minutes. Les A-10 et les Apaches n'arrivent que
dans l'après-midi, mais en moins d'une heure, la brigade du colonel
Meigs a détruit la 2ème brigade blindée irakienne. Au sud, la 1st
Brigade pénètre aussi dans le dispositif de la Medina, tandis
que la 3rd Brigade aborde son flanc
gauche à 13h00. Dans le dernier cas, Apaches et appareils de
l'USAF sont également de la partie. La division Medina est détruite. Cette bataille illustre sans nul doute mieux que les
autres la combinaison des armes souhaitée par la doctrine mise en
place après le Viêtnam.
Le
28 février, l'armée irakienne est en pleine retraite sur l'Euphrate
et reste concentrée autour de Bassorah. Le VIIème corps occupe le
Koweït et la 24th Infantry Division
(Mechanized) et le 3rd Armored
Cavalry Regiment bloquent les routes d'échappée au sud de
l'Euphrate. A 8h00, le président Bush ordonne un cessez-le-feu pour
permettre à Saddam Hussein de négocier. 2 des 3 divisions lourdes de
la Garde Républicaine sont détruites, la troisième, Hammourabi,
est prisonnière dans la poche de Bassorah. Malgré le cessez-le-feu,
les combats continuent. Une brigade de la Hammourabi tente de
forcer le passage sur l'autoroute 8, le 2 mars, à travers la 24th
ID. La 1st Brigade de cette unité
brise l'assaut irakien : 185 véhicules blindés, 400 camions et
une trentaine de pièces d'artillerie restent sur le terrain.
Pour
en savoir plus :
Stephen
A. BOURQUE, « The Hundred-Hour Thunderbolt : Armor in the
Gulf War », in George F. HOFMAN, Donn A. STARRY, Camp Colt
to Desert Storm. The History of U.S. Armored Forces, The
University Press o Kentucky, 1999, p.497-531.
Pour aller plus loin, on peut lire du même auteur :
Pour aller plus loin, on peut lire du même auteur :
Stephen A. Bourque, "CORRECTING MYTHS ABOUT THE PERSIAN GULF WAR: THE LAST STAND OF THE TAWAKALNA", The Middle East Journal, Volume 51, Number 4, autumn 1997.
On relira aussi la partie concernée du gros article d'Adrien FONTANELLAZ, à propos de la Garde Républicaine irakienne, "l'autre côté de la colline", donc.
http://histoiresmilitaires.blogspot.fr/2012/09/une-breve-histoire-de-la-garde.html
On relira aussi la partie concernée du gros article d'Adrien FONTANELLAZ, à propos de la Garde Républicaine irakienne, "l'autre côté de la colline", donc.
http://histoiresmilitaires.blogspot.fr/2012/09/une-breve-histoire-de-la-garde.html
↧
↧
Publication : 2ème Guerre Mondiale Thématique n°34, l'enfer du combat urbain (1939-1945)-février/avril 2014
Le nouveau thématique de 2ème Guerre Mondiale est disponible à la vente. Il porte sur les combats urbains de la Seconde Guerre mondiale.
La dimension du combat urbain pendant le conflit m'intéresse depuis longtemps. J'ai eu l'occasion, dans d'autres articles, d'évoquer certains cas précis, que l'on retrouvera moins développés dans ce numéro parfois. Ici, il s'agit surtout de brosser un portrait large : quelle est l'appréhension du combat urbain par les belligérants avant la guerre, comment y réagissent-ils quand ils sont confrontés, et ces adaptations garantissent-elles le succès, ou sinon, l'échec ?
Comme souvent, la difficulté tient aux sources disponibles. S'il existe de nombreux travaux sur des combats urbains précis -j'en cite un certain nombre en bibliographie-, il n'existe pas à ma connaissance de synthèse assez complète pour englober l'ensemble de la problématique du combat urbain pendant la Seconde Guerre mondiale, de la théorie à la pratique et ses évolutions. Les seuls éléments disponibles s'intéressent d'ailleurs plus à l'Europe de l'ouest qu'au front de l'est et au Pacifique. Il a donc fallu "bricoler" avec les sources disponibles. J'ai choisi volontairement deux exemples connus, Arnhem en 1944, et Stalingrad en 1942-1943, pour les aborder sous un angle plus original que le sempiternel récit souvent germanocentré. Le troisième exemple, Taierzhuang, pendant la guerre sino-japonaise, en 1938, est quasiment inconnu. Dans chaque chapitre, je présente également d'autres exemples de combat urbain pour comparer avec les cas étudiés. Après une introduction générale, il y a donc un découpage par front, puis une conclusion d'ensemble. L'important, à mon sens, est que les sources sont mentionnées, en notes et dans la bibliographie finale. Au moins, le lecteur sait d'où vient l'information et peut s'y reporter.
J'essaierai si possible de faire une vidéo et de rajouter un ou deux suppléments. Bonne lecture. !
↧
L'autre côté de la colline : Perdre la guerre froide. La somme de toutes les erreurs (2/2)
Depuis hier sur L'autre côté de la colline, vous pouvez lire la deuxième partie de l'article de J. Percheron sur la guerre froide. Bonne lecture.
↧
Les Sacrifiés (They Were Expendable) de John Ford (1945)
Décembre 1941. Un squadron de vedettes lance-torpilles PT, sous le commandement du lieutenant Brickley (Robert Montgomery), est expédiée à Manille pour protéger les Philippines contre une éventuelle agression japonaise. Mais ils sont considérés comme quantité négligeable par le commandement militaire local. Un des officiers de Brickley, le lieutenant"Rusty" Ryan (John Wayne), dégoûté de tant de mépris, commence à rédiger une lettre pour être transféré sur destroyer. Mais la nouvelle de l'attaque sur Pearl Harbor le fait changer d'avis. Bientôt, les vedettes lance-torpilles subissent un premier raid aérien japonaise et se défendent vaille que vaille, prouvant leur utilité. Elles vont être engagées sur tous les fronts...
They Were Expendable a été réalisé par John Ford, un réalisateur de légende aux Etats-Unis. Pendant la guerre, il est commandant dans la réserve de l'US Navy, chef de l'unité photo de l'OSS, et tourne plusieurs documentaires de renom, dont celui sur la bataille de Midway (1942), où il est blessé. Présent à Omaha Beach le 6 juin 1944, il observe le débarquement de la première vague et pose lui-même pied à terre avec les US Coast Guards plus tard. Il n'a jamais hésité à s'exposer au feu pour les besoins du tournage de ses documentaires. They Were Expendable est le dernier film qu'il ait réalisé pendant la guerre ; John Ford ne l'aimait pas, et pourtant, il y avait consacré de l'argent. Il est sorti quelques mois après la fin des hostilités. Ford a été manifestement très dur sur le tournage avec John Wayne, qui a été exempté du service militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Wayne en concevra d'ailleurs beaucoup d'amertume, ce qui explique sans doute le ton ouvertement patriotique de nombre de ses films d'après-guerre. Quand Ford a des problèmes de santé, il se repose sur Montgomery -qui lui a en plus vraiment commandé une vedette lance-torpilles pendant la guerre- pour la réalisation -celui-ci finira, à terme, réalisateur lui-même. C'est d'ailleurs le seul de film de guerre de John Ford, et il transpire l'authenticité : pas d'héroïsme, mais le parcours d'hommes au départ méprisés -ceux des vedettes lance-torpilles- et qui font beaucoup, en réalité, au milieu de la débâcle des Philippines, moment qui n'a rien de glorieux ou presque pour l'armée américaine. La romance fait d'ailleurs plus décoration qu'autre chose. Le film s'assimile presque à un documentaire.
Le film a reçu un soutien important de l'US Navy et a été tourné à Biscaine Key et Florida Keys, zones qui ressemblaient au Pacifique. Des vedettes lance-torpilles PT de classe Elco sont fournies, de même que des appareils américains des bases avoisinantes, que l'on reconnaît aisément, pour simuler les avions japonais.
↧
Krisztian UNGVARY, Battle for Budapest. 100 Days in World War II, I.B. Tauris, 2011, 366 p.
Ce livre, paru en anglais en 2003, est en fait la traduction d'un ouvrage hongrois écrit par K. Ungvary, sorti initialement en 1999. Istvan Deak, le préfacier, souligne combien le siège de Budapest, pour une capitale européenne, a été long et coûteux. Il commence en novembre 1944 et dure jusqu'au 13 février 1945, avec un million de civils pris au piège dans la ville, dont plus de 100 000 Juifs. 40 000 d'entre eux, au moins, y sont tués. Le traducteur, Ladislaus Löb, est lui-même un survivant du massacre des Juifs hongrois. Comme le rappelle Deak, on peut déjà noter que l'un des atouts principaux du livre est sa volonté de dépasser la simple "histoire bataille" du siège de Budapest, pour fournir quelque chose de plus profond, un essai d'histoire globale du siège en quelque sorte. Loin de s'épancher sur la défense "héroïque" des forces germano-hongroises et sur les crimes de l'Armée Rouge, comme de nombreux articles de magazines, l'historien raconte au contraire les faiblesses et tiraillements de la défense, le traitement des civils par les deux camps, et offre ainsi un portrait plus nuancé des Soviétiques -bien que le manque de sources ne lui permette pas d'être définitif. On le sent néanmoins déterminé à balayer les enjeux d'une bataille qui vit périr au bas mot 160 000 personnes, combattants et civils mêlés. Comme il le dit lui-même, Ungvary s'est surtout reposé sur les témoignages hongrois (en plus des documents d'archives) pour illustrer son propos, les témoignages allemands étant sujet à caution, souvent, et les témoignages soviétiques étant difficilement accessibles.
Dans l'introduction, il revient sur l'engagement de la Hongrie de l'amiral Horthy aux côtés de l'Allemagne, avec la montée en puissance des Croix Fléchées dès 1938. La Hongrie participe à la campagne contre la Yougoslavie puis à l'invasion de l'URSS ; mais l'Angleterre, par exemple, ne déclare la guerre à la Hongrie, sous la pression soviétique, que le 7 décembre 1941. La Hongrie entame pourtant des négociations secrètes avec les alliés occidentaux dès 1942, à tel point que les Allemands finissent par occuper le pays, le 19 mars 1944, pour prévenir toute défection. Les nazis en profitent pour déporter la communauté juive hongroise -plus de 400 000 personnes, sur 700 000, le sont jusqu'en juin. Le 15 octobre, alors que les Soviétiques se rapprochent des frontières de la Hongrie, Horty annonce son intention de conclure une paix séparée avec les Alliés. Il est immédiatement déposé par la réaction allemande qui installe à sa place Szalasi, le chef des Croix Fléchées. L'aviation alliée commence alors à bombarder la Hongrie, ce qu'elle avait fait de manière limitée jusque là.
Après l'effondrement de la Roumanie et son revirement en août 1944, la Hongrie se retrouve fortement exposée à l'invasion soviétique. Un coup d'arrêt temporaire survient en octobre lors des combats de chars autour de Debrecen, mais l'Armée Rouge n'est plus qu'à 100 km de Budapest. Staline charge le 2ème front d'Ukraine de Malinovsky de s'emparer de la capitale hongroise. Les Allemands ont commencé à transférer des renforts en Hongrie. Mais en réalité, les hommes et le matériel manquent cruellement. La ville n'est mise en état de défense qu'en septembre-octobre par les Hongrois. Une première pointe blindée soviétique arrive à 10-15 km au sud/sud-est de Budapest le 2 novembre, avant d'être détruite. Malinovsky reçoit alors de Staline le renfort du 4ème front d'Ukraine, alors que les Allemands comme les Hongrois sont bien démunis en armes antichars pour repousser les T-34. Le 3ème front d'Ukraine de Tolboukhine arrive par le sud-ouest de la ville, tandis que Malinovsky cherche à la déborder par le nord et par le sud. En réalité, les Hongrois ne tiennent pas à mener un combat de rues dans Budapest, contrairement à Hitler, qui exige que la ville soit tenue dès le mois d'octobre, et en charge le III. Panzerkorps de Breith. Quand il fait de Budapest une forteresse, le 1er décembre, le commandement est déjà confus : à la Werhmacht se rajoute la Waffen-SS, le général Pfeffer-Wildenbruch commandant la garnison, mais aussi l'aile diplomatique de la SS avec Winkelmann, qui commande les forces de police. La situation se clarifie début décembre avec le retrait de Winkelmann et de la Werhmacht, ce qui laisse la Waffen-SS seule aux commandes. Mais face à un ennemi très supérieur, le moral des Hongrois est chancelant, les désertions se multiplient.
Si Pest, la ville récente, a fait l'objet de préparatifs de défense, il n'en est rien pour Buda, la vieille ville. Or, le matin du 24 décembre, la veille de Noël, les T-34 font irruption aux lisières du centre ancien. Il faut battre le rappel d'unités improvisées, hongroises et allemandes, pour les rejeter hors de la ville. Les Soviétiques, pour se prévenir de tout problème, bâtissent un anneau d'encerclement extérieur autour de Buda et un autre intérieur, tourné contre la ville elle-même. L'encerclement est complété le 27 décembre 1944. Le nombre de défenseurs est difficile à établir avec précision. Peut-être 50 000 Hongrois et 45 000 Allemands au 31 décembre. L'armée hongroise loyaliste a déjà souffert de sérieuses pertes, même si l'artillerie est en bon état. Les Allemands tendent à se décharger de leurs revers sur les Hongrois ; en réalité, ils manquent d'infanterie et la valeur de leurs unités est inégale. Le ravitaillement par air est insuffisant et les soldats ne peuvent même pas se préoccuper des civils, de ce point de vue. Les Soviétiques, renforcés des Roumains, ont la supériorité numérique et matérielle, mais la valeur des formations est également disparate -même si l'effectif combattant est beaucoup plus élevé dans les divisions de fusiliers, comparativement aux divisions allemandes. Pfeiffer-Wildenbruch, le commandant allemand, est avant tout un général politique, pas forcément très compétent sur le plan militaire. Il entretient les plus mauvaises relations avec Hindy, l'officier supérieur hongrois, qui a joué un rôle clé le 15 octobre précédent pour appuyer les Croix Fléchées. En face, Malinovsky et Tolboukhine, un tandem de généraux soviétiques moins connus, mais qui n'en feront pas moins preuve d'une réelle efficacité. Dans Budapest se forment des unités spontanées de volontaires, comme le bataillon Vannay, presque aussi solide que les formations régulières, mais décimé en décembre à Buda. Les formations des Croix Fléchées sont de valeur douteuse, au contraire du bataillon des étudiants de Budapest, très motivé.
Malinovsky pense emporter Pest avec trois corps de fusiliers, dès le 23 décembre. L'attaque commence en réalité le 25 décembre. La 8ème division de cavalerie SS a été rapatriée à Buda la veille. Les combats continuent jusqu'au 28 décembre, date à laquelle les Soviétiques envoient des émissaires pour entamer des négociations. Deux capitaines sont dépêchés, à Buda et à Pest, le lendemain. Mais les deux sont tués, dans des circonstances peu claires, qui apparemment doivent autant à la non-préparation soviétique qu'au mépris de l'adversaire par les Allemands. Le 30 décembre, les Soviétiques repartent à l'assaut de Pest, avec une débauche de puissance de feu. Les Allemands parviennent temporairement à se ravitailler grâce à une barge qui remonte le Danube. Dans le combat de rues, l'Armée Rouge met en pratique le savoir hérité de Stalingrad. Les corps soviétiques ne coordonnent par contre pas assez leur action entre eux. Les Allemands sont mixés avec les Hongrois pour prévenir les défections. Le général Schmidhuber, commandant la 13. Panzerdivision, commande les forces à Pest. Les Soviétiques lancent une nouvelle offensive le 5 janvier 1945. Le 7ème corps d'armée roumain, qui combat avec l'Armée Rouge, souffre particulièrement dans les combats de rues. Le 17 janvier, les Allemands évacuent Pest, font sauter les ponts sur le Danube, tandis que l'Armée Rouge met encore deux jours à nettoyer les dernières poches de résistance. A Buda, les Soviétiques, fin décembre, ne sont qu'à 2 km du Danube. Le bataillon Vannay se sacrifie littéralement dans la défense des lignes. Les Soviétiques subissent des pertes importantes, en particulier, en essayant de prendre les hauteurs qui dominent Buda, au sud. Le transfert des unités venant de Pest soulage un peu la défense. Les Soviétiques s'emparent aussi, à partir du 19 janvier, de l'île Margit, sur le Danube. Malgré les trois tentatives de dégagement extérieur, à partir du 1er janvier, Hitler ordonne, le 27, de tenir la ville jusqu'au dernier homme. L'Armée Rouge tente de tronçonner Buda en deux morceaux. La vieille ville tient jusqu'au 11 février.
Les Allemands engagent leurs maigres réserves blindées, dont ils auraient eu bien besoin ailleurs, non pour secourir la garnison mais pour rétablir un corridor et expédier des renforts dans la ville. Otto Gille, vétéran de la percée de Tcherkassy, emmène le IV. SS-Panzerkorps et quelques autres unités pour mener à bien la mission. Les Soviétiques n'auront que plus de facilité à percer le front pendant l'opération Vistule-Oder en Pologne. Pour dégager Budapest, l'option nord (opération Konrad) est sélectionnée. L'opération Konrad I, lancée le 1er janvier, démarre alors même que l'ensemble des forces n'est pas encore arrivé. Or, Malinovsky et Tolboukhine ont conservé des réserves en cas de contre-attaques allemandes, qui interviennent rapidement. En outre le terrain choisi pour l'attaque est difficile. L'opération Konrad II privilégie cette fois l'option sud, le 7 janvier. Les Allemands progressent mieux, mais au bout d'une semaine, la contre-attaque est arrêtée. La troisième contre-attaque, Konrad III, déclenchée le 17 janvier, prend les Soviétiques par surprise, entre le lac Balaton et Szekesfehervar. Les pointes blindées atteignent le Danube, mais ne peuvent s'y maintenir.
La garnison, pendant ce temps, a préparé une sortie. Il ne reste quasiment plus d'artillerie et de blindés, les survivants étant détruits pour bonne partie avant le départ. Les Soviétiques se doutent de quelque chose et ont préparé des défenses sur les axes possibles de sortie, même s'ils ignorent la date. La première vague attaque au soir du 11 février, et parvient à percer les lignes soviétiques. Mais les pertes sont lourdes. Schmidhuber, le commandant de la 13. Panzerdivision, est tué. Au matin du 12 février, environ 16 000 personnes, dont des civils, se sont extirpés de Buda. Certains Waffen-SS se suicident pour ne pas tomber aux mains des Soviétiques, parmi ceux restés dans la ville. Sur les 28 000 soldats qui ont pris part à la percée, 700 à peine atteignent les lignes allemandes à l'ouest. Environ 5 000 hommes sont restés autour du château de Buda, où s'entassent, dans les bunkers souterrains, plus de 2 000 blessés. Des incendies tuent plusieurs centaines de ces derniers. Au 11 février, la garnison comptait 43 900 soldats ; 22 350 sont prisonniers le 15, 17 000 ont été tués.
Les civils sont pris au piège des combats de rues. Le 2 novembre 1944, au début même du siège, un pont entre Pest et l'île Margit explose, dans la confusion, tuant peut-être 600 personnes. 100 000 personnes seulement quittent la ville avant l'encerclement. Les civils restants sont requis pour préparer les défenses. La situation alimentaire s'aggrave dès le mois de novembre, forçant au rationnement. Les civils s'entassent par centaines ou milliers dans des abris. Les rixes sur la nourriture, l'approvisionnement en eau, la lessive, sont fréquentes. Les relations entre les Croix Fléchées, qui font régner la terreur dans la ville, et l'armée hongroise, sont tendues, bien meilleures avec les Allemands. Les animaux du zoo sont dépecés, d'autres s'échappent et sont abattus ensuite. Un lion se cache dans les tunnels souterrains, avant d'être capturé par le commandant soviétique de Budapest. Dès le 15 octobre, la persécution contre les Juifs reprend. Eichmann est de retour dans la ville le 18. Rassemblés, les Juifs sont préparés à la déportation ou exécutés en masse le long du Danube. Les survivants, confinés dans un ghetto, sont victimes des exactions des Croix Fléchées. Parallèllement, des mouvements de résistance se sont développés dans Budapest. De nombreux officiers hongrois ayant fait défection sont renvoyés par les Soviétiques derrière les lignes pour organiser des réseaux. Les communistes réalisent des attentats à la bombe, les Juifs luttent pour leur survie. L'OSS parachute un lieutenant d'origine hongroise et les Britanniques 22 Canadiens de même origine, dont un seul échappe à la capture. Les Soviétiques eux-mêmes conduisent des opérations de reconnaissance dans Budapest. L'Armée Rouge envoie plus de 700 soldats hongrois pour provoquer d'autres défections, avec un certain succès. Des unités entières finissent par passer à l'ennemi. Les volontaires sont rattachés aux corps de fusiliers soviétiques et se voient confier les missions les plus dangereuses, entraînant de 50 à 80% de pertes. Plus de 2 500 Hongrois ont combattu du côté soviétique, dont 600 ont été tués. Les Soviétiques, de leur côté, exécutent souvent les Waffen-SS faits prisonniers, les auxiliaires russes de la Wehrmacht, et même les blessés. Ces exécutions n'ont rien d'organisé, elles sont spontanées, même si le commandement soviétique en est bien conscient. Mais il y a aussi des cas où les soldats soviétiques laissent s'enfuir des prisonniers hongrois. Durant la dernière phase du siège, les Allemands ont commis de nombreux pillages et des destructions de biens. Pour les Soviétiques, les exactions sont parfois organisées d'en haut : pillage des biens de valeur (oeuvres d'art, etc), nettoyage paraoïaque, notamment face aux communistes hongrois ou aux Juifs, dont beaucoup étaient résistants. Les Soviétiques se sont parfois servis des civils comme boucliers humains et Malinovsky, après la chute de Budapest, accorde trois jours de pillage. Les déprédations sont plus importantes là où la résistance a été la plus forte, comme dans certains secteurs de Buda. Il n'y a aucune statistique fiable sur les viols à Budapest. En extrapolant à partir du cas allemand -lui aussi mal documenté- et de chiffres plus établis pour d'autres villes hongroises, Ungvary penche pour 10% de la population. Mais les Soviétiques ne touchent pas les enfants, et ont un grand respect pour les docteurs et même les écrivains. Les déserteurs soviétiques continuent cependant de semer l'insécurité dans Budapest au moins jusqu'en février 1946 (8 braquages avec meurtre en un seul jour !). Les Soviétiques rétablissent progressivement l'ordre et le ravitaillement, rouvrent un cinéma à Pest dès le 6 février 1945 (en pleine bataille). La population tombe à 830 000 habitants en avril.
Le siège de Budapest, en tout, a probablement entraîné 80 000 tués et plus de 240 000 blessés côté soviétique. La moitié des pertes soviétiques en Hongrie a été subie dans la capitale, dont 55% dans les combats de rues. Les Allemands ont consommé des ressources importantes pour tenter de sauver la Hongrie : la moitié des divisions de Panzer s'y trouve en mars 1945, alors que l'Armée Rouge est à 60 km de Berlin. Les Allemands et les Hongrois perdent dans la ville 3 000 hommes par semaine. Le siège a duré longtemps car la garnison, sensible à la propagande nazie, n'a pas voulu baisser les armes devant l'Armée Rouge, de peur de son sort.
L'ouvrage, assez complet, si l'on excepte le côté soviétique moins documenté, est appuyé par pas moins de 16 cartes dispersées au fil du texte, pas toujours très lisibles, mais utiles pour suivre les opérations. D'autant que des illustrations complètent le tout, et certaines fort peu connues. Il y a également en fin d'ouvrage plus d'une vingtaine de tableaux statistiques, sur les forces en présence, les pertes subies, etc. Très utiles pour avoir des chiffres importants sous la main. La bibliographie suit les tables. On apprécie en particulier que l'auteur ait cherché non pas mal à livrer un simple récit de la bataille uniquement germanocentré, ou focalisé sur les tentatives de dégagement, comme souvent, mais bien une appréhension globale du siège, comme le montre la dernière partie sur le sort des civils et la vie dans la cité en guerre.
↧
↧
Jean-François MURACCIOLE, La libération de Paris 19-26 août 1944, L'histoire en batailles, Paris, Tallandier, 2013, 298 p.
La collection L'histoire en batailles de Tallandier s'est enrichie l'an passé d'un titre consacré à la libération de Paris, en août 1944. Il a été écrit par Jean-François Muracciole, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Montpellier III, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, et de la Résistance en particulier, qui intervient parfois dans le magazine 2ème Guerre Mondiale.
Comme il le souligne en introduction, la libération de Paris constitue un paradoxe : événement fameux, elle est pourtant boudée par les historiens, même si une énorme masse de témoignages d'acteurs paraît quelques mois après la fin des événements et au-delà, à commencer par celui du général von Choltitz. En revanche, on ne compte que quelques ouvrages d'historiens (4 en français, plus les travaux étrangers) consacrés à la question. Jean-François Muracciole insiste sur le fait que la trame événementielle est bien établie : aucune surprise majeure à attendre donc. En outre la libération de Paris, sur le plan militaire, a tout d'un affrontement secondaire. En revanche, son importante symbolique est énorme : l'enjeu de la bataille est bien politique, entre Vichy, De Gaulle, les communistes, la résistance intérieure et Von Choltitz. Si De Gaulle sort vainqueur, c'est grâce à l'appui d'Eisenhower, et au ralliement de la police parisienne, pourtant instrument de la politique de répression de Vichy.
L'historien commence par rappeler les enjeux de la bataille. La prise de Paris se situe dans une pause stratégique : les Allemands, en pleine retraite, n'ont guère l'intention de faire de la capitale française un nouveau Stalingrad et les Alliés, en proie au début d'une crise logistique, ne veulent pas prendre la ville pour ne pas avoir à la ravitailler. Paris ne subit pourtant pas le sort de Varsovie, dont la population, qui se soulève derrière l'Armée Intérieure, est impitoyablement réprimée au même moment : deux logiques de guerre différentes. En outre, sur le plan politique, les résistances française et polonaise, y compris dans la dimension communiste, ne bénéficient pas de la même place, côté allié. Pour les Allemands, Paris n'est qu'un itinéraire secondaire de repli -on estime que 10% peut-être des troupes en retraite y sont passés. Les Alliés cherchent eux à déborder Paris par le nord et par le sud. Côté allemand, le haut-commandement en France est en pleine réorganisation après avoir été décapité suite à la répression de l'attentat du 20 juillet. Von Choltitz n'arrive à Paris que le 9 août. Le général allemand n'est pas seulement le personnage presque sympathique que l'on peut voir dans le film Paris brûle-t-il ? : il a pris part à la guerre à l'est, n'a pas bronché devant les massacres de civils, n'a pas pris part au complot du 20 juillet, c'est c'est cette fidélité qui lui vaut sa nomination. Von Choltitz n'a pas de grandes forces à sa disposition : 17 000, dont 11 000 hors de Paris, quelques dizaines de chars et d'automitrailleuses, le même nombre de canons, une brigade de DCA avec des 88. Le plan allemand prévoit de se battre d'abord à l'extérieur de la ville, à l'ouest et au sud. Dans la ville, les Allemands bâtissent une douzaine de points fortifiés. Le plan s'inspire de ceux prévus pour la défense de Paris depuis le XIXème siècle. La Résistance n'a pas les moyens, seule, d'en venir à bout. Eisenhower, au départ, ne veut pas prendre la ville pour ne pas être mêlé aux déchirements politiques de la France Libre. Il y consent, mais n'envoie que des forces limitées. La situation alimentaire s'aggrave pour les 5 millions d'habitants de Paris après le 6 juin 1944, l'atmosphère est à la fois dramatique et électrique en juillet, avec la progression des armées alliées.
Mais la bataille de Paris est avant tout une bataille politique. Les Américains envisagent de place la France sous administration militaire, comme en Italie. Ce qui nie toute autorité au CFLN, qui anticipe le débarquement en formant un corps d'officiers de liaison. De Gaulle gagne cependant la partie peu de temps après le débarquement, car Eisenhower constate que les services américains prévus sont bien moins efficaces que le personnel envoyé par le CFLN. En outre, De Gaulle renforce sa position par un voyage aux Etats-Unis en juillet, même si la reconnaissance officielle ne vient que le 23 octobre. Le CFLN a travaillé dès 1943 pour créer les commissaires de la République, sorte de super préfets chargés d'assurer la transition politique, puis pour regrouper la Résistance dans les FFI (1er février 1944). Pour De Gaulle, l'insurrection est légitime, à condition qu'elle soit encadrée. Il prêche néanmoins la prudence pour des raisons militaires et politiques. Le 14 août 1944, il nomme Parodi ministre du GPRF dans ce sens. En outre, il dispose de la 2ème DB, unité "blanchie" en Afrique du Nord, et qui a fait l'amalgame entre France Libre, armée d'Afrique et autres contingents hétéroclites (républicains espagnols). Le PCF a-t-il cherché à fomenter une insurrection parisienne pour couper l'herbe sous le pied à De Gaulle ? En réalité, l'histoire est plus complexe : le PCF mène une double stratégie, insurrectionnelle et légaliste, pour conquérir la résistance intérieure, la séparer du gouvernement d'Alger et pour diriger finalement l'insurrection. Pour la première fois de son histoire, le PCF fait partie d'un gouvernement. Les communistes sont minoritaires à Paris mais profitent des divisions de leurs adversaires. Le PCF cherche à déclencher l'insurrection partout où il le peut, se reposant sur les milices patriotiques, créées en janvier 1944. Mais à l'été, il surestime probablement ses moyens. En revanche, le parti cherche à s'emparer des municipalités pour en faire ses bastions, avec parfois un succès certain. Le maréchal Pétain a été acclamé par 200 000 personnes, à Paris, le 26 avril 1944. Les collaborationnistes s'enfuient à l'été car les Allemands ne veulent pas les armer, de peur de déclencher une véritable guerre civile ; la Milice est cependant particulièrement active à l'approche des alliés et multiplie les exécutions. Laval tente d'ultimes manoeuvres avec Herriot, qui échouent. Pétain, qui tente en vain d'organiser une "transmission de pouvoirs"à De Gaulle, est déménagé par les Allemands le 19 août à Belfort, puis à Sigmaringen. Les autorités de Vichy s'évanouissent rapidement devant la progression des Alliés. D'intenses négociations ont lieu pour faire libérer les détenus des prisons parisiennes : plus de 3 400 sont finalement libérés, mais les SS refusent obstinément, jusqu'au dernier moment, de relâcher les Juifs ; des convois partent vers les camps de la mort les 17-18 août. La Délégation Générale, dirigée par Parodi, est la pièce maîtresse de l'Etat clandestin ; De Gaulle a désigné deux préfets, Luizet et Flouret, qui ne plaisent pas aux communistes, pour Paris et la Seine. L'empilement des structures dessert la Résistance. Au CNR s'ajoutent les FFI pour l'aspect militaire, et le PCF, à travers Rol-Tanguy, a investi les postes de commandement dans la région parisienne. Le Comité Parisien de Libération représente une forme originale de Comité Départemental de Libération : il est excessivement puissant par rapport à la Délégation Générale. Les FFI disposent, sur le plan militaire, de peut-être 30 000 hommes, mais 5 000 sont armés, à grand peine. En combat urbain, ce manque d'armes est plus préjudiciable encore qu'en rase-campagne. La police de Paris, forte de 21 000 hommes, soit plus que la garnison, va basculer du côté de la Résistance, alors que l'appareil répressif allemand et français a déjà quitté la capitale. Il faut souligner qu'environ 2 700 policiers ont fait partie de la Résistance (12%) à travers trois mouvements principaux.
L'atmosphère s'échauffe à Paris dès la fin juin. Une manifestation patriotique, le 14 juillet, est dispersée avec mollesse par la police. Deux jours plus tard, Chaban-Delmas, Délégué Militaire, revient de Londres et annonce que les Alliés ont l'intention de contourner Paris. Mais les communistes ne l'entendent pas de cette oreille et dès le 10 août, Rol-Tanguy appelle à l'insurrection. Les grèves commencent et s'accélèrent à partir du 15. Le 13, c'est la police qui, pour la première fois, a rejoint le mouvement. Au matin du 19 se produit l'événement décisif : les policiers en civil investissent la préfecture de police. Le ralliement modifie le rapport de forces. Les premiers coups de feu ont été tirés dans la soirée du 17 août, le CPL prend la décision de déclencher l'insurrection le lendemain, sous la pression des communistes. Parodi suit le mouvement le 19, en désaccord avec Chaban-Delmas, qui conserve la ligne prudente. Une première trêve est cependant négociée avec von Choltitz au soir du 19, via le consul de Suède Raoul Nordling. Le 20 août, les insurgés s'emparent de l'Hôtel de Ville, où s'installe symboliquement le CNR. La trêve n'est pas bien respectée, alors que Parodi, arrêté par les Allemands, est relâché par von Choltitz, auquel il a pourtant refusé de serrer la main. Le 22 août, la trêve est dénoncée. Rol-Tanguy envoie des émissaires aux Alliés, pour les prévenir, mais quand ceux-ci arrivent, en réalité, tout est joué : De Gaulle a rencontré Eisenhower, celui-ci a décidé dès le 22 de faire mouvement sur la capitale. Les barricades, plus symboliques que réellement efficaces, couvrent les rues de Paris. Les combats sont très durs les 23-24 août. Dans la soirée du 24, Leclerc envoie son fameux message par Piper Cub, et à 21h00, Dronne est à la préfecture de police. Leclerc a été rattaché à la 3ème armée de Patton, après son arrivée en Normandie au mois d'août 1944. Le 21, avant la décision d'Eisenhower, donc, il a pris sur lui d'envoyer un détachement, en éclaireur, vers Paris. La 2ème DB, soutenue par la 4ème DI américaine, se met en marche le 23 au matin. Elle fait face à la 1ère armée allemande, renforcée par les restes de la 7ème armée, le tout disposant d'un certain nombre de pièces de 88, utiles pour constituer des bouchons. Le soir, elle est déjà à Rambouillet. La DB bute sur les bouchons allemands le 24, en banlieue, où ont lieu de violents affrontements. Elle investit Paris le lendemain, et doit mener parfois de durs combats pour faire sauter les verrous allemands dans la capitale. Von Choltitz est pris en début d'après-midi, après l'assaut de l'hôtel Meurice. Leclerc lui fait signer l'acte de reddition, et Rol-Tanguy, malgré une première déconvenue, parvient à faire apposer son nom sur le document. De Gaulle arrive à Paris et réinstalle immédiatement l'autorité de l'Etat, par une série d'actes symboliques. Le défilé sur les Champs Elysées, le 26, fait figure de sacre populaire. La libération de Paris, retransmise et diffusée par les médias de l'époque, a un retentissement énorme, jusque dans les camps de concentration nazis.
Pour conclure, Jean-Françous Muracciole se demande si la bataille de Paris a bien eu lieu. Le bilan des pertes n'est pas facile à établir : 130 tués, 21 disparus et 319 blessés pour la 2ème DB, mais surtout en dehors de la capitale. Les Allemands compterait 2 800 morts et 4 900 blessés. Les chiffres sont très aléatoires pour les FFI et les civils. En tout, la bataille de Paris a peut-être causé 3 400 morts et 5 500 blessés, au moins. L'incertitude règne sur les pertes matérielles allemandes, en particulier en chars ; la 2ème DB, par contre, laisse dans l'affaire 35 blindés, 6 canons automoteurs et 111 autres véhicules. Les destructions sont minimes, à part celles causées par le bombardement de la Luftwaffe le soir du 26 août. La bataille a donc été de faible ampleur, globalement. Par contre, la résistance allemande se raidit au nord et à l'est de Paris, autour de la 47ème DI et d'autres unités éparses, une contre-attaque est même lancée le 26. La 47ème DI n'est délogée que le 29 août, et la bataille ne se termine vraiment que le lendemain. De Gaulle, pendant ce temps, met au pas le CNR et annonce le transfert des FFI dans l'armée régulière. Le PCF doit capituler dès la mi-septembre et choisir la voie légaliste : bien que puissant par certains aspects, il lui manque le contrôle de l'appareil d'Etat. Une nouvelle presse et une nouvelle radio, préparées en sous-main par la Résistance, font leur apparition. Les barricades, pendant la bataille, on surtout joué un rôle symbolique. Pour l'historien, il semble bien que l'ordre d'Hitler de miner les principaux monuments ait été volontairement saboté par von Choltitz. Celui-ci n'a pas complètement désobéi, mais n'a pas obéi non plus avec la plus grande énergie, même s'il cherche à se donner le beau rôle dans ses mémoires.
En plus des notes et de l'ordre d'opérations de la 2ème DB du 24 août 1944, le lecteur trouvera en fin d'ouvrage une bibliographie indicative, avec mémoires/documents et sources secondaires, assez courte d'ailleurs. Malheureusement, comme souvent dans la collection, il n'y a aucune illustration et seulement deux cartes, ce qui est peu. L'ouvrage, classique, est une bonne synthèse, malgré une ou deux coquilles (les 100 000 avions de la 8th USAAF p.23 ?), et d'autant plus efficace qu'il n'y en avait pour ainsi dire aucune, récente du moins. L'historien a bien su remettre en perspective la bataille -finalement secondaire- dans ses dimensions stratégique (Alliés-Allemands) et politique (De Gaulle, la France Libre, la résistance intérieure et les communistes). On aurait peut-être aimé une véritable conclusion revenant sur la mémoire et l'historiographie de l'événement, évoqués en introduction, mais qui auraient peut-être mérités un développement à part entière.
↧
L'autre côté de la colline : interview de Marc-Antoine Brillant (A. Fontanellaz)
Michel Goya a cosigné, avec Marc-Antoine Brillant, un ouvrage aux éditions du Rocher qui revient sur la guerre entre Tsahal et le Hezbollah à l'été 2006. Adrien Fontanellazest allé interroger ce dernier pour en savoir plus. Pour ma part, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire l'ouvrage en question, mais je vais tâcher. Bonne lecture !
↧
Cachez ces djihadistes que je ne saurais voir... les volontaires français en Syrie
Merci
à Timothy Holman et à Yves Trotignon pour leur aide dans la
rédaction de cet article.
Le
cas des Français partis se battre en Syrie pose un problème
particulier. Il n'est devenu vraiment visible (grâce aux médias, en
particulier) qu'en 2013, année où le nombre de volontaires croît
de manière importante. A l'image d'autres contingents européens, le
djihad en Syrie est le plus grand mouvement du genre depuis la guerre
contre les Soviétiques en Afghanistan. Pour autant, rapporté à la
population totale de la France ou même à la population musulmane de
la tranche d'âge concernée, le mouvement n'a rien d'une lame de
fond ou d'un exode massif1 ;
on peut cependant noter qu'il s'accélère depuis l'été 2013, ce
qui inquiète les autorités, et certains spécialistes, quant au
retour des djihadistes. Mais il faut dire que jusqu'ici, les
informations ont été très éparses. Le ministre de l'Intérieur,
Manuel Valls, a multiplié les déclarations, à partir de mai 2013,
au sujet du chiffre des Français impliqués dans le djihad en Syrie,
pour arriver, en janvier 2014, à un total de 700, en tout, impliqués
à un titre ou à un autre, depuis 2011. Chiffre difficile à
vérifier, mais qui semble pourtant crédible, en tout cas pas
forcément très exagéré. La dernière étude de l'ICSR, un
institut britannique spécialisé sur la problématique des
djihadistes étrangers, datée du 17 décembre 2013, plaçait
l'estimation maximum, pour la France, à 413 individus2.
Les Israëliens pensent que le dernier chiffre donné par Manuel
Valls et F. Hollande est exagéré3.
Ce que l'on peut savoir des cas bien identifiés montre pourtant que
l'exemple français ne se distingue pas fondamentalement des autres
contingents de volontaires européens, à quelques différences
près4.
Le recrutement, plutôt large au niveau de l'âge et des motivations
au début, semble depuis s'être resserré vers des hommes jeunes, de
20 à 35 ans, plus déterminés et plus radicaux dans leurs choix sur
le terrain. Il implique à la fois des personnes connues pour leur
engagement antérieur, et souvent surveillées, mais aussi beaucoup
d'hommes ou d'adolescents qui ont succombé au message radical,
notamment délivré sur le web, sans que le phénomène se limite à
des gens marginalisés sur le plan social. Comme pour l'ensemble des
autres contingents, la majorité des volontaires français rejoint
les deux formations djihadistes, le front al-Nosra (branche
officielle d'al-Qaïda en Syrie depuis novembre 2013) et l'EIIL, en
butte depuis janvier 2014 aux assauts des autres formations rebelles,
parmi lesquelles le front al-Nosra lui-même. Les zones de départ
sont assez bien identifiées : des grandes villes, Paris,
Toulouse, Nice, Strasbourg, Lille-Roubaix-Tourcoing (ce qui
correspond là encore à d'autres pays), avec une majorité de
départs spontanés ou organisés en solitaire, sans forcément qu'il
y ait recours à des réseaux organisés, la seule exception semblant
être le sud-est (ce qui est une différence notoire cette fois avec
d'autres Etats, comme la Belgique, où des réseaux plus structurés
interviennent dans l'acheminement des volontaires, voire leur
radicalisation). Les djihadistes français sont également, une fois
arrivés, assez présents sur les réseaux sociaux, à des fins de
recrutement, de propagande ou pour garder le contact avec les
familles, comme on le verra à la fin de cet article.
Un
début de publicité pour un recrutement varié ? (2012-été
2013)
En
France, la question des candidats au djihad commence à inquiéter,
dans la presse, à partir du second semestre 2012. Pourtant, dès le
mois de mai 2012, 3 jeunes gens sont interpellés à l'aéroport de
Saint-Etienne alors qu'ils s'apprêtent à partir pour la Turquie...
avec des étuis à pistolet, des talkie-walkies et des
lunettes de vision nocturne5.
Le Figaroévoque « quelques dizaines de départ »
au mois d'octobre 2012 et mentionne le docteur Jacques Bérès, qui
a soigné plusieurs Français dans un hôpital rebelle à Alep, ville
que les insurgés ont investi à l'été 20126.
Certains d'ailleurs ne cachent pas leur admiration pour Mohamed
Merah. Le même quotidien avait également parlé, au printemps 2012,
de 6 Français arrêtés par la sécurité libanaise à l'aéroport
de Beyrouth, et qui cherchaient manifestement à passer en Syrie.
Pourtant, les services de renseignement intérieurs avaient commencé
à tirer la sonnette d'alarme dès le printemps 2011.
Les
informations et les articles de presse se font plus nombreux au
printemps et à l'été 2013, moment qui connaît effectivement,
d'après les recherches des spécialistes, un accroissement sensible
du départ des volontaires européens, et donc français, vers la
Syrie, accroissement qui se confirme tout au long de l'année7.
Non seulement les volontaires français, comme les autres,
bénéficient du fait que l'accès au territoire syrien est beaucoup
plus facile que pour d'autres terres de djihad dans le passé, mais,
en outre, ils peuvent compter, parfois, sur les restes des réseaux
organisés pour les djihads précédents, comme ceux qui avaient
opéré pour l'Irak entre 2004 et 20068.
Dès le printemps 2013 et l'émergence des premiers exemples précis
de volontaires français, on constate que les motifs de départ sont
très différents. Djamel Amer Al-Khedoud, 50 ans, originaire de
Marseille et depuis prisonnier du régime, s'en va ainsi pour
défendre les sunnites de Syrie, une motivation qui correspond au
« djihad défensif » que l'on retrouve chez nombre
de volontaires étrangers, en particulier ceux des débuts, de la
période 2011-2012. Abdel Rahmane Ayachi, au contraire, Franco-Syrien
de 33 ans, lui, a rejoint le groupe Suqur al-Sham, membre du Front
Islamique depuis novembre 2013, et qui vise depuis expréssement à
l'installation d'un califat islamique et à l'application stricte et
rigoureuse de la charia. Il serait monté dans la hiérarchie
jusqu'à commander un effectif de 600 combattants9.
Ayachi, finalement tué en juin 2013, avait profité d'un
entraînement militaire dans la réserve belge, qu'il a mis à
profit, probablement, sur le champ de bataille syrien10.
Raphaël Gendron, un Français de 38 ans, faisait lui aussi partie de
Suqur al-Sham : il a été tué le 14 avril 2013. Résidant à
Bruxelles, il était proche des milieux radicaux qui ont fourni, dans
ce pays, un certain nombre de volontaires pour le djihad syrien.
Raphaël
Gendron était bien connu des services français. Condamné à
plusieurs reprises par la justice belge, il est arrêté par les
autorités italiennes fin 2009 avec Bassam Ayachi, imam franco-syrien
installé en Belgique et célèbre, lui aussi, pour ses opinions
radicales. Ils auraient voulu organiser une filière de recrutement
djihadiste pour al-Qaïda dans le sud de l'Italie. Relâchés, ils
regagnent la Belgique où ils continuent d'animer le Centre islamique
Assabyle, sur le site duquel Gendron se livre à une active
propagande. Cas très différent, celui de ce jeune djihadiste
français de 17 ans, originaire de Sartrouville, arrêté par la
police grecque le 25 mai 2013 alors qu'il tentait de gagner la
Syrie11.
Il avait prévenu ses parents de son départ le 16 mai, après avoir
acheté son billet d'avion pour Athènes et s'être muni d'un
passeport. La famille prévient la police, qui parvient à joindre
les autorités grecques : le jeune homme est arrêté dans un
bus au nord du pays, alors qu'il se dirigeait vers la Turquie.
 |
| Raphaël Gendron.-Source : http://static0.7sur7.be/static/photo/2013/2/5/9/20130415180823/media_xll_5734734.jpg |
Au
mois de juin 2013, un diplomate français haut placé évoque déjà
le chiffre de 270 Français partis se battre en Syrie12.
Un mois plus tard, un djihadiste français présent en Syrie lance un
appel vidéo à ses compatriotes et au président F. Hollande, lui
demandant de se convertir à l'islam13.
L'homme, qui se fait appeler Abou Abdelrahmane, annonce s'être
converti il y a trois ans à l'islam, et avoir des parents français
et athées. Il demande aux Français de rejoindre le djihad. Il
s'agit en fait de deux demi-frères. Jean-Daniel Pons, un Toulousain
de 22 ans, est finalement tué le 11 août. Agé de 22 ans, ce
dernier avait été entraîné par son frère aîné, Nicolas, 30
ans, que l'on voit parler sur la vidéo. Titulaire d'un BEP, Nicolas
était tombé dans la petite délinquance avant de se convertir en
2009 puis de faire du prosélytisme. Son frère Jean-Daniel l'avait
rejoint en 2011 à Toulouse pour entamer un BTS de comptabilité,
après avoir vécu avec leur père en Guyane ; il se convertit à
son tour. Ils avaient gagné la Syrie tous les deux en mars 201314.
Ils ont rejoint la Syrie via l'Espagne et la Turquie, faisant croire
à leurs proches qu'ils allaient en Thaïlande, avant de leur
dévoiler la vérité en avril15.
La mère des deux jeunes gens, retraitée de l'armée, avait signalé
la dérive inquiétante de ses fils aux autorités dès le mois
d'avril. Quelques jours plus tard, un homme de 47 ans, originaire du
territoire de Belfort, est interpellé par la DCRI : habitant à
Toulouse, il était venu rendre visite à sa famille, et aurait eu
des liens avec les deux Toulousains16
de la fameuse vidéo. Jacques Abu Abdallah al-Faransi, un Français
venant de Marseille, est également vu en juillet 2013 sur une vidéo
postée sur Youtube17.
Autre
cas bien documenté, celui de Abou Hajjar, un informaticien de la
région parisienne parti en avril 2013 pour faire le djihad en Syrie.
Cet homme combat dans le Djebel al-Zawiya, dans la province d'Idlib,
au sein du groupe Suqur al-Sham. D'après son témoignage, recueilli
par Le Figaro, il effectue des missions de reconnaissance sur
l'autoroute entre Lattaquié et Alep, pour signaler les mouvements de
troupes et de convois du régime. Il se définit lui-même comme un
« activiste islamiste » et non comme un djihadiste
proche d'al-Qaïda. Son groupe comprend, selon lui, des Saoudiens et
des Jordaniens. Il manifeste, dans ses déclarations, une certaine
ouverture dans le traitement des minorités syriennes, et explique
que son groupe cherche à convaincre, en ouvrant des bureaux de
prédication, par exemple, mais pas par la force, comme certains
djihadistes. Il ne compte pas revenir en France, où il a laissé
femme et enfants18.
Vers
une accélération du recrutement, puis un resserrement des profils ?
(automne 2013-février 2014)
Le
1er septembre 2013, Manuel Valls annonce que plus d'une centaine de
Français combattent actuellement en Syrie, qu'une dizaine y sont
morts, et que certains sont déjà revenus19.
D'autres informations parlent à la même époque de 9 Français tués
au combat dans le pays20.
En septembre, 4 hommes sont interpellés après avoir braqué un
restaurant Quick dans les Yvelines, puis un cinquième un peu
après à Châteauroux, dans l'Indre. Agés de 23 à 34 ans, ces 5
hommes étaient en fait surveillés depuis un moment par la DCRI et
la DRPP ; ils appartiennent à un groupe dont l'un des membres,
au moins, originaire de Trappes, se trouve déjà en Syrie. Ce sont
des personnes « autoradicalisées », dont deux
frères, des convertis parfois de fraîche date à l'islam. Ils
avaient été repérés lors de manifestations anti-américaines à
Paris en 2012 (rassemblement place de la Concorde, le 16 septembre,
contre le film L'Innocence des musulmans), puis lors
« d'entraînements collectifs » dans le sud de
Paris21.
Le braquage du Quick de Coignières devait servir à payer
leur voyage vers la Syrie : munis d'une arme factice, ils
avaient embarqué 2 500 euros... sous les yeux de la DCRI, qui les
interpellent dès le lendemain. Ils étaient inconnus de la justice,
sauf un seul d'entre eux condamné en 2005 pour vol aggravé22.
L'intention de financer leur voyage par un simple braquage confirme
que l'expédition pour gagner la Syrie est relativement facile, comme
on peut le constater pour d'autres contingents européens23,
et qu'elle n'implique pas forcément le recours à des réseaux
organisés (le voyage revient à 300-500 euros, en passant par la
Turquie). Ce même mois de septembre, un jeune Roubaisien trouve la
mort en Syrie. Sofiane D., 20 ans, est tué le 20 septembre à Alep.
Ses parents, inquiets, avait prévenu les autorités en juillet
2013 : il était censé être parti en Algérie. Musulman
pratiquant classique, selon un magistrat, « fusionnel »
avec sa mère, il n'avait pratiquement jamais quitté Roubaix. Il
aurait apparemment combattu dans les rangs du front al-Nosra24.
Deux autres jeunes hommes de l'endroit auraient également gagné la
Syrie25.
Romain L., 26 ans, du Calvados, est quant à lui arrêté pour
apologie du terrorisme sur Internet26.
Il était l'administrateur du site Ansar al-Haqq, traducteur
de la revue Inspire, éditée par Al-Qaïda dans la Péninsule
Arabique. Il utilisait le pseudonyme de Abou Siyad Al-Normandy. Fin
septembre, les réseaux sociaux djihadistes mettent en avant la
figure de Abu Suhaib al-Faransi, un commerçant de 63 ans converti à
l'islam, et qui fait partie des volontaires français de
l'insurrection27.
 |
| A gauche, Abu Suhaib al-Faransi -Source : http://www.memrijttm.org/image/6170.JPG |
Les
autorités française ont déjà, précédemment, arrêté Flavien
Moreau, né à Ulsan, en Corée du Sud, avant d'être adopté en
France28.
Ce Nantais de 27 ans s'était imprudemment confié, à Antioche, en
Turquie, à un journaliste suisse, en novembre 2012, ce qui l'avait
immédiatement fait repérer par la DCRI. Il est arrêté quelques
semaines plus tard à son retour en France, début 2013, et mis en
examen. Le Nantais, qui enchaînait petits boulots et peines de
prisons, s'était converti il y a cinq ans, et cherchait depuis sa
dernière sortie, en 2012, à intégrer un réseau combattant. Ayant
amassé quelques milliers d'euros grâce à divers trafics, il gagne
Zurich, puis Istanbul et finalement Antioche, avec l'intention de
rejoindre le groupe Ahrar al-Sham, aujourd'hui composante du Front
Islamique, créé le 22 novembre 2013. Sans aucune expérience du
combat, son engagement ne tient que quelques semaines, à l'issue
desquelles il regagne la France. D'autres engagements sont tout aussi
idéologiques, comme ces deux disciples de Jérémie Louis-Sydney,
le leader de la "cellule de Cannes-Torcy", soupçonné
de la tentative d'attentat contre une épicerie kasher de Sarcelles,
en 2012 ; ces deux jeunes Français d'origine tunisienne sont
depuis partis en Syrie.
 |
| Photo présumée d'Abou al-Qaaqaa.-Source : http://www.abna.ir/a/uploads/443/2/443221.jpg |
Début
octobre, un Français aurait mené une attaque kamikaze dans la
province d'Alep29.
Surnommé Abou al-Qaaqaa, ce Français se serait fait exploser le 9
octobre dans le village de Al-Hamam, au sud-est de la ville. Cette
attaque kamikaze ouvrait la voie à des combattants de l'EIIL (dont
il aurait fait partie) et du front al-Nosra. Le 24 septembre, Abou
Mohammad al-Fransi, un Français converti à l'islam, avait déjà
été tué dans le même secteur. C'est également ce mois-là que
commencent à remonter des informations sur une filière
d'acheminement des volontaires tchétchènes via l'importante
diaspora tchétchène établie dans le sud-est de la France (plus de
10 000 personnes)30.
Les estimations officielles portent alors le nombre de Français
impliqués dans les combats en Syrie à au moins 40031.
Le 14 octobre, 3 suspects de la fameuse cellule terroriste
Cannes-Torcy sont arrêtés dans les Alpes-Maritimes. Sont notamment
saisis un pistolet-mitrailleur UZI et un pistolet semi-automatique,
ainsi qu'une grande quantité d'argent en liquide. En novembre, 4
hommes de 22 à 35 ans sont interpellés dans le Val-de-Marne :
ils appartiendraient à une filière djihadiste qui acheminerait des
combattants vers la Syrie. 2 ou 3 d'entre eux auraient combattu avec
le front al-Nosra. Les chiffres passent alors à plus de 440 Français
partis pour la Syrie : la moitié est encore sur place, une
douzaine sont morts, un ou deux sont prisonniers du régime, et 50 à
60 sont revenus en France. Sur la vingtaine de procédures
déclenchées contre les volontaires de retour, seules trois ont
alors abouti à des mises en examen32.
Le 20 novembre, Abu Malik al-Faransi, un Français de 17 ans, est tué
à Raqqa33.
Le 27 novembre, c'est un homme habitant près de Lens qui est
interpellé, faisant suite à l'arrestation, le 15 octobre, de deux
autres personnes à Tourcoing et Roubaix. Ces deux personnes auraient
gagné la Syrie puis seraient revenues en France34.
 |
| Photo présumée d'Abou Malik al-Faransi.-Source : https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/1472883_317021681772971_875519586_n.jpg |
A
partir de la fin septembre 2013, le recrutement dans le sud-est de la
France semble s'intensifier, et en particulier à Nice et sa région.
Une dizaine de départs au moins est recensée à Vallauris,
Saint-Laurent et à Nice, ainsi que du côté de l'Ariane et de la
cité des Moulins, la plupart pour rejoindre le front al-Nosra. La
majorité des jeunes concernés semblent s'être radicalisés très
rapidement, avant de quitter leurs familles du jour au lendemain. En
2011, un réseau recrutait déjà, manifestement, pour le djihad en
Afghanistan dans cette région35.
Une filière pour le recrutement en Irak avait été démantelé,
également, en 2005. Une mère de la région lyonnaise signale aussi,
en décembre 2013, que son ex-mari, dont elle est séparée depuis
juillet 2012, a visiblement enlevé sa fille pour gagner la Syrie via
la Turquie, afin de rejoindre le front al-Nosra ; il s'était
radicalisé après un séjour à La Mecque36.
Il s'était également rapproché de Forzane Alizza, un
groupuscule salafiste djihadiste dissous par les autorités
françaises en février 2012.
Le
22 décembre 2013, Nicolas, le frère de Jean-Daniel Pons (les deux
Français issus de la région toulousaine), trouve la mort dans une
attaque kamikaze près de Homs37.
Les deux demi-frères auraient rejoint, depuis leur départ en Syrie,
les rangs de l'EIIL38.
Leur mère, Dominique Pons, avait signalé aux autorités la
radicalisation de ses fils, puis créé en décembre 2013, avec son
ex-mari, l'association Syrien ne bouge… Agissons ! D'après
elle, Nicolas avait également retrouvé en Syrie un autre Toulousain
qu'il connaissait39.
En janvier 2014, les services de renseignement français évaluent à
500-600 le nombre de Français partis en Syrie, dont 220 encore sur
place, 70 qui sont revenus et 18 tués, soit un effectif qui a
quadruplé par rapport au mois de mai 2013. Sur ce total, 20%
seraient des Français convertis, mais la majorité reste des jeunes
gens d'origine maghrébine, pas forcément musulmans pratiquants,
mais qui se radicalisent très rapidement. Outre la facilité d'accès
au territoire syrien, les services de renseignement signalent qu'un
des grands facteurs de motivation des volontaires est qu'ils ont
l'impression de se battre pour une cause juste40.
10 à 14 jeunes gens originaires de Strasbourg auraient également
quitté leur ville pour l'Allemagne, afin de rejoindre la Syrie, à
la fin de l'année 201341.
Un jeune homme issu du quartier d'Elsau, à Strasbourg, serait
d'ailleurs mort dans une attaque kamikaze en Syrie au mois de
novembre42.
L'attention
en France sur le phénomène des volontaires candidats au djihad
syrien, qui avait cru un peu en 2013 avant de s'éclipser devant les
attaques chimiques du mois d'août 2013 et ses suites, rebondit avec
l'annonce du départ, en janvier 2014, de deux jeunes adolescents de
15 ans, originaires de la région toulousaine, très relayée dans
les médias. Tous les deux scolarisés au lycée des Arènes, les
deux adolescents sont partis le 6 janvier pour gagner la Turquie.
L'un des deux adolescents, Yasine, était réputé brillant élève,
un des meilleurs de sa classe. L'autre, Ayoub, le plus âgé, en
revanche, était connu des services de police, et appartenait à une
famille qui pouvait avoir des convictions religieuses rigoristes.
Yacine achète les billets d'avion pour la somme de 417 euros et les
deux jeunes gens embarquent sur un vol de la Turkish Airlinesà destination Istanbul. Ils arrivent ensuite à Antioche. Mais
difficile de dire, dans leur itinéraire, s'ils ont bénéficié de
l'assistance d'un réseau organisé ou non43.
Rattrapés et ramenés en France, les deux adolescents sont
finalement mis en examen44.
L'événement confirme à la fois l'accélération du recrutement en
France, mais aussi sa diversification. Si la majorité des recrues
continue à venir des grands centres urbains (Lille-Roubaix,
Strasbourg, Toulouse, Paris, le sud-est et Nice), les profils
semblent moins correspondre à des jeunes en pertes de repères ou
désocialisés, mais au contraire à des jeunes parfois plus
intégrés45.
Le père d'un deux adolescents a d'ailleurs rapidement prévenu les
autorités et lancé un appel public : selon lui, son fils a
notamment été radicalisé par le biais d'échanges sur le web,
notamment par Facebook46.
Dans le sud-est, à Nice et ses alentours, ce serait déjà une
quarantaine de jeunes gens qui seraient partis pour le djihad syrien,
avec de plus en plus d'adolescents -16, voire 15 ans47.
Dans le quartier populaire de Saint Roch, à l'est de Nice, il y
aurait eu 7 à 8 départs rien qu'entre septembre et décembre 201348.
Fin décembre, c'est une famille de dix personnes toute entière qui
part pour la Syrie49.
Au début du mois de décembre, la DCRI avait procédé à
l'interpellation d'un recruteur présumé du milieu niçois50.
En
février 2014, Salahudine, un djihadiste français de 27 ans
originaire de la région parisienne, parti combattre en juillet 2013,
livre un ultime témoignage après avoir été gravement blessé à
Alep. Il avait emmené femme et enfants avec lui, et manifestement
n'a pas bénéficié du concours d'un réseau : il a organisé
son voyage via la Turquie tout seul. Après avoir gagné Alep, il
rejoint l'EIIL, est formé dans un camp d'entraînement puis est
expédié rapidement sur le front. En novembre 2013, visiblement
dégoûté par l'EIIL, il rallie le front al-Nosra (qui ce même mois
est reconnu comme branche officielle d'al-Qaïda en Syrie, au
détriment de l'EIIL). Il combat à Alep, Damas et Homs. Il touche
chaque mois 50 dollars, mais s'est acheté lui-même son AK-47 pour 1
300 dollars51.
Un autre combattant français appartenant à l'EIIL, Abou Shaheed,
qui se trouve au nord d'Alep, a également livré son témoignage en
février 2014. C'est un volontaire déterminé, qui ne pense pas
revenir en France mais qui n'en est pas moins partisan d'un djihad
transnational52.
Néanmoins, selon les services de renseignement français, le profil
des volontaires se serait désormais resserré. Il comprendrait
désormais majoritairement des hommes de 20 à 35 ans, plus
déterminés. Un tiers des 250 Français encore présents en Syrie
seraient des Caucasiens, des Tchétchènes ayant transité par la
région de Nice (qui sert de hub pour les Caucasiens et en
particulier pour les Tchétchènes, avec Vienne, en Autriche). Sur le
reste, on compterait une moitié de convertis et une autre moitié de
jeunes issus de l'immigration maghrébine, ainsi que quelques femmes.
Fait notable, des groupes radicaux comme l'EIIL n'hésitent pas à
utiliser les volontaires étrangers, comme les Français, pour des
attaques kamikazes. On signale en outre plusieurs cas de départ où
les personnes s'installent à la frontière turque ou dans le nord de
la Syrie mais ne prennent pas part au combat, attendant
l'installation d'un califat islamique53.
Le 20 février, un jeune Niçois de 18 ans, parti en Syrie en
septembre 2013, est arrêté à son retour en France. Farid avait
combattu dans la région d'Alep. Jeune lycéen, il était parti avec
trois autres amis d'une cité de l'est ce Nice, après s'être
radicalisé en quelques semaines. Il a été emprisonné après son
arrestation, dans l'attente de son jugement54.
 |
| A droite, Abou Shaheed.-Source : http://www.memri.org/image/16983.JPG |
Les
djihadistes français sur les réseaux sociaux
Les
djihadistes français sont très présents sur les réseaux sociaux,
surtout Twitter et
Facebook55.
Ils donnent des informations sur leur parcours, sur les combats et
les conditions pratiques du djihad. Majoritairement, ceux qu'on y
voit font partie de l'EIIL. Les volontaires étrangers ont tendance,
en Syrie, à se regrouper, par affinité culturelle et linguistique,
mais il n'est pas dit que ce soit systématiquement le cas pour les
Français, même si certains combattent bien dans les mêmes
formations. Certains arrivent ensemble et se connaissent avant le
djihad. On note aussi la présence d'épouses de combattants. Les
réseaux sociaux servent au recrutement, à la diffusion de la
propagande, et pour maintenir le contact avec les familles. La
propagande joue sur l'analogie avec les jeux vidéos, dans les
illustrations qui peuvent être diffusées. Evidemment, les conflits
internes aux insurgés, comme celui qui oppose depuis avril 2013
l'EIIL au front al-Nosra, sont relativement peu présents. Abou
Shaheed, arrivé en Syrie en mai 2013, fait ainsi partie de l'EIIL,
et évoque souvent la poursuite du djihad après la chute du régime
Assad. Un autre djihadiste francophone, lui aussi membre de l'EIIL et
arrivé à la même date, qui opère sous le pseudo Si tu veux mon
avis, donne beaucoup de détails sur les combats et affirme avoir
participé à ceux de la base 80, à Alep. Abou Mohammed Muhajir, un
autre Français, est également incorporé dans l'EIIL : arrivé
à l'été 2013, il combat autour d'Azaz. Il est marié à Umtawwab
zawjetu abu’’mohamed, une femme originaire de Lorient, qui
collecte des fonds à des fins soi-disant humanitaires via Facebook,
et qui prétend avoir fait l'aller-retour en France entre
octobre-novembre 2013. Mourad Ibn Amar, lui aussi arrivé en Syrie à
l'été, fait également partie de l'EIIL. Il apparaît sur de
nombreuses photographies de groupes. Sous le pseudo Selim Det-R,
un Roubaisien est également inclus dans l'effectif de l'EIIL.
Abdullah Wade, un Français, s'efforce quant à lui de collecter des
fonds pour rénover des habitations en Syrie au profit des
djihadistes français. Abou Tasnim est probablement un Français
originaire d'Haïti. Il a rejoint la Syrie le 17 octobre 2013 et il
combat, lui, au sein du front al-Nosra. Blessé à l'entraînement,
il répond beaucoup sur les réseaux sociaux aux questions pratiques
pour le voyage jusqu'en Syrie, et livre son expérience de la guerre.
 |
| Abou Tasnim.-Source : http://www.memri.org/image/16984.JPG |
Conclusion
Il
est difficile de formuler des hypothèses quant à l'avenir du
recrutement français pour le djihad syrien, notamment parce que les
chiffres sont incertains, peut-être plus encore que pour d'autres
contingents, en particulier européens. La situation plus difficile
de l'insurrection face au régime, depuis l'accord sur les armes
chimiques de septembre 2013, et les affrontements entre rebelles,
notamment ceux dirigés contre l'EIIL, ne semblent pas avoir tari le
recrutement. Les Français, comme d'autres, se dirigent
majoritairement vers les groupes les plus radicaux, liés à
al-Qaïda, comme le front al-Nosra et surtout l'EIIL, qui bien que
marginalisé dans le dispositif d'al-Qaïda par les affrontements
récents, n'en demeure pas moins un acteur important sur le terrain.
On peut donc s'inquiéter à la fois de la difficulté à suivre des
départs souvent spontanés, délicats à anticiper, et du retour de
personnes aguerries sur les champs de bataille syriens et qui
souhaiteraient prolonger leur combat en France. Néanmoins, il faut
aussi noter qu'une partie des volontaires, comme dans d'autres pays,
était impliquée de longue date dans les réseaux djihadistes, et
qu'elle était surveillée préalablement, d'où, d'ailleurs,
certaines arrestations, à terme. Pour cette catégorie, il est
manifeste que les services de renseignement pourraient procéder, si
besoin, à des coups de filet de plus grande ampleur. Aller en Syrie
ne constitue pas un délit, et il faut accumuler des preuves pour
procéder aux interpellations. Ce qui est inquiétant, c'est la forte
proportion de personnes parfois seules qui s'autoradicalisent par
différents moyens, notamment le web, et qui partent de manière
parfois imprévisible en direction de la Syrie -un voyage qui, comme
on l'a dit, par son caractère aisé, notamment via la Turquie, est
une aubaine pour le djihad. Le défi majeur, c'est que l'évolution
de la nature même du terrorisme islamiste fait que le retour d'une
dizaine de combattants fanatisés seulement pourrait avoir un impact
démesuré, par la création de réseaux, ou même par une action en
solitaire, comme celle de Mohamed Merah. C'est tout l'enjeu, pour les
services de renseignement, d'arriver à dissoudre au mieux ce
phénomène, tâche des plus ardues. Le phénomène des volontaires
français est donc plus complexe qu'il n'y paraît, et il faudra bien
évidemment continuer d'en analyser les évolutions.
Tableau
récapitulatif des estimations officielles fournies par le ministre
de l'Intérieur français, Manuel Valls, à propos des Français
partis se battre en Syrie (mai 2013-janvier 2014).
Nombre de
volontaires partis depuis 2011 | Encore sur
place | Revenus | Tués | En transit | Candidats au
départ | |
Mai 2013 | 120 | 50 | 30 | 40 | ||
Septembre 2013 | 130 | 50 | 10 | 40 | 100 | |
Octobre 2013 | 184 | 80 | 14 | |||
Décembre 2013 | +400 | 184 | 80 | 14 | 100 | |
Janvier 2014 | 700 | 250 | 76 | 26 | 150 |
1Thomas
Hegghammer, « Number of foreign fighters from Europe in Syria
is historically unprecedented. Who should be worried? »,
The Monkey Cage, 27 novembre 2013.
2Aaron
Y. Zelin, Sami David, « Up to 11,000 foreign fighters in
Syria; steep rise among Western Europeans », The
International Centre for the Study of Radicalisation, 17
décembre 2013.
3Foreign
fighters from Western countries in the ranks of the rebel
organizations affiliated with Al-Qaeda and the global jihad in
Syria, The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center,
3 février 2014.
17Foreign
fighters from Western countries in the ranks of the rebel
organizations affiliated with Al-Qaeda and the global jihad in
Syria, The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center,
3 février 2014.
24Foreign
fighters from Western countries in the ranks of the rebel
organizations affiliated with Al-Qaeda and the global jihad in
Syria, The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center,
3 février 2014.
27Foreign
fighters from Western countries in the ranks of the rebel
organizations affiliated with Al-Qaeda and the global jihad in
Syria, The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center,
3 février 2014.
33Foreign
fighters from Western countries in the ranks of the rebel
organizations affiliated with Al-Qaeda and the global jihad in
Syria, The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center,
3 février 2014.
↧

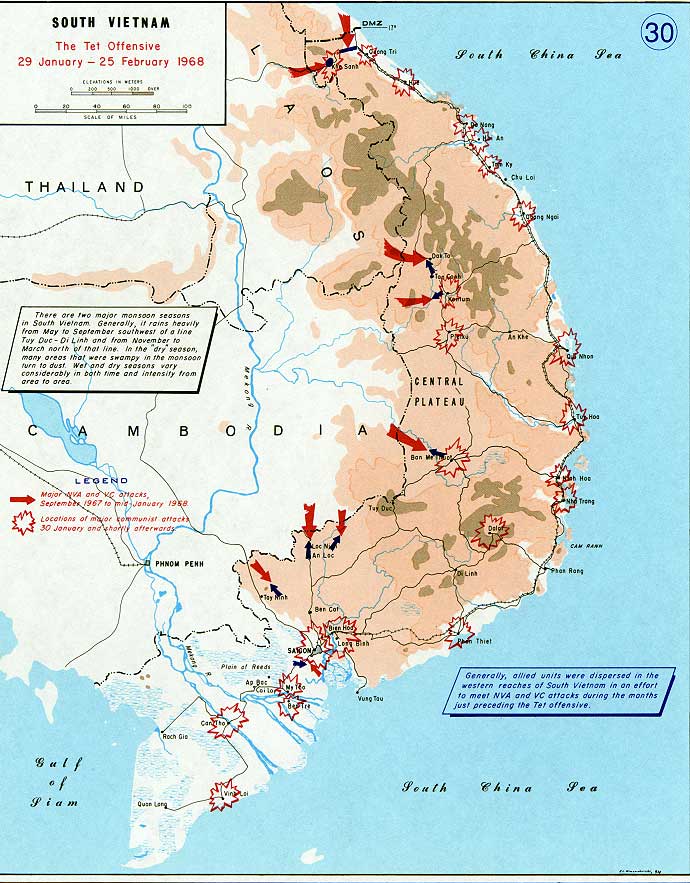






.bmp)
















