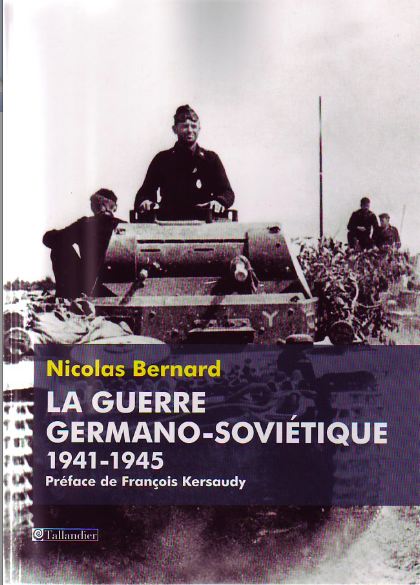Il y a des livres dont on sent, à leur lecture, que l'auteur apporte vraiment quelque chose à un endroit où il y en avait besoin. C'est un peu ce que j'ai ressenti en refermant cette somme de Nicolas Bernard, qui intervient régulièrement ici même dans les commentaires, consacrée au front de l'est. L'auteur, avocat, est bien connu pour être intervenu dans plusieurs magazines spécialisés à propos de la Seconde Guerre mondiale.
On ne peut qu'aquiescer avec la plupart des remarques de la préface de François Kersaudy : richesse de la documentation (en partie russe, ce qui est un avantage sur d'autres livres), ampleur du champ d'investigation en particulier. On n'est pas forcé, de la même manière, de dire qu'il manque "une description du modus operandi des deux stratèges amateurs" ou de souscrire à l'idée d'une "terreur abjecte" au sein du haut commandement militaire soviétique.
Comme le rappelle Nicolas Bernard dans sa propre introduction, le front de l'est se rapproche sans doute le plus de cette "guerre totale" qui a commencé à être pensée par les théoriciens de la guerre dès le XIXème siècle. Guerre gigantesque, par les forces en présence et par le théâtre d'opérations, mais comme le souligne l'auteur, guerre méconnue, en France. La mémoire française du conflit peine à sortir du cadre national et les procès mémoriels n'ont pas mis en évidence, particulièrement, le front de l'est. Les sources archivistiques, côté soviétique, sont difficiles d'accès ; en outre de nombreux faux circulent aussi dans les sources secondaires. Pendant longtemps, l'historiographie de la guerre froide, dictée par les anciens vaincus allemands, a dominé la production. La chute de l'URSS accentue le reflux de ce courant tandis que la guerre elle-même est replacée comme phénomène de violence dans son contexte social, politique et culturel. Côté allemand, plusieurs historiens ont révisé le comportement des soldats, la recherche est moins avancée côté soviétique. Il faut dire que les enjeux mémoriels sont encore sensibles dans les anciennes républiques soviétiques, où le rôle des collaborateurs peine à être reconnu, sans parler de l'assimilation à bon compte des totalitarismes nazi et soviétique. C'est pourquoi peu de synthèses sur le conflit ont été publiées depuis 1945, et en particulier en dehors de l'histoire militaire pure. Cet ouvrage est donc probablement, comme le dit l'auteur, la première étude française à embrasser le conflit dans sa totalité, en s'intéressant à de nombreux aspects méconnus, y compris sur le plan militaire, mais aussi, par exemple, en ce qui concerne la sortie de guerre.
Sur les origines du conflit, Nicolas Bernard met bien en évidence l'inanité de la théorie de "l'attaque préventive" soutenue par les Allemands et remise au goût du jour depuis une vingtaine d'années par Souvorov. Il montre par exemple que la coopération germano-soviétique à partir de Rapallo s'affaiblit dès 1926, donc assez tôt. Hitler, par contre, a synthétisé plusieurs éléments dans son progamme d'expansion à l'est, du Lebensraum mâtiné de fantasmes raciaux. Staline est l'homme du socialisme dans un seul pays, alors qu'Hitler, lui, ambitionne de conquérir l'Eurasie pour y appliquer sa politique.
Le pacte germano-soviétique sert les intérêts des deux dictateurs : l'URSS a besoin de temps pour se fortifier, alors qu'Hitler veut avoir les mains libres à l'ouest. Mais les relations entre les deux alliés de circonstance dépendent aussi du sort des armes sur ce théâtre d'opérations... Staline se constitue un glacis protecteur, mais la piètre performance de son armée, notamment en Finlande, encourage les Allemands dans leur conception méprisante de l'adversaire soviétique à venir. La coopération en 1939-1940 n'a été qu'une ébauche, jamais poussée à son terme. La chute de la France alarme Staline, qui s'empresse d'occuper les Etats baltes puis la Bessarabie. L'échec face à la Grande-Bretagne, dès l'été 1940, pousse Hitler à se retourner vers l'est. Les Allemands endorment la méfiance des Soviétiques, dont les espions sont bien en peine de convaincre Staline des préparatifs hitlériens, puis mettent au pas les Balkans.
Le 22 juin 1941, l'armée allemande se jette sur l'URSS, largement prise au dépourvu. Le haut-commandement est alors totalement inféodé au Führer, qui a organisé le plan de conquête sur des bases économiques. La Wehrmacht met alors en oeuvre ce que l'on appellera ensuite la Blitzkrieg : une guerre de mouvement, des technologies nouvelles au service des enseignements tirés de la Grande Guerre s'appuyant sur le professionnalisme, conçue pour détruire l'ennemi tout en conquérant des territoires. Mais l'état-major allemand a négligé la préparation de la campagne, notamment sur le plan logistique, et les objectifs restent ambigus. L'armée s'est certes renforcée depuis juin 1940, mais la production militaire reste insuffisante et la Wehrmacht n'est pas motorisée. Il faut dire que l'économie allemande manque de ressources naturelles pour tourner davantage. Plus grave, le renseignement allemand a totalement mésestimé les capacités de l'URSS, aussi bien sur le plan militaire qu'économique. Les alliés de l'Allemagne sont nécessaires mais encombrants pour le Führer, qui doit gérer les susceptibilités des Etats balkaniques, par ailleurs mal équipés. En face, l'Armée Rouge, à la pointe de réflexion doctrinale jusqu'aux purges de 1937, a sacrifié la qualité et à la quantité. Le personnel est mal formé, le matériel pose problème, l'arsenal, gigantesque, est coûteux. Les réformes entreprises en 1940 ne peuvent être menées à bien, la croissance énorme de l'Armée Rouge rajoutant un gros problème supplémentaire. L'aviation souffre, la doctrine, offensive, autour de l'art opératif, de l'opération et de la bataille en profondeur, conduit à négliger la défensive et les lignes fortifiées. Par contre, l'économie soviétique est militarisée dès les plans quinquennaux, même si ses performances sont inégales et si elle laisse sur le carreau les besoins en termes de consommation.
Le choc initial est terrible. L'armée allemande progresse rapidement, détruit beaucoup, mais se heurte aussi, parfois, à forte partie, comme à la forteresse de Brest-Litovsk, dès les premiers jours de l'invasion. Staline ne s'adresse à la population que le 3 juillet, pour galvaniser les énergies. La Stavka, au départ dépassée, ne réussit qu'à choisir une stratégie d'attrition terriblement coûteuse : pour user le fer de lance allemand, elle exécute contre-attaque sur contre-attaque sur toute la ligne de front. La Wehrmacht s'use cependant, et les premiers signes d'essoufflement apparaissent dès la bataille de Smolensk, en juillet-août 1941. Constatant le durcissement des relations avec les Etats-Unis et espérant une offre de paix de Staline, Hitler néglige Moscou et réoriente l'effort au nord et au sud. Mais les Panzer viennent mourir devant Léningrad, qu'il faut assiéger ; en Ukraine, les Soviétiques subissent une défaite complète, mais à la fin septembre, les Allemands ont déjà plus de 500 000 hommes hors de combat, et la Luftwaffe a particulièrement souffert. Le moral des Landsern souffre aussi, car le soldat soviétique montre une sourde détermination.
Au sud, les Allemands sont bientôt contraints de reculer à Rostov et Manstein, en Crimée, ne peut faire tomber immédiatement Sébastopol. L'offensive allemande sur Moscou, début octobre, frappe une Armée Rouge affaiblie par ses nombreuses contre-attaques. Un vent de panique souffle sur la capitale les 16-17 octobre, avant d'être résorbé. La résistance soviétique et l'impréparation logistique de la campagne, mise en exergue par la dégradation de la météo, ont finalement raison de l'effort allemand. Moscou n'a pas été sauvée par les divisions sibériennes : bien au contraire, la menace japonaise conduit à renforcer les troupes d'Extrême-Orient. En réalité, les transferts d'unité de ce front ont bien eu lieu, mais dès le mois de juin 1941. Les généraux soviétiques mènent la contre-offensive en s'essayant timidement à l'art opératif, tandis que l'Allemagne entre en guerre avec les Etats-Unis. Staline, pris de la folie des grandeurs, jette son armée mal préparée contre le Groupe d'Armées Centre, qui tient bon. Cependant, une grave crise du moral se fait jour, conduisant à un renforcement des sanctions disciplinaires. Un tiers des forces allemandes engagées a déjà été éliminé, depuis le début de Barbarossa. Les Soviétiques ont encore plus souffert mais ils peuvent se permettre un tel niveau de pertes, ce qui n'est pas le cas des Allemands. Léningrad, assiégée, souffre de la faim et des pénuries, malgré les efforts de l'Armée Rouge, et devient le symbole de la résistance à l'envahisseur.
C'est que la guerre menée par l'Allemagne est aussi une guerre d'extermination. Au remodelage racial et territorial s'ajoute la concurrence des entités chère à l'Etat nazi. Pas question de s'entendre avec les sous-hommes slaves. Il faut briser l'industrie, les villes, et les Allemands ne se gênent pas pour organiser une famine probablement voulue. En outre, l'invasion de l'URSS va permettre de s'atteler à la "solution" au problème juif. Les Einsatzgruppen appliquent ce qui ressemble fort à un génocide progressif et programmé, dès le départ. Les chiffres s'envolent dès juillet 1941 et l'ampleur des tueries, qui brisent les nerfs de beaucoup d'exécutants, force à passer à des méthodes industrielles. C'est qu'Hitler commence probablement à voir qu'il peut perdre la guerre : en conséquence, les Juifs ne doivent pas survivre à une défaite allemande. La Wehrmacht n'a pas bronché devant les massacres, et ce dès 1939, malgré quelques cas isolés ; quand elle ne s'est pas faite complice elle-même des tueries. Les commissaires politiques, en vertu du fameux ordre correspondant, sont exterminés sans autre forme de procès. 60% des prisonniers soviétiques meurent dans les camps allemands ou en captivité : pas moins de 2 millions dans la première année de guerre. Les Allemands maintiennent l'ordre sur leurs arrières par la terreur. L'armée est largement pénétrée des préceptes nazis, via la propagande, la contrainte et tout simplement l'adhésion. La compassion a plutôt été l'exception que la règle, comme le souligne l'auteur, y compris parmi les alliés, notamment les Roumains, qui massacrent un grand nombre de Juifs.
Début 1942, le temps joue contre Hitler : il choisit de s'emparer du pétrole du Caucase, pour des raisons purement économiques, mais aussi afin d'acculer l'Angleterre et l'URSS à la paix. A nouveau, les objectifs sont trop ambitieux, notamment sur le plan logistique, pour une Wehrmacht épuisée. L'Armée Rouge commence elle à se réorganiser mais manque encore de formation et d'expérience. En témoigne la contre-offensive devant Kharkov, qui montre à nouveau de graves lacunes, et la chute de la Crimée. L'offensive d'été allemande est désordonnée dans ses objectifs. Pour Nicolas Bernard, la grande erreur d'Hitler reste la directive n°45 qui divise l'effort allemand en deux, sur Stalingrad et le Caucase. La situation s'enlise vite sur le second théâtre d'opérations.
Stalingrad, fleuron du plan quinquennal soviétique, pourtant mal défendue, va devenir le tombeau de l'armée allemande. La 6. Armee manque d'emporter la ville en août dans la première poussée. La bataille se transforme en sanglants combats de rues. Les Soviétiques improvisent, notamment à partir de l'expérience espagnole ; ils le font bien, mais cela leur coûte cher, aussi. Les Allemands s'adaptent, mais leur moral est en berne. La Stavka, elle, planifie de nouveau une gigantesque contre-offensive, tandis que les deux camps se battent pour les usines du nord de la ville en octobre-novembre. Paulus n'arrive pas à déloger Tchouïkov de la petite parcelle qu'il contrôle encore. Si l'opération Mars est un fiasco sanglant, tel n'est pas le cas de l'opération Uranus, qui encercle en trois jours la 6. Armee dans Stalingrad. Hitler refuse l'évacuation et condamne à la mort Paulus et ses hommes, tout en rapatriant les troupes du Caucase. Les pertes humaines et matérielles de l'Axe sont colossales et aucun objectif de la campagne n'a été atteint. Pour Nicolas Bernard, la bataille est donc bien le tournant de la guerre à l'est.
L'industrie, la société soviétiques ont tenu. Non sans mal. Il faut en urgence déménager les usines en 1941 et la production de guerre s'effondre, les ressources manquent aussi. Mais tout est désormais consacré à l'effort de guerre. L'URSS devient un gigantesque arsenal, que l'Allemagne ne rattrape qu'à peine en 1944 seulement, bien trop tard. Cette production doit beaucoup à l'initiative locale, non à l'Etat centralisé. Les Soviétiques savent aussi se servir du matériel capturé. Toute la population est mobilisée, des adolescents et des femmes aux détenus du Goulag. La production agricole est un maillon faible mais Staline lâche du lest pour faire augmenter les rendements. Au front, les soldats soviétiques sont brutalisés, leurs conditions de vie sont dantesques, d'où un ratio morts/blessés très élevé. La société soviétique, à l'arrière, est victime de l'effort de guerre : famine et pénuries s'installent, et la société elle-même est fracturée.
Le régime a cependant bénéficié du soutien de la jeunesse laborieuse et de l'intelligentsia. L'Etat, par sa mobilisation et son encadrement, maintient la cohésion sociale et nationale. Il fait des concessions. La désertion s'effiloche d'ailleurs dans l'Armée rouge au fil des années. La répression ne fait que prolonger, par exemple, les pratiques des grandes purges. Les minorités, vues comme des traîtres en puissance, font les frais de la guerre. Ce n'est pas cependant une logique génocidaire qui y préside, mais bien sécuritaire. L'ennemi allemand est déshumanisé par la propagande. Les atrocités allemandes nourrissent la haine de l'envahisseur et les soldats soviétiques ne traitent pas toujours très bien les prisonniers, sans volonté, là encore, d'extermination systématique... Staline joue sur la corde patriotique et nationaliste, pour conforter son emprise mais aussi rassurer les Alliés occidentaux. Les minorités sont valorisées mais font l'objet d'un traitement discriminatoire dans l'armée. Les récompenses sont nombreuses pour les soldats, et une certaine liberté est tolérée au front, le tout laissant penser à une amorce d'assouplissement après la guerre.
L'URSS n'est pas seule. Elle a le soutien de ses alliés anglo-saxons. Churchill et Roosevelt s'engagent rapidement en faveur de l'URSS, mais le contentieux du second front pèse sur les relations. Un effort de propagande est mené pour rendre les Soviétiques plus "sympathiques" aux yeux des opinions occidentales. L'aide du Prêt-Bail passe par l'Extrême-Nord, par l'Iran et surtout par le Pacifique. Quel a été son impact ? La question est sensible, rendue épineuse par la guerre froide. Les Soviétiques l'ont minorée dès le conflit. L'aide alliée a, en fait, renforcer la structure de l'économie de guerre soviétique, en particulier sur le plan logistique. Elle a contribué à motoriser l'Armée Rouge et a permis aux usines d'URSS de se concentrer sur la production militaire. L'aide s'intensifie surtout en 1943-1944, mais l'effort de renseignement et celui dans le domaine aérien ont aussi pesé.
Après Stalingrad, il devient évident qu'Hitler ne peut plus remporter la guerre à l'est. Les Allemands écrasent les oppositions intérieures qui se font jour suite à la défaite, et jouent de l'épouvantail anticommuniste pour effrayer les Occidentaux -c'est aussi le sens du discours sur la "guerre totale" de Goebbels. La découverte du charnier de Katyn enfonce un coin entre les Soviétiques et les Occidentaux, qui acquiescent au mensonge de Staline malgré la colère des Polonais. Manstein rétablit la situation au printemps 1943 mais la bataille n'est que défensive : l'Axe est ramené à sa ligne de départ de 1942... l'Armée Rouge ouvre un corridor vers Léningrad, mais ne parvient pas à dégager complètement la ville. Hitler et Staline ont des attitudes similaires dans leur conduite de la guerre. Côté allemand, les ressources humaines s'épuisent, alors que la Waffen-SS monte en puissance. L'Armée Rouge, elle, se reconstitue et enfle même grâce à ses réserves. La bataille est de plus en plus une bataille de matériel : les Soviétiques misent beaucoup sur leur artillerie, le "dieu de la guerre" et la défense devient de plus en plus raffinée dans chaque camp. La guerre statique colle cependant mal au front de l'est, dont la géographie favorise la guerre de mouvement. En 1943, les Allemands mettent aussi l'effort sur les blindés, avec une course au gigantisme qui nuit aux quantités produites. L'arme blindée soviétique poursuit sa réorganisation : malgré des faiblesses persistantes, ses performances s'améliorent. L'aviation soviétique poursuit sa croissance et commence à faire jeu égal avec la Luftwaffe. Pour aseptiser la guerre totale, les Allemands en font une épopée, un jeu, voire une chasse, avec la création des as de l'aviation et des chars, les décorations pour l'infanterie, etc. La guerre devient un métier et prend une ampleur cataclysmique à partir de 1943.
Hitler reprend au printemps 1943 une idée de Manstein et organise l'attaque contre le saillant de Koursk, qui répond surtout à des motifs politiques par rapport aux alliés, à la propagande, et à l'image renvoyée aux ennemis occidentaux. Mais les Soviétiques sont prêts à le recevoir. Malgré de succès tactiques éphémères, l'armée allemande ne peut venir à bout des réserves de l'Armée Rouge et elle sort usée de la bataille. Les Soviétiques ont tenu : ils ont été capables de repousser une offensive allemande en été, l'aviation s'est améliorée : Koursk est un autre tournant. D'autant que les Soviétiques lancent des contre-offensives planifiées dès avant l'attaque allemande. Le mur de l'est n'est qu'un mirage de plus dans la tête du Führer. L'Armée Rouge prend pied sur le Dniepr en septembre-octobre, avant d'en sortir pour aller reconquérir Kiev en novembre. 1943 aura vu les Soviétiques progresser sur les plans stratégique, opérationnel et tactique. Les pertes ont été lourdes mais la saignée est également sensible côté allemand, avec 700 000 morts.
Staline commence à préciser ses vues pour l'après-guerre à la conférence de Téhéran. Hitler joue donc à fond la carte de l'anticommunisme pour briser la coalition alliée et cherche à défaire le débarquement à venir à l'ouest : sans succès dans les deux cas. Les nazis déportent les Slaves en Allemagne pour en faire des travailleurs forcés dans le cadre de l'économie de guerre. En revanche la Wehrmacht ne peut armer des éléments anticommunistes : seuls les Hiwis et des bataillons d'Osttruppen, d'ailleurs surtout engagés en dehors du front de l'est, combattront du côté allemand. L'armée Vlassov n'est que symbolique. A contrario, les partisans se développent sur les arrières allemands et sont de plus en plus encadrés par Moscou à partir de 1942. Ils s'attaquent d'abord aux collaborateurs et révèlent les fractures au sein de la société soviétique, mais leur rôle combattant devient aussi de plus en plus néfaste pour l'occupant. La répression allemande s'accroît en proportion.
La Stavka continue à progresser en Ukraine, au-delà du Dniepr. Les Allemands évitent un nouveau Stalingrad dans la poche de Korsun, mais le résultat n'est guère brillant. Il faut occuper la Hongrie qui menace de faire défection en mars 1944. L'Armée Rouge fonce vers la Roumanie, encercle la 1. Panzerarmee qui arrive cependant à se dégager. La Crimée est libérée, Léningrad dégagée. Parallèlement, Hitler, qui veut défendre les conquêtes pour des raisons économiques et territoriales, se passe de Manstein. Mais l'Armée Rouge planifie et exécute à l'été, en juin, l'une des opérations les plus importantes de la guerre, Bagration. Trompant les Allemands sur leurs intentions, rassemblant un dispositif colossal, l'Armée Rouge pulvérise le Groupe d'Armées Centre, dans sa ligne de mire depuis deux ans. Une brèche de 400 km s'ouvre en direction des pays baltes et de la Pologne. La Wehrmacht se retire en faisant le vide derrière elle, détruisant tout, déportant les populations. L'Armée Rouge découvre l'ampleur des exactions allemandes et libère le premier camp d'extermination, à Maïdanek, en juillet 1944.
Staline bâtit alors la stratégie militaire de plus en plus en fonction de la diplomatie et de la politique : il s'agit d'organiser le plus grand glacis protecteur possible devant l'URSS. La Finlande, attaquée en juin 1944, est sévèrement battue mais sa résistance sauve son indépendance. L'armistice est signé en septembre. En octobre, les Soviétiques ont repris les pays baltes et enfermé les restes du Groupe d'Armées Nord dans la poche de Courlande, au nord de la Lettonie. Staline laisse les insurgés polonais à leur propre sort face à la répression allemande, entamant ainsi son crédit à l'ouest. Le problème se pose d'ailleurs de la même façon pour l'insurrection slovaque, éclipsée par celle de Varsovie. En août, les Soviétiques ont lancé une offensive foudroyante en Roumanie, qui passe dans le camp communiste ; la 6. Armee allemande est une nouvelle fois détruite. Les Bulgares se rallient bientôt à l'URSS, tandis que l'Armée Rouge doit coopérer avec les partisans de Tito pour libérer Belgrade et couper la retraite aux troupes de l'Axe qui évacuent les Balkans. La Hongrie, qui menaçait de faire défection à son tour, doit être occupée en octobre et confiée aux fascistes de Croix Fléchées. Les Soviétiques arrivent devant Budapest en novembre. La ville, encerclée en décembre, résiste jusqu'en février 1945, aidé par des contre-attaques allemandes de l'extérieur qui ne débouchent pas. La Wehrmacht lance sa dernière grande contre-offensive en Hongrie en mars, mais rien n'y fait : l'Armée Rouge entre à Vienne début avril.
De son côté, Hitler, après l'attentat du 20 juillet, radicalise à nouveau le conflit. On fusille ou on pend les traîtres ; la levée en masse (Volkssturm) est décrétée ; la propagande s'en donne à coeur joie. L'armée allemande est cependant épuisée, mais conserve sa cohésion en raison de motifs idéologiques ou du conformisme propre aux groupes primaires. L'Armée Rouge, elle, est au plus haut. Il y a une pénurie d'effectifs mais le matériel est pléthorique et de meilleure qualité, tandis que la logistique s'est améliorée, ce qui explique la maîtrise de plus en plus affinée de l'art opératif. L'opération Vistule-Oder mène l'Armée Rouge à 60 km de Berlin en trois semaines. La Prusse Orientale, en revanche, se révèle être une noix plus dure à casser. Il faut nettoyer les flancs, Poméranie et Silésie, ce qui empêche entre autres de foncer tout de suite sur la capitale du Reich.
L'année 1945, côté soviétique, laisse un sanglant sillage derrière l'Armée Rouge. Vols, destructions, meurtres et viols s'accumulent. En réalité, le phénomène reste mal étudié par l'historiographie, car difficile à aborder par les sources primaires, et a été victime d'exagérations ou d'instrumentalisations politiques. La haine des Soviétiques est renforcée par la propagande et par les exactions allemandes, c'est un fait. Les exactions sont massives. Mais il est en fait impossible de les quantifier précisément : même Ehrenbourg, souvent chargé de responsabilité dans ce sordide aspect du conflit, n'encourageait pas à agresser les civils. La question a posé problème au commandement soviétique, qui sévit dès la fin janvier 1945 : Koniev fait ainsi fusiller 40 hommes en Silésie. Staline modère fortement le ton de la propagande, espérant toujours voir une révolution secouée l'Allemagne. Les Allemands, eux, sont terrorisés par la peur du Russe, de longue date. Goebbels s'en donne à coeur joie sur le massacre de Nemmersdorf : le nombre de victimes est multipliée, on rajoute des détails et des photographies sordides mais inexistants en réalité, etc. L'effet Nemmersdorf, comme le rappelle Nicolas Bernard, est cependant à relativiser, car le message est usé jusqu'à la corde et les Allemands savent ce qui s'est passé en URSS occupée. Mais les civils fuient en masse l'Allemagne orientale, dans des conditions dantesques. Certains choisissent aussi le suicide. La population n'a plus confiance dans ses dirigeants mais l'Etat ne s'effondre pas et la répression fait son oeuvre.
Après Yalta, les Américains commencent enfin à comprendre les intentions de Staline, au grand soulagement de Churchill. Berlin est cependant laissée aux Soviétiques, qui jettent toutes leurs forces dans l'ultime offensive du 16 avril 1945. La bataille est titanesque, à la mesure de l'enjeu. Mais l'Armée Rouge prend le dessus rapidement et Berlin capitule le 2 mai. Le 30 avril, Hitler s'est suicidé dans le bunker sous la chancellerie. Les pertes soviétiques sont lourdes et Berlin est en grande partie ravagée par les derniers combats. Dönitz, qui a succédé au Führer, capitale à son tour moins d'une semaine plus tard. La situation est cependant confuse en Tchécoslovaquie, où une rébellion éclate contre les Allemands, soutenue par les partisans de Vlassov repliés là (!).
La guerre n'est pourtant pas encore finie pour Staline. Le 9 août, jour où la deuxième bombe atomique tombe sur Nagasaki, l'Armée Rouge attaque en Mandchourie contre le Japon. Une offensive fulgurante qui permet d'empocher des conquêtes supplémentaires. L'URSS apparaît comme un des grands vainqueurs de la guerre : par sa contribution, par son aura morale (qui fait oublier les crimes staliniens) et par ses sacrifices -sans doute plus près de 30 que de 25 millions de morts. Les dégâts matériels sont immenses. C'est pourquoi Staline pille les pays conquis et emploie les prisonniers de guerre allemands ou japonais à la tâche. L'Europe de l'est est également sinistrée, et les redécoupages territoriaux entraînent l'exode de nombreux réfugiés, allemands en particulier. La Prusse Orientale devient territoire soviétique. A l'intérieur, les soldats peinent à se réinsérer dans un pays ravagé et la répression stalinienne revient au galop, étouffant la liberté timidement accordée pendant le conflit. Le Goulag se remplit de nouveau et connaît un pic en 1950. L'Armée Rouge est mise au pas, l'écriture du conflit est encadrée. L'Allemagne est bientôt coupée en deux par la guerre froide.
La guerre ne disparaît pourtant pas dans les mémoires, marquées à la fois par le mythe et l'oubli. Pour l'URSS, la Grande Guerre Patriotique devient le moment rassembleur, unitaire. La mort de Staline n'entraîne pas la fin du mythe, qui se cristallise sous Brejnev. La fin du communisme réactive les guerres de mémoires. La Russie de Poutine a finalement renoué avec le mythe de la Grande Guerre Patriotique, sérieusement mis à mal sous l'ère Eltsine. Le cinéma y contribue largement. En face, deux mémoires se développent, en RFA et en RDA. La première privilégie la souffrance à la culpabilité, la seconde rejoint le discours officiel soviétique. La RFA relit la guerre à la lumière de la guerre froide, les généraux allemands, en partie récupérés par les Américains, propagent le mythe de la guerre propre et chevaleresque. La construction commence à se lézarder dans les années 1970 et s'effondre pendant la décennie suivante. La querelle des historiens allemands et le débat sur le totalitarisme sont prolongés après la chute du communiste et la réunification. Le mythe construit par les généraux allemands est balayée, la participation de l'armée aux crimes nazis mise en évidence.
Guerre totale que celle du front de l'est ; guerre nationale aussi. Mais les deux adversaires sont-ils si interchangeables qu'une certaine historiographie tend à le dire ? Pour Nicolas Bernard, la réponse est non. Les nazis n'ont pas tué davantage car ils ont perdu. La guerre d'Hitler à l'est se trouve être, elle, une guerre absolue, telle qu'elle avait été appréhendée par Clausewitz, le processus ayant été soutenu par l'armée. En ce sens elle se différencie nettement d'une URSS attaquée qui se jette à corps perdu dans la bataille, sans regarder à la dépense en pertes humaines.
Terminons sur un résumé de ce qu'apporte le livre de Nicolas Bernard. Le gros point fort de l'ouvrage, sans aucun doute, c'est d'embrasser la guerre à l'est dans sa totalité, même si l'auteur dément faire de "l'histoire totale" en introduction. Le conflit, il est vrai, est difficile à circonscrire complètement dans un seul livre. Et pourtant, le travail de Nicolas Bernard a ce mérite immense de contextualister le front de l'est, de le replacer dans son environnement social, économique, et même culturel, sans parler de l'historiographie. Sur ce plan-là, c'est sans doute une somme qu'il sera difficile de dépasser dans les prochaines années. Le tout adossé à une bibliographie complète, sans doute pas exhaustive, mais comprenant des références en de nombreuses langues, aussi bien allemandes que russes, par exemple. Bibliographie dont je fais modestement partie avec mes pauvres articles de magazines spécialisés (!). Notons d'ailleurs qu'elle est classée, pour les ouvrages secondaires, par thèmes, ce qui est appréciable. Ce qu'il perd peut-être en description opérationnelle de l'histoire militaire (encore que l'auteur ne déséquilibre pas le propos en faveur des grands épisodes, traitant de ceux généralement survolés comme les offensives soviétiques de l'hiver 1943-printemps 1944, ou du rôle des partisans, etc), favorisée dans d'autres ouvrages sur le front de l'est (on pense en particulier aux livres de Jean Lopez), le livre le gagne en profondeur d'analyse sur ce qui fait l'essence même de la guerre à l'est : ses causes, ses manifestations, mais aussi ses conséquences et ses traces. La méthode de l'historien combinée à la rigueur du discours font certainement de La guerre germano-soviétique un ouvrage indispensable sur le sujet, en français : un outil de travail. Le pari fixé dans l'introduction est donc plutôt réussi.