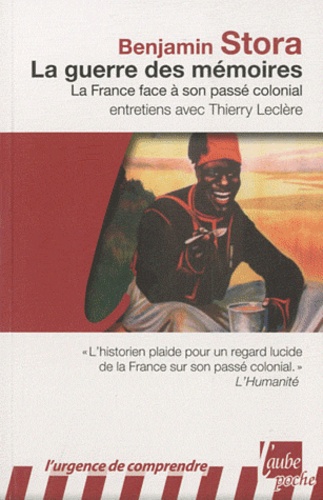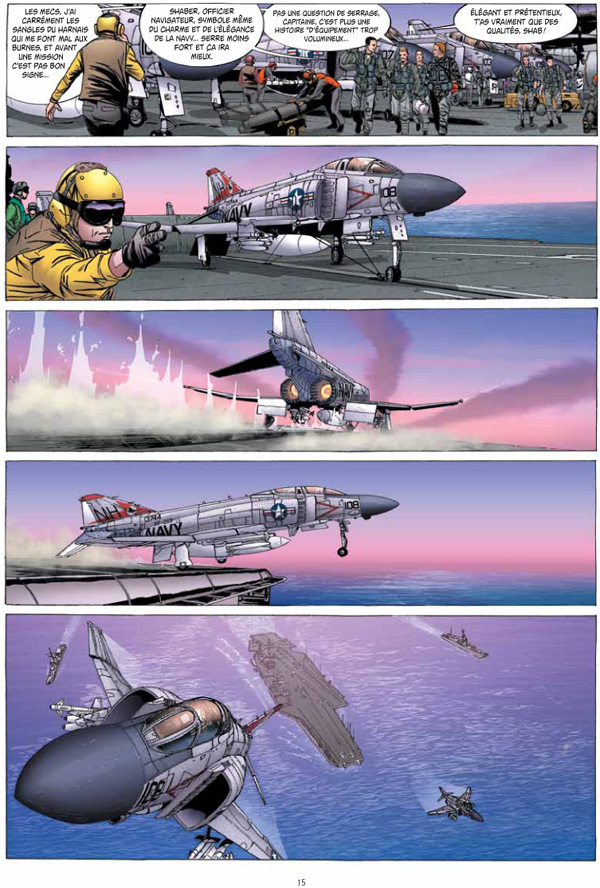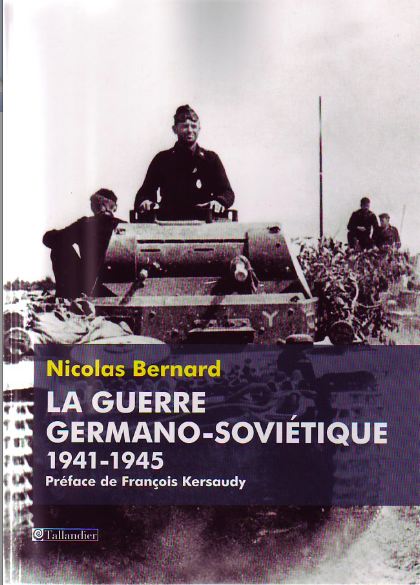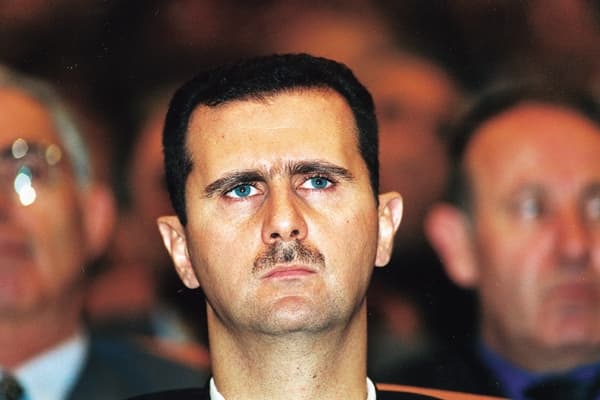![]()
L'armée
syrienne. En 2012, plus d'un an après le début de l'insurrection,
tout le monde prédisait son effondrement imminent.
Force est de constater qu'un an après, elle est toujours là, et
loin d'être vaincue. Dès sa création, l'armée syrienne a joué un
rôle important dans la vie politique du pays, multipliant les coups
d'Etat, révélant les tensions confessionnelles. Après la prise du
pouvoir par Hafez el-Assad en 1970, avec l'armée pour une fois unie
autour d'un seul nom, on a pu croire que l'armée était réorientée
vers la guerre conventionnelle contre Israël, délaissant les tâches
de sécurité intérieure. Les trois décennies du règne d'Hafez
el-Assad montrent qu'il n'en a rien été. L'armée est à la botte
du clan au pouvoir, un tiers de son effectif est composé d'unités
formant une véritable garde prétorienne. Hafez a soigneusement
préparé la succession de son fils Bachar, qui lui succède avec le
soutien de l'armée sans opposition ou presque en 2000. Le
déclenchement de la guerre civile montre à nouveau les liens
étroits qui unissent le pouvoir à ses forces armées. Si la
stratégie de contre-insurrection imitée de celle de Hafez contre
les Frères Musulmans semble avoir échoué, Bachar el-Assad a
modifié sa stratégie, et l'armée est encore en mesure de soutenir
une longue guerre civile, de plus en plus sectaire. Retour sur
l'instrument de cette politique à travers ce panorama.
L'armée
au coeur de la politique syrienne (1945-1970)
Une
« légion syrienne » est déjà formée pendant la
Première Guerre mondiale. L'ancêtre de l'armée syrienne actuelle a
été fondée par la France après le conflit, quand celle-ci a reçu
le mandat sur le nord du Levant, organisé ensuite entre le Liban et
la Syrie.
La domination française en Syrie a été assez impopulaire et a
engendré de fréquentes révoltes. En 1923 sont créées les Troupes
Spéciales du Levant, soit 8 000 hommes, le noyau des futurs armées
libanaise et syrienne.
Ces unités sont utilisées comme auxiliaires des troupes régulières.
Les officiers sont français, bien que les Syriens puissent recevoir
les grades inférieurs à celui de commandant. Les Troupes Spéciales
sont chargées des tâches de sécurité intérieure tandis que les
troupes françaises assurent plutôt la défense contre les menaces
extérieures.
Le
petit embryon d'armée syrienne est alors partagé entre les
minorités : Druzes, Alaouites, Circassiens, Kurdes... les
Français favorisent les chrétiens qui obtiennent la plupart des
postes d'officiers. Ils encouragent les autres minorités à
rejoindre l'armée, contrairement aux sunnites, tenus volontairement
à l'écart pour mieux contrôler le pays. La France pense que les
minorités se sentiront ainsi dépendantes de Paris pour assurer leur
protection. Les sunnites, eux, voient l'armée comme un outil du
mandat : l'armée ne peut donc être qu'une alternative pour les
incompétents. Mais celle-ci offre des opportunités d'ascension
économique et sociale aux minorités. Au moment de la Seconde Guerre
mondiale, celles-ci sont surreprésentées dans les Troupes
Spéciales. Le 1er août 1945, ces unités deviennent l'ébauche des
armées nationales syrienne et libanaise.
La
première expérience du combat de la jeune armée syrienne va
s'avérer décevante, comme pour bon nombre d'armées arabes. La
toute récente armée indépendante contribue à la guerre contre
Israël en mai 1948. Mal équipés, mal entraînés, les 12 000
hommes de l'armée syrienne sont regroupés dans trois brigades
d'infanterie et l'équivalent d'un bataillon blindé. La force
aérienne compte environ 50 appareils dont 10 récents datant de la
Seconde Guerre mondiale. Les stocks de munitions sont insuffisants et
les intendants ne peuvent fournir que quelques dizaines de munitions
aux soldats qui partent combattre en Palestine.
![]() |
| Source : http://faculty-staff.ou.edu/L/Joshua.M.Landis-1/images/1948war_9.jpg |
Leur
performance est mitigée. Les soldats syriens combattent bien, en
particulier en défense, et l'aviation n'a pas démérité. Mais
seuls les officiers supérieurs comprennent véritablement la
nécessité de la combinaison des armes. Au niveau subalterne,
celle-ci reste très inégale. Les Syriens privilégient l'attaque
frontale et, dans l'offensive, l'emportent seulement avec la
supériorité numérique et/ou de puissance de feu. Cependant, la
participation des Syriens au premier conflit israëlo-arabe est plus
limitée que pour d'autres Etats comme l'Egypte.
Entre
1948 et 1967, la Syrie est secouée par de nombreux coups d'Etat.
L'armée, préoccupée par les problèmes de politique intérieure,
perd le professionnalisme hérité de la période coloniale et le
corps des officiers est amoindri. En mars 1949, le chef d'état-major
de l'armée, le général Husni az-Za'im, renverse le pouvoir civil et
s'installe comme président. Il n'est que le premier d'une longue
série. Les jeunes officiers voient bientôt l'armée comme un
tremplin pour leurs ambitions politiques. Ces coups d'Etat reflètent
aussi la séparation de l'armée sur des bases ethniques. Les trois
premiers coups d'Etat sont réalisés par des Kurdes. Mais,
parallèlement, de nombreux paysans sunnites rejoignent aussi les
forces armées. En 1952, 80% des candidats officiers sont des
sunnites. Les Alaouites, eux, dominent le corps des sous-officiers.
La
dimension politique se surimpose d'abord aux fractures ethniques,
compliquant le tableau, avant qu'elle ne s'aligne progressivement sur
les lignes de division. La Syrie est tellement affaiblie par les
conflits internes qu'elle accepte le projet de République Arabe Unie
de Nasser en 1958. Mais, en 1961, las de la mainmise égyptienne, un
coup d'Etat d'officiers sunnites chassent les Egyptiens et désavouent
le pacte. En 1963, un quintumvirat du Comité Militaire (une fraction
du parti Baas), prend le pouvoir, en ralliant des officiers
supérieurs bassistes ou nasséristes. La plupart sont alouites,
ismaëlites ou druzes, et ils utilisent le général Amin al-Hafiz,
un sunnite, comme paravent. Certains ont vu dans le coup d'Etat de
1963 l'émergence d'une nouvelle classe moyenne salariée, résultat
du processus de modernisation du pays. Ces officiers éliminent
bientôt ceux qui ont entraîné la rupture avec les Egyptiens,
remplaçant 700 hommes par des Alaouites. Les nouveaux dirigeants ne
tardent pas à se déchirer : les baassistes éliminent les
nasséristes, puis les sunnistes sont évincés. Enfin, les Alaouites
écartent leurs rivaux druzes et ismaëlites et en 1967, Salah Jadid
et Hafez al-Assad se retrouvent seuls au pouvoir.
Parallèlement,
à l'imitation de l'Egypte, la Syrie a entamé une relation suivie
avec l'URSS. Bien que le premier traité soit signé en 1956, les
premiers matériels n'arrivent qu'en 1958, bientôt suivis de
plusieurs centaines de conseillers militaires qui ont un rôle
important dans la formation de l'armée syrienne. Les Soviétiques
encouragent les Syriens à se concentrer sur l'entraînement et non
sur les querelles politiques. Au moment de la guerre des Six-Jours,
en 1967, les Syriens alignent 70 000 hommes, 550 chars ou canons
d'assaut (T-54/55, SU-100), 500 véhicules blindés (BTR
essentiellement), 300 pièces d'artillerie et 136 MiG dont 36 des
nouveaux MiG-21. Ils sont organisés en 16 brigades : 12
d'infanterie, 2 blindées et 2 mécanisées. Les Syriens n'ont pas,
par contre, développé de système de mobilisation ou de réserves
entraînées. 12 des 16 brigades sont déployées sur le Golan, dont
les deux blindées et une mécanisée. Un bataillon de char est
attaché à chacune des brigades d'infanterie qui s'y trouvent. Par
ailleurs, les Syriens ont fortifié, avec l'aide de leurs conseillers
soviétiques, le plateau. Mais, en réalité, le commandement est
décimé par les purges intestines et l'entraînement n'est pas
rigoureux : la maintenance des véhicules, en particulier,
laisse à désirer.
Malgré
l'avantage de la position et de la situation en défense, les Syriens
vont perdre le plateau du Golan en deux jours face à une armée
israëlienne qui contrôle les airs, et qui est dopée par sa
victoire en simultané contre l'Egypte. Le plan syrien d'une défense
en profondeur sur la route de Damas n'était pas mauvais en soi :
c'est l'exécution qui a pâti. Les officiers ne prennent pas
d'initiative, notamment pour les contre-attaques, et ils semblent que
des problèmes ethniques aient aussi provoqué un mépris des soldats
syriens par leurs officiers en fonction de leur confession. Mais
l'armée ne commence à se désintégrer vraiment que pendant la
retraite, pas avant. Les Syriens ont fait pâle figure, par exemple,
en comparaison de l'armée jordanienne beaucoup plus
professionnalisée.
![]() |
| Source : http://www.wwiivehicles.com/germany/tanks-medium/pzkpfw-iv-medium-tank/pzkpfw-iv-medium-tank-syrian-golan-1967-01.png |
Assad,
qui est issu de l'aviation syrienne, après être devenu ministre de
la Défense, installe ensuite des hommes à lui dans l'armée, qu'il
veut bâtir comme véritable force conventionnelle tournée vers les
opérations extérieures et non pour les luttes internes. La même
année, l'armée syrienne intervient en Jordanie pour soutenir les
Palestiniens chassés par le roi hachémite lors du fameux
« Septembre Noir ». Les Syriens envoient une
brigade blindée renforcée, sans véritablement avoir de plan
d'opération, puis la 5ème division d'infanterie renforcée à
partir du 20 septembre, avec deux brigades blindées : en tout
près de 300 chars T-55 et 16 000 hommes. Les Syriens lancent des
assauts frontaux, vague après vague, et refoulent les Jordaniens,
mais ceux-ci vont faire intervenir leur aviation qui brise la poussée
syrienne, et détruit de 40 à 60 chars ou véhicules blindés en
une seule journée. Les Syriens refluent laissant 600 hommes, 62
chars et 60 véhicules blindés (la plupart abandonnés par leurs
équipages) sur le terrain.
L'armée
sous Hafez el-Assad (1970-2000)
Assad,
après l'humiliation subie en Jordanie, s'empare finalement du
pouvoir en novembre 1970. Après une purge, son pouvoir est
rapidement consolidé. Néanmoins, il n'établit par une dictature
militaire mais plutôt une vaste coalition politique et
socio-économique dominée par les Alaouites.
C'est un régime personnel, familial, clientéliste, basé sur les
liens du sang et tribaux. Assad est obsédé par l'idée de venger la
défaite de 1967. Il va donc s'attacher à mettre de côté sa
paranoïa sécuritaire pour former une armée efficace,
conventionnelle, tout en obtenant l'aide des Soviétiques dont il se
méfie. Les missions de sécurité intérieure sont transférées à
la police, à la Garde Nationale et à une série d'unités créées
par le régime. En 1972, Assad limoge nombre d'officiers supérieurs
promus pour leur loyauté politique et cherche à les remplacer par
des hommes compétents sur le plan militaire. Mais l'effort reste
en-dessous de celui effectué par les Egyptiens, Assad craignant
toujours le pouvoir des militaires. Il refuse aussi d'engager les
commandos dans les opérations initiales de la nouvelle guerre
préparée contre Israël, car ces formations sont ses prétoriens,
et il ne veut pas qu'elles subissent de pertes trop élevées. A
partir de 1972, les conseillers soviétiques et le matériel affluent
en Syrie ; l'année suivante, il y a pas moins de 3 000
conseillers, jusqu'au niveau du bataillon ou du squadron.
![]() |
| Source : http://www.lesclesdumoyenorient.fr/IMG/jpg/Hafez_al-Assad_en_1970.jpg |
L'armée
a toujours été impliquée comme on l'a vu dans la destinée
politique du pays. La révolution de 1970 marque en quelque sorte un
apogée, avec l'armée soudée derrière Hafez el-Assad contre le
gouvernement, le parti Baas et l'administration publique de manière
générale. Mais en réalité, à partir de 1970, Assad maintient son
contrôle politique tout en reléguant l'armée, devenue
professionnelle, à des tâches conventionnelles. Cela est dû aussi
à la défaite face à Israël en 1967, la Syrie craignant -de
manière exagérée- pour sa survie. L'armée devient un instrument
de la politique étrangère syrienne, principalement tournée contre
Israël.
Le
plan syrien pour la guerre du Kippour est inspiré des schémas
soviétiques. L'armée syrienne doit briser les défenses
israëliennes sur le Golan en deux points, avec trois secteurs
d'attaque, et la réserve blindée exploitera la brèche pour sceller
le plateau et empêcher les renforts arrivant d'Israël d'intervenir.
Les Syriens souhaitent obtenir la surprise pour conserver
l'initiative face aux Israëliens. Il y a donc une certaine
flexibilité, mais le plan étant prévu dans ses moindres détails
et les officiers devant en principe y coller, il y a une
contradiction évidente. L'armée syrienne endort la méfiance des
Israëliens en multipliant les exercices de grande ampleur près du
Golan, tout en mettant en oeuvre un important programme de
renseignement sur les défenses adverses. Les Soviétiques sont
écartés de cette planification. A la veille de l'attaque, les
Syriens alignent 150 000 hommes, 1 650 chars (dont 450 T-62), 1 000
véhicules blindés et 1 250 pièces d'artillerie. Sur le Golan, le 6
octobre 1973, il y a 60 000 hommes, 1 400 chars, 800 à 900 véhicules
blindés, 600 pièces d'artillerie, 400 pièces antiaériennes et 65
batteries de SAM lourds (SA-2, SA-3 et SA-6). En tout, 5 divisions :
3 d'infanterie et 2 blindées. Les divisions d'infanterie, qui
comprennent une brigade mécanisée, sont renforcées par une brigade
blindée indépendante. Chaque division compte donc plus de 200
chars. Assad consent même finalement à céder 2 des 7 bataillons
de commandos à l'état-major de l'armée syrienne. L'armée de l'air
aligne plus de 350 appareils, dont 200 MiG-21, 30 Su-20 et 120
MiG-17. Néanmoins, les Syriens comptent plus sur leur DCA que sur
leur aviation. Pour la première fois, ils ont eu le temps de se
préparer ; leur armée est plus solide que jamais ; ils
combattent sur un terrain qu'ils ont choisi.
Les
Syriens se comportent bien pendant le conflit, et leur percée du 6-7
octobre au sud du Golan manquent de leur faire emporter la décision.
Ils ont obtenu la surprise stratégique. Le plan est correct, mais il
ne fait pas usage, cependant, d'opérations héliportées ou
aéroportées pour s'emparer de points stratégiques sur le Golan en
avant des troupes au sol. Pourtant, après le succès initial,
l'état-major syrien se montre inepte, choisissant de mauvais axes
d'attaques, hésitant à engager ses réserves, alors que les
commandants de divisions opèrent assez bien, même s'ils commettent
aussi des erreurs. Au niveau tactique en revanche, les Syriens sont
surclassés par les Israëliens, notamment en ce qui concerne
l'emploi des blindés. Les vagues de chars et de véhicules blindés
syriens viennent toujours cogner frontalement contre les Israëliens.
L'artillerie joue plus par sa masse que par sa précision, illustrant
aussi l'absence de combinaison des armes chez les Syriens, qui de la
même façon ne font que peu appel au génie ou à d'autres unités
spécialisées. Les officiers, au niveau subalterne, peinent à
prendre des initiatives ou à coopérer avec les unités voisines.
Les Syriens déforment aussi la doctrine soviétique en confinant,
par exemple, l'infanterie dans les véhicules blindés lors des
charges frontales. L'aviation israëlienne, sur le Golan, a plus un
effet psychologique que réel sur les Syriens, qui lui attribuent
tous leurs maux. Le prix à payer est élevé : 200 des 800
chars de l'attaque initiale, au moins, sont mis hors de combat en 24
heures. Les pertes sont si élevées qu'avec la mobilisation
israëlienne, l'équilibre numérique se renverse rapidement.
![]() |
| Source : http://4.bp.blogspot.com/_eQNPu6zzxaU/S-D3fK4Bo3I/AAAAAAAAtGM/IcdnzftMZz8/s640/93.jpg |
Il
faut un peu de temps à l'armée syrienne pour se remettre du choc du
Kippour. Les Syriens demandent un matériel plus moderne à l'URSS et
mettent l'accent sur les unités de commandos, qui selon eux sont les
plus aptes à conduire les opérations extérieures. En 1975, la
guerre civile éclate au Liban, qui conserve des liens très étroits
avec la Syrie. Celle-ci ne va pas tarder à intervenir dans le
conflit. Au départ, Assad choisit de soutenir les chrétiens
maronites contre les sunnites. Il envoie des éléments de l'Armée
de libération de la Palestine, une force de Palestiniens encadrée
par des Syriens pour lutter contre Israël. Mais au printemps de
1976, la situation des maronites est tellement mauvaise que l'armée
syrienne est employée à son tour à la tâche. La performance
syrienne ne s'améliore pas franchement par rapport à 1973. Les
unités syriennes sont mal adaptées pour lutter contre un adversaire
qui relève plus de la guérilla, et sont mal préparées au combat
en montagne. Les chars sont lancés en avant, le génie ne dégage
pas les routes, l'artillerie prépare les offensives mais ne peut
effectuer des tirs de précision, comme la contre-batterie, qu'à
grand peine.
L'armée
syrienne est néanmoins encore mobilisée en cas de problème
intérieur. Lors de la révolte des Frères Musulmans, entre 1976 et
1982, les soldats syriens n'hésitent pas, en février de cette
dernière année, à Hama, à utiliser l'artillerie, les blindés et
les hélicoptères pour écraser le soulèvement, faisant des
milliers de victimes. Hafez al-Asad doit déjouer, en 1983-1984,
après une attaque cardiaque, la tentative de son frère qui veut
utiliser les « compagnies de défense », unités
d'élite sous ses ordres, pour prendre le pouvoir. Assad a réussi à
se maintenir en faisant de l'armée un chien fidèle et obéissant.
Il a renforcé la présence des Alaouites dans l'armée, la plupart
des officiers supérieurs venant de sa propre tribu, la Kalabiyya. A
sa mort, 90% des officiers sont des alaouites. Il a établi des liens
de clientèle en récompensant les officiers par des prébendes
économiques et politiques. Il crée plusieurs appareils de sécurité
pour surveiller les officiers supérieurs : l'administration de
sécurité de l'armée de l'air, le département de la sécurité
militaire. Des unités spéciales sont constituées pour défendre le
régime, avec le meilleur équipement et le meilleur personnel. Les
compagnies de défense sont remplacées par une division de la Garde
Républicaine, commandée par un parent d'Assad. Ses deux fils
servent dans cette division. A la mort de son père, Bashar remplace
d'ailleurs le commandant par un officier alaouite qui lui est proche.
Assad fait aussi entrer les officiers supérieurs dans le parti Baas.
Il a tendance à laisser les officiers supérieurs en poste pendant
longtemps, ce qui nuit aussi, d'une certaine façon, à l'efficacité
de l'armée.
Après
avoir occupé l'est du Liban les Syriens cherchent alors à accroître
à nouveau le potentiel de leur armée. Le nombre de chars par
bataillon est augmenté et la Garde Républicaine est accrue d'une
division blindée supplémentaire, la 569ème. L'Egypte ayant trouvé
un compromis avec Israël, la Syrie devient le pivot de la présence
soviétique dans la région. En 1982, l'armée syrienne aligne 250
000 hommes, 3 600 chars, 2 700 véhicules blindés, 2 300 pièces
d'artillerie, 80 batteries de SAM lourds et plus de 500 appareils de
combat. Les Syriens convertissent progressivement les divisions
d'infanterie en division mécanisées ou blindées. La défense
anti-aérienne est plus mobile grâce à l'acquisition de nombreux
SA-6 ou SA-8. Les bataillons commandos passent de 7 à 33 par
prélèvement des meilleurs éléments de l'infanterie. La Syrie
compte utiliser ces troupes comme formations de choc dans les
offensives ou pour des missions non-conventionnelles. Assad purge
encore le commandement, en 1978, de 400 officiers opposés à
l'invasion du Liban. En 1982, la force d'occupation au Liban comprend
30 000 hommes, de 200 à 300 chars et des batteries de SAM dans la
vallée de la Bekaa. Les Israëliens ont cette fois-ci des matériels
beaucoup plus modernes dans l'aviation et les blindés, et ils
dominent les Syriens en termes de commandement, de renseignement et
de guerre électronique.
Pourtant
l'armée syrienne ne démérite pas durant la campagne. Les commandos
sont envoyés en avant soutenus par une réserve blindée, dans la
défense en profondeur chère aux Soviétiques. Certes, la force
aérienne syrienne est sévèrement corrigée par les Israëliens,
mais elle a empêchée l'aviation israëlienne de soutenir les
troupes au sol pendant deux jours, occupée qu'elle était à
détruire les MiG. En revanche, au niveau tactique, seuls les
commandos se montrent agressifs et imaginatifs. Les unités blindées
refusent la manoeuvre, l'artillerie compte toujours sur la masse, et
la reconnaissance est mauvaise. La logistique et la maintenance des
véhicules laissent sérieusement à désirer.
![]() |
| Source : http://www.acig.org/artman/uploads/astk_sa_at_team.jpg |
En
1990, la Syrie, qui a continué de participer à la guerre civile au
Liban, envoie dans la coalition anti-irakienne sa 9ème division
blindée et une brigade de commandos, tenues en réserve par les
Américains... La défense anti-aérienne est largement reconstruite
par les Soviétiques qui, embarrassés par les critiques syriennes sur
leur matériel, livrent des SA-5 mais aussi des Su-24, des MiG-29,
des T-72, des missiles sol-air portables et des missiles antichars
plus sophistiqués. La Syrie lève 7 divisions supplémentaires et
dispose alors de 400 000 hommes, 4 800 chars, 4 150 véhicules
blindés, 2 700 pièces d'artillerie, 530 appareils de combat et plus
de 250 batteries de SAM. La maintenance et l'entraînement
s'améliorent peu : au tournant des années 2000, un tiers des
chars n'est pas opérationnel. La Syrie renforce son potentiel
antiaérien au vu de ses échecs précédents contre Israël et les
défenses sur la route de Damas sont également améliorées. Une
division de forces spéciales (la 14ème) est créée ainsi que 7
brigades indépendantes de commandos. Pour compenser la supériorité
aérienne israëlienne, la Syrie acquiert des Scud-C auprès de la
Corée du Nord et travaille sur les Scud-D avec l'assistance
d'ingénieurs iraniens et coréens.
Sous
Bachar el-Assad
Le
10 juin 2000, Hafiz el-Assad, qui a dirigé la Syrie pendant 30 ans,
décède. Le lendemain, son fils cadet Bachar prend la succession,
devenant par la même occasion commandant des forces armées. Il
reçoit immédiatement le soutien du ministre de la Défense et du
chef d'état-major de l'armée syrienne. Promotion d'envergure pour
un homme qui était seulement capitaine à son retour en Syrie en
1994, après la mort de son frère. Bashar a reçu une formation
militaire attentive de la part de son père et, immédiatement après
sa prise de pouvoir, place de jeunes officiers alaouites qui lui sont
fidèle dans les rangs de l'armée. L'armée, et en particulier le
corps des officiers, reste donc une clé de la légitimité et du
pouvoir politique des dirigeants syriens.
![]() |
| Source : http://www.larousse.fr/encyclopedie/data/images/1300082-Bachar_al-Asad.jpg |
En
2003, une étude américaine fait le bilan des capacités de l'armée
syrienne.
Celle-ci aligne alors 319 000 hommes et 354 000 réservistes. La
gendarmerie paramilitaire en compte 8 000, et la milice pourrait
hypothétiquement rassembler 100 000 hommes de plus. L'armée de
terre, forte de 215 000 hommes, comprend 3 corps d'armée avec 7
divisions blindées, 3 mécanisées, 1 division de la Garde
Républicaine et 3 brigades de forces spéciales regroupées dans une
division nominale ; il y a en plus 4 brigades d'infanterie
indépendantes, une brigade de garde-frontières, deux brigades
d'artillerie indépendantes, un régiment de chars indépendant et 10
régiments de forces spéciales indépendantes.
La
Syrie dispose alors de brigades de missile surface-surface et d'une
brigade de défense côtière, avec quelques 850 engins. Sur les 4
700 chars, 1 200 sont en position statique. On compte 2 000 T-55, 1
000 T-62 et seulement 1 700 T-72 ou T-72M plus modernes. Il y a 725
BRDM-2, plus de 2 000 BMP-1 et 250 à 300 BMP-2 ou 3, sans parler des
1 600 BTR-50/60/70/152 plus anciens. Les hélicoptères sont au
nombre de 90 : 48 Mi-25 et 42 SA-342. L'artillerie autopropulsée
aligne 400 2S1 et 50 2S3, complétée par 1 600 à 1 700 pièces
tractées, en 122, 130 ou 152 mm. Il y a aussi 200 Type 63 chinois de
107 mm et 280 BM-21 Grad, sans parler de 700 mortiers moyens ou
lourds. Au niveau des armes antichars, la Syrie aligne 3 500 lanceurs
AT-3 dont 2 500 montés sur véhicules, 350 AT-4 ou 5 et 2 000 AT-10
ou 14 plus modernes. Elle dispose aussi de 200 Milans. La défense
antiaérienne aligne plus de 2 000 pièces dont 400 ZSU-23/4. Elle
compte 4 000 SA-7, 20 SA-9 et 35 SA-13 plus récents.
La
force aérienne comprend alors 611 avions et 40 000 hommes, plus les
hélicoptères déjà mentionnés. Il y a 10 à 11 escadrilles
d'avions d'assaut avec 20 Su-24 et 14 MiG-29SMT, le gros restant les
90 Su-22 et 44 MiG-23BN. La chasse comprend 16 escadrilles, dont la
moitié vole sur environ 170 MiG-21. 5 autres utilisent 90 MiG-23, le
reste se partageant entre 30 MiG-25 et 22 MiG-29. La reconnaissance
est assurée par 6 MiG-25R et 8 MiG-21H/J. La défense antiaérienne
compte parmi les branches les plus nombreuses de l'armée, avec deux
divisions, 25 brigades, et 150 batteries de SAM lourds. Il y a 600
lanceurs SA-2 et SA-3 et 200 SA-6. Les SA-5 sont au nombre de 48, les
SA-8 étant 60. La marine, au contraire, est le parent pauvre des
forces armées syriennes. Deux frégates lance-missiles Petya
III sont opérationnelles. Elle compte 18 patrouilleurs dont 10 Osa
I et II obsolètes armés de Styx. Il y a 5 bâtiments pour la
guerre des mines et 16 hélicoptères anti-sous-marins, ainsi que
trois navires de débarquement de classe Polnocny capables de
transporter 100 hommes.
L'armée
syrienne en 2011
Des
estimations de la force de la rébellion syrienne, au début de la
guerre civile, en 2011, ont laissé penser que le régime syrien
serait défait rapidement militairement parlant. Or, l'armée est
restée pour bonne partie fidèle au régime, elle dispose encore
d'un matériel conséquent et le niveau de pertes n'est pas
insurmontable.
![]()
L'armée
syrienne, en 2011, reste l'une des plus vastes et des mieux
entraînées du monde arabe. Organisée selon la doctrine soviétique,
elle est bâtie pour des opérations expéditionnaires au Liban et
pour protéger la Syrie d'une invasion israëlienne. La cohésion et
la capacité logistique de l'armée depuis le début de la guerre
civile montrent que sa réputation n'est pas usurpée. Elle compte
alors 220 000 hommes. Sur les 13 divisions de l'armée syrienne, 8
sont des formations blindées ou mécanisées de 4 brigades chacune.
Une division blindée comprend 3 brigades blindées et 1 brigade
mécanisée, et vice-versa pour la division mécanisée. Chaque
division possède son régiment d'artillerie et ses éléments de
soutien, soit 15 000 hommes en théorie. Les brigades comprennent de
2 500 à 3 500 hommes. C'est le niveau de manoeuvre essentiel de
l'armée syrienne. Chaque brigade blindée comprend 3 bataillons
blindés et 1 mécanisé. Les brigades ont aussi leur artillerie,
leur DCA ou leur génie organique. Les régiments d'artillerie de 1
500 hommes comprennent trois bataillons de 300 à 500 soldats.
Il
y a 5 divisions spécialisées dans l'armée : la 4ème division
blindée, la division de la Garde Républicaine, deux divisions de
forces spéciales et la 17ème division de réserve. Les régiments
de ces unités comprennent 1 500 hommes répartis en trois
bataillons. Ils n'ont pas d'unités de soutien. Les brigades et les
régiments syriens sont donc plus petits que leurs homologues
occidentaux mais plus gros que les bataillons. Les bataillons sont
aussi plus petits que dans les armées occidentales mais plus gros
que les compagnies. Durant la guerre civile toutefois, Bachar
el-Assad a surtout déployé les divisions d'élite entièrement
alaouites et des détachements sélectionnés dans les autres unités.
La
garde prétorienne du régime était composée, dans la première
décennie du règne d'Hafez el-Assad, des compagnies de défense, qui
ont représenté jusqu'à un tiers de l'armée de terre : 12
brigades d'élite de blindés, d'artillerie et de forces spéciales.
Ce sont elles qui ont écrasé l'insurrection des Frères Musulmans
entre 1976 et 1982. Les Alaouites représentent 90% des effectifs et
sont recrutés dans les tribus proches du pouvoir. Après la
tentative de coup d'Etat de son frère Rifat, Hafiz limite les
compagnies de défense à une division et transfère le reste dans la
Garde Républicaine ou les forces spéciales. La 569ème division
blindée, qui prend la suite des compagnies de défense, devient plus
tard la 4ème division blindée.
La
4ème division blindée a joué un rôle important dans la guerre
civile depuis 2011. Elle est bâtie sur le modèle de la division
blindée conventionnelle mais le régime a maintenu ses brigades à
plein effectif et l'a renforcée d'un régiment de forces spéciales.
Elle est théoriquement commandée par le général Durgham, mais
beaucoup suspectent que le frère de Bashar, Maher, qui commande la
42ème brigade blindée, contrôle en fait l'unité. Quasiment tous
les soldats de la division sont des professionnels et 80% des
officiers seraient alaouites. La division, de par son histoire, est
spécialisée dans le combat contre les insurrections intérieures :
cantonnée dans le complexe de Mazzeh qui surplombe le sud de Damas,
elle doit constituer le dernier rempart en cas d'invasion
israëlienne.
La
Garde Républicaine a été créée en 1976 par Hafez el-Assad. A
l'origine, les hommes viennent tous de l'aviation, branche où les
Assad ont officié avant de prendre le pouvoir. La Garde Républicaine
passe progressivement à l'équivalent d'une brigade mécanisée,
suite notamment à la réduction des compagnies de défense. En 2011,
elle compte 3 brigades mécanisées et 2 régiments « de
sécurité ». Cela représente l'équivalent d'une division
mécanisée, mais la Garde Républicaine est aussi maintenue à plein
effectif et bénéficie du meilleur matériel. Les commandants de
brigade sont des proches d'el-Assad, et les soldats et les officiers
sont quasiment tous alaouites. La division est orientée contre les
menaces intérieures et stationne autour du palais présidentiel et
dans le complexe de Quasioun, au nord de Damas, en bonne position
pour contrecarrer un coup d'Etat, comme la 4ème division blindée au
sud.
Les
régiments de forces spéciales ont un statut d'élite car ils
servent à la fois de force de protection au régime et de fer de
lance de l'armée. Ce sont en fait des unités conventionnelles
d'infanterie légère, mais les Syriens les ont baptisées forces
spéciales en raison de leur entraînement aux opérations
aéroportées et héliportées. Leur chef des années 1970 aux années
1990, le général Haydar, qui dirige le commandement des forces
spéciales, a joué un rôle important dans l'échec du soulèvement
des compagnies de défense, en 1983-1984. C'est pourquoi les forces
spéciales sont devenues un pilier du régime, aux côtés des deux
unités précédentes. Au milieu des années 1990, Haydar est éliminé
car il s'oppose à la succession d'Hafiz par Bachar. Hafiz divise le
commandement en deux divisions de forces spéciales, les 14ème et
15ème, avec trois régiments chacune. La première division sert
avec le 1er corps au sud et la deuxième avec le 2ème corps sur la
frontière libanaise. Il semblerait que seulement la moitié des
forces spéciales soit composée d'alaouites : le taux de
défection en 2011-2012 a d'ailleurs été plus important que dans la
4ème division blindée et la Garde Républicaine. Le commandement
des forces spéciales, avec au moins trois régiments, se trouve dans
les montagnes d'al-Dreij entre Damas et le Liban, derrière le palais
présidentiel. La 15ème division et ses trois régiments sont sur la
frontière jordanienne. Les forces spéciales opèrent notamment dans
l'Anti-Liban au sud-ouest de la Syrie.
L'armée
syrienne commence à former des corps d'armée au milieu des années
1980. Le 1er corps d'armée forme ainsi la première ligne de défense
contre une invasion. Les 61ème et 90ème brigades d'infanterie
indépendantes occupent des positions le long des hauteurs du Golan.
La seconde ligne de défense est composée, au sud, de la 5ème
division mécanisée, couverte à l'est par la 15ème division de
forces spéciales, près de la frontière jordanienne, tandis que la
7ème division mécanisée sécurise l'approche la plus directe au
nord entre le Golan et Damas, avec à l'ouest la hauteur du mont
Hermon. La 9ème division blindée, en arrière, sert de réserve.
![]()
Le
2ème corps d'armée a servi de force d'occupation au Liban. La 1ère
division blindée a joué un rôle clé dans l'échec de la tentative
de coup d'Etat de 1983-1984. La 10ème division mécanisée fait
également partie de ce corps, de même que la 14ème division de
forces spéciales. Avant la guerre civile de 2011, le 2ème corps
devait protéger la frontière libanaise et fournir une deuxième
ligne de défense contre une invasion israëlienne. La 1ère division
blindée, en particulier, couvrait l'approche sud de Damas, preuve
que le régime lui accorde une certaine confiance.
Le
3ème corps d'armée regroupe des unités dédiées à la sécurité
intérieure et destinées à servir de réserve en cas de conflit. La
11ème division blindée, stationnée près de Homs, protégeait le
centre du pays et la 3ème division blindée défendait l'accès nord
de Damas. Les 17ème et 18ème divisions, indépendantes,
protégeaient le nord et l'est de la Syrie. La 3ème division blindée
a notamment participé à l'écrasement de l'insurrection des Frères
Musulmans : elle a nettoyé Alep et a engagé sa 47ème brigade
blindée et sa 21ème brigade mécanisée contre Hama. Les
trois-quarts des officiers seraient alaouites, de même qu'un tiers
des soldats. Elle a également rallié les forces spéciales en
1983-1984 contre le coup d'Etat des compagnies de défense.
De
la contre-insurrection à la guerre civile
Le
conflit en Syrie s'est progressivement transformé à l'été 2012,
passant d'une insurrection à une véritable guerre civile.
Bachar el-Assad a cherché à réutiliser les recettes de son père,
mais la campagne de contre-insurrection a échoué. Cependant,
l'armée syrienne conserve la capacité de soutenir pendant longtemps
une guerre civile. Hafez el-Assad avait écrasé la révolte des
Frères Musulmans en employant des unités d'élite de l'armée, en
créant des milices pro-gouvernementales, les deux réunies ensemble
servant à déloger les rebelles des zones urbaines et à installer
dans celles-ci de fortes garnisons.
![]()
Bashar
el-Assad a échoué en voulant reprendre la même stratégie. Les
défections l'ont poussé à ne faire intervenir que le tiers le plus
loyal de l'armée, ce qui était insuffisant pour garder le contrôle
de tout le pays. Les défections et l'attrition ont affaibli l'armée,
dans un sens, mais l'ont aussi renforcée, car ceux qui restent sont
des inconditionnels du régime. Les milices pro-Assad, ou shabiha,
dirigées par des proches du clan au pouvoir, ont commis parmi les
pires exactions contre les rebelles. Les comités populaires locaux
ont également formé leurs propres milices, et particulièrement
dans les minorités. Les deux forces reçoivent le soutien du régime,
des Gardes de la révolution iraniens et du Hezbollah. Les
troupes de Bashar el-Assad ont procédé à des déplacements de
population forcés dans les bastions de l'opposition, renforçant les
clivages confessionnels. L'armée a utilisé l'artillerie,
l'aviation, les bulldozers, les massacres purs et simples, voire les
missiles balistiques pour chasser la population en dehors des zones
rebelles. La stratégie vise à priver ceux-ci du soutien des
habitants. Les forces conventionnelles loyalistes sont concentrées à
Homs et à Damas. Les petites forces maintenues à l'est et au nord
ont bloqué les rebelles, mais des postes isolés sont tombés alors
que le régime cherchait à maintenir ses lignes de communication
logistiques. L'armée reste indélogeable de Homs et de Damas. En
contrôlant le corridor qui va de Damas à Homs et jusqu'à la côte,
Bachar el-Assad est en mesure de tenir une guerre civile, soutenu par
l'Iran et le Hezbollah. Il détruira probablement Damas plutôt
que de la laisser à l'opposition.
En
janvier 2013, Bachar affirmait que son armée allait écraser les
rebelles. En réalité, ceux-ci ont porté le combat à Damas dès
juillet 2012 et ont commencé à investir les faubourgs nord. Mais ce
que Bachar voulait dire, c'est probablement qu'il avait compris que
la contre-insurrection avait échoué, que les objectifs avaient
changé : il s'agit maintenant de tenir le territoire « utile »
en Syrie, non de contrôler tout le pays. Au début de
l'insurrection, Bashar emploie donc les unités les plus fiables de
son armée. Dans les premiers mois, trois régiments des forces
spéciales partent à la reconquête de la province de Deraa. Les
41ème et 47ème régiments arrivent de la base d'el-Dreij et le
35ème régiment vient de la province d'as Suwayda. C'est Bashar
lui-même qui a sélectionné les unités : d'ailleurs une
brigade conventionnelle opère sous les ordres du 35ème régiment.
Deux brigades conventionnelles opèrent aussi à Deraa : la
132ème brigade mécanisée de la 5ème division mécanisée, pour
des raisons de proximité, et la 65ème brigade blindée de la 3ème
division blindée, basée à 150 km de là, probablement choisie
quant à elle pour des motifs politiques.
![]()
Bashar
met aussi sur la sellette les quatre services de sécurité pour
prévenir les défections. Ainsi, le général Manaf Tlass, qui
commande la brigade de la Garde Républicaine, est arrêté avant de
faire défection. Les régiments et les brigades de l'armée syrienne
opèrent dans des regroupements ad
hoc composées pour prévenir ces incidents. Par exemple, une
compagnie de la 4ème division blindée d'élite forme l'élément
dominant d'une force ad hoc de la taille d'un bataillon :
ce qui explique que cette unité soit souvent citée dans les médias.
La 1ère division blindée, pourtant une unité supposée fiable, a
vu ses trois brigades (91ème, 153ème, 58ème) opérer dans un rayon
de 10 km seulement autour de sa base au sud de Damas. Des éléments
de la division ont pourtant probablement été incorporés dans la
76ème brigade blindée qui a accompli une « chevauchée de
la mort » dans la province d'Idlib, à partir de février
2012, marquée par de nombreuses atrocités et laissant derrière
elle des graffitis évoquant une « brigade de la mort ».
Pour
reprendre le faubourg Zabadani à Damas, le régime forme un groupe
mixte d'éléments de la 4ème division blindée et des 3ème, 7ème
et 10ème divisions. Mais chaque division ne fournit qu'une
compagnie. Dans d'autres cas cependant, ce sont uniquement des
formations d'élite qui sont employées : le siège de Homs, en
février 2012, voit l'intervention de la 4ème division blindée, de
la Garde Républicaine et des forces spéciales. Quand les rebelles
sont délogés de Baba Amr à la fin du mois, c'est le 555ème
régiment de forces spéciales qui monte à l'assaut. Il y a au moins
deux bataillons de la Garde Républicaine tirés des 103ème et
105ème brigades. Au moins la moitié des forces spéciales, 6
régiments, sont également engagés sur place : les 3 de la
15ème division stationnée près de la frontière jordanienne et
ceux de la 14ème qui attaquent les bastions les plus solides de la
rébellion au sud-ouest de Homas, Baba Amr, Inshaat et Jobar. Deux
régiments indépendants de forces spéciales, les 53ème et 54ème,
sont également présents.
Le
cas de Homs est emblématique de la stratégie choisie par le régime.
Des unités d'élite sont engagées pour prévenir les défections.
Le bombardement initial est suivi d'un engagement massif qui permet
de reprendre la place forte des rebelles, d'y installer une forte
garnison et d'empêcher sa reconquête en 2012. L'armée loyaliste
utilise d'ailleurs plutôt l'artillerie en feu indirect depuis
l'échec d'une première attaque contre le faubourg de Zabadani, à
Damas. Début février 2012, les assiégeants creusent des tranchées
de deux mètres autour d'une partie de Homs, matraquent la ville,
puis la nettoient secteur par secteur, forçant les rebelles à
l'évacuer en mars. Mais il n'y avait pas plus de 15 (!) pièces
engagées contre Homs, soit une infime partie des 3 000 canons du
régime... En 2012, contrairement à 2011, les unités de l'armée
loyaliste occupent en force les zones qu'elles conquièrent. Les deux
brigades de la Garde Républicaine restent à Homs et le génie
construit une barrière de béton autour de Bab Amr, avec seulement
quelques passages gardés par les forces de sécurité. Résultat :
les accrochages avec les rebelles s'effilochent jusqu'en juillet,
remontent jusqu'en octobre puis s'effondrent à nouveau. Cependant,
la tactique utilisée à Homs, faute de troupes en nombre suffisant,
n'est pas applicable partout.
En
ce qui concerne les milices, Bashar se repose sur deux catégories
différentes. La première est celle des Shabiha, ces gangs mafieux
dirigés par des proches du clan au pouvoir. La seconde réside dans
les comités populaires formés en particulier par les minorités
pour se protéger des bandes rebelles. L'opposition ne fait pas la
différence entre les deux groupes et appelle ces milices du nom de
Shahiba. Le terme viendrait de la voiture emblématique des mafieux,
la Mercedes Shabah, ou Fantôme. Les Shabiha sont des milices
extrêmement décentralisées Il n'y a cependant pas que des
Alaouites puisque des organisations criminelles sunnites, comme à
Alep, soutiennent aussi le régime, soit pour l'argent, soit pour
éviter la prison. Les milices des comités populaires sont plus
nombreuses que les authentiques Shabiha.
Dans
le premier quart de l'année 2012, les troupes d'Assad nettoient tous
les centres urbains majeurs et restent pour contrôler le terrain,
même si la stratégie ne s'étend pas à tout le pays. Après les
nettoyages de Damas, Homs et Idlib, le régime stoppe la manoeuvre et
se concentre sur le maintien dans les capitales provinciales. Le
choix de déplacer la population dans les villes renforce
l'insurrection en durcissant les séparations confessionnelles. En
vidant Homs de ses habitants, l'armée syrienne a renforcé le nombre
de réfugiés à Damas et lancé la contestation dans la ville. Dans
le nord du pays, l'artillerie est utilisée pour matraquer les
villes, faute de troupes suffisantes pour procéder au râtissage de
tous les secteurs. Les rebelles sont pris au piège : ils ne
peuvent augmenter l'échelle du combat à Alep ou Idlib par crainte
de voir l'armée pulvériser les villes. Dans la zone côtière
alaouite, le régime a procédé dès 2011 à l'expulsion des
communautés sunnites. A l'automne 2012, des bulldozers sont employés
pour raser des faubourgs de Damas, les milices achevant le travail de
dépopulation en expulsant, voire en massacrant.
Fin
mai 2011, les miliciens abattent 108 personnes du village sunnite de
Taldou, dans la province de Homs, soutenus par l'artillerie de
l'armée régulière. Fin août 2012, après trois jours de
pilonnage, l'armée syrienne et les milices entrent dans le faubourg
sunnite de Daraya à Damas et tuent plus de 300 personnes. Le lieu
est un épicentre de la contestation et il est proche de la capitale
et de l'aéroport militaire Mazzeh, d'où cette réaction très
violente du régime. Quand les forces au sol ne sont pas disponibles
sur les fronts ouverts par les rebelles, comme au nord d'Alep ou de
Lattaquié au printemps 2012, ce sont les hélicoptères qui sont
employés pour chasser les populations. Les hélicoptères d'attaque
sont de plus en plus requis dans ce rôle en juin-juillet 2012. En
août, durant la bataille d'Alep, ce sont les avions qui remplacent
l'artillerie et bombardent des faubourgs derrière les positions
rebelles. L'aviation est d'ailleurs plus employée pour ces frappes
de terreur qu'en appui tactique, faute de précision ; c'est
aussi un moyen de retourner la population contre les rebelles.
L'aviation emploie même des barils d'essence modifiés au lieu des
projectiles traditionnels, et cible les boulangeries. Ce qui force
les rebelles à s'attaquer aux bases aériennes et à répliquer
contre les appareils : 15 auront été abattus à la fin 2012.
L'aviation syrienne connaît aussi des problèmes d'entretien et de
ravitaillement en carburant. D'où l'emploi à partir de décembre
2012 des premiers missiles balistiques, contre des positions
rebelles au nord du pays. Le 15 janvier 2013, un missile SCUD
probablement tiré au jugé frappe l'université d'Alep, tuant 80
personnes. Quelques jours plus tard, un autre s'écrase sur Daraya.
Jusqu'à la fin février 2013, ce sont pas moins de 40 missiles qui
ont été tirés.
La
domination aérienne explique aussi, pour partie, le maintien du
régime de Bashar el-Assad.
Née en 1948, la force aérienne syrienne a bénéficié ensuite du
fait que Hafez el-Assad lui-même était un ancien officier pilote.
Comme on l'a dit, dès avril 2012, l'aviation déploie ses
hélicoptères dans les provinces d'Idlip et Alep pour engager les
villages contrôlés par les rebelles. Le 12 juillet, les
hélicoptères de combat mitraillent la population du village de
Tremseh. Pour compenser le faible nombre de Mi-25 disponibles et
réserver ceux-ci aux secteurs stratégiques, l'aviation syrienne
engage ses jets dès le mois d'août 2012. En outre, la DCA rebelle
s'est améliorée et force à opérer à plus haute altitude. A
l'été, elle compte déjà de 15 à 25 ZSU-23, 2 à 5 canons tractés
de 57 mm, et de 15 à 30 SA-7, avec peut-être aussi des SA-16 et 24.
En octobre, ce sont déjà au moins 5 hélicoptères et 6 avions qui
ont été descendus. Les rebelles s'attaquent également aux bases
aériennes : Abu ad Duhur au sud d'Alep, Minakh au nord d'Alep
(où stationnent plus de 40 Mi-8, al-Qusayr près de Homs, etc. 4 des
destructions d'appareils interviennent d'ailleurs près des bases
aériennes. Les hélicoptères Mi-8 et Mi-17 commencent alors à
larguer des bombes artisanales, y compris sur les civils.
A
l'été 2012, l'armée de l'air syrienne aligne 200 appareils, 50
hélicoptères et 150 avions. Mais les problèmes de maintenance et
les défections limitent encore le total. Les appareils ne sont pas
vraiment conçus pour la contre-insurrection, d'où l'emploi de L-39
dans ce rôle. Fin novembre 2012, les premiers Su-17 et Su-22
apparaissent dans le ciel, preuve que le régime fait flèche de tout
bois pour soutenir le conflit. La défense anti-aérienne,
relativement puissante, se concentre sur le corridor
Damas-Homs-Alep : 650 sites statiques, 300 équipements mobiles,
dont des SA-11, 17 et 22. Un F-4E turc en fait probablement les frais
le 22 juin 2012, prouvant l'efficacité du système antiaérien
syrien. Fin octobre 2012, l'armée n'a pas hésité à détruire ses
propres lanceurs mobiles dans la province d'Idlib de peur qu'ils
soient capturés par les rebelles.
Après
avoir attaqué les bases aériennes, ceux-ci changent à leur tour de
tactique. Au lieu de s'en prendre aux villes ou aux villages, ils se
dispersent pour éviter les frappes aériennes et le mécontentement
de la population. Puis ils puisent dans les stocks des bases
aériennes pour renforcer leur DCA en canons et en MANPADS. Ils
mettent la main sur 40 lanceurs durant les offensives de l'automne
2012 et abattent pas moins de 2 hélicoptères et 1 chasseur au cours
de la première semaine de décembre 2012, dans la province d'Alep.
Ils continuent de maintenir la pression sur les bases aériennes. En
janvier 2013, ils prennent celle de Taftanaz, au nord de la Syrie,
assiégée depuis des mois, et mettent ainsi hors de combat 20
hélicoptères.
Depuis
le début du conflit, l'armée syrienne se maintient à 60 brigades
de manoeuvre.
Mais ces brigades n'ont pas été engagées en entier et seulement un
tiers environ de l'armée a participé aux opérations. La 4ème
division blindée et la Garde Républicaine ont opéré à plein
effectif. Les forces spéciales, qui ont connu des défections, sont
probablement aux deux tiers de leur capacité, soit 12 000 hommes –
contre 16 000 pour les formations précédentes. Les divisions
régulières ont souvent fourni une brigade, qui n'est pas restée
très éloignée de sa base d'opérations. Soit 27 000 hommes environ
sur les 9 divisions. Ce qui veut dire que le régime peut compter sur
un corps de bataille solide de 65 à 75 000 hommes. Les défecteurs
ont peut-être représenté 20 à 30% de l'effectif total de l'armée.
Les services de sécurité ont prévenu les défections et la 4ème
division blindée, par exemple, pourtant unité d'élite, a dû
fusiller 10 soldats qui menaçaient de le faire. Les éléments peu
sûrs sont emprisonnés ou maintenus dans les casernes. Les unités
d'élite fréquemment engagées sont surmenées, ce qui a aussi
conduit Assad à changer de stratégie. Les pertes commencent à
augmenter sérieusement à partir de la mi-2012. De 500 soldats tués
en novembre 2011, on passe à 2 300 morts en juin 2012. Les
statistiques ne sont plus communiquées par le régime en juillet. En
novembre, certains estiment les pertes à 7 000 morts et 30 000
blessés.
![]()
Pour
compenser ses pertes, le régime recrute dès l'automne 2012 dans les
cités alaouites, fait appel aux réservistes, encadrés par des
étrangers, Iraniens ou membres du Hezbollah. La
décentralisation des opérations et l'attrition de l'armée
entraînent une fusion de plus en plus grande entre celle-ci et les
milices. Les services de sécurité, qui compteraient selon certains
jusqu'à 200 000 hommes, n'ont pas attendu cette phase pour opérer
sur le terrain de la même manière que les milices. Selon les
rebelles, 10 000 miliciens sont venus renforcer les défenses de Homs
début 2013. Les Iraniens encadreraient l'Armée Populaire depuis août
2012. Bashar institutionnalise le processus début 2013 en regroupant
les milices dans les Forces de Défense Nationale. Les miliciens
pro-régime commencent à pratiquer des enlèvements.
Bashar
el-Assad a dû répartir ses maigres forces géographiquement
parlant. Depuis le début du conflit, il a privilégié Damas, Homs
et le Sud plutôt que le nord ou l'est du pays. On ne sait parfois
pas grand chose pour certains secteurs. La 11ème division blindée
est censée être active près d'Hama mais on y voit surtout opérer
une brigade de la 3ème division blindée et le 47ème régiment des
forces spéciales. Près de Tartous et de Lattaquié, l'armée
régulière n'est pas beaucoup présente, peut-être en raison de
l'importance de la communauté alaouite et chrétienne, et parce que
les organes de sécurité jugulent l'opposition. Les médias
reflètent d'ailleurs ces questions géographiques en constatant un
recul de l'armée au printemps 2012, là où il ne faut peut être
voir qu'une disparité de l'engagement.
C'est
dans l'est que les forces régulières sont les moins présentes. La
17ème division de réserve y a opéré en 2012. La 93ème brigade de
cette division est venu d'Idlib. Le 54ème régiment de forces
spéciales arrive au nord-est après avoir participé au siège de
Homs en février 2012. Dès l'été, le régime abandonne les régions
kurdes et la 17ème division est refoulée à la fin de l'année. Au
nord, dans les provinces d'Idlib et d'Alep, le régiment de forces
spéciales présent en 2011 est renforcé début 2012 par 3 autres
régiments, une brigade blindée, et un détachement de la 4ème
division blindée. La 76ème brigade blindée et le 41ème régiment
de forces spéciales arrivent dans la province d'Idlib fin février
2012. Deux autres régiments de forces spéciales, le 35ème de la
15ème division et le 556ème de la 14ème division, également
vétérans du siège de Homs, arrivent ensuite à Idlib. Début mars
2012, les éléments de la 4ème division blindée, de la 76ème
brigade blindée et du 35ème régiment de forces spéciales
nettoient la ville d'Idlib, chassant les rebelles dans les environs.
Mais le régime, faute de troupes, ne peut poursuivre et n'est pas en
mesure de répliquer à l'ouverture d'autres fronts au nord et à
l'ouest. Quand les forces du régime sortent d'Alep en juillet 2012
pour pousser au nord, les rebelles les reconduisent dans la ville dès
le mois d'août.
L'armée
syrienne établit des postes pour contrôler les lignes de
communication et disloquer les formations rebelles. Les troupes
restent en garnison, évitent les embuscades et les défections par
le contact avec la population. Mais les rebelles peuvent aussi
concentrer des unités allant jusqu'à la brigade contre des postes
isolés : pas moins de 17 sont tombés au nord jusqu'en mai
2012. En janvier 2013, l'armée n'a plus que 7 postes au nord des
capitales provinciales. Pour ravitailler ses unités, l'armée
syrienne emploie des Il-76 puis, devant la réaction de la DCA des
rebelles, ses hélicoptères.
![]()
La
garnison de Homs reste importante. Dans la province de Deraa, la
moitié des formations du 1er corps sont encore présentes. La 9ème
division blindée a envoyé sa 52ème brigade mécanisée combler les
trous de la 15ème division de forces spéciales. La 7ème division
mécanisée a envoyé des éléments renforcer les brigades
d'infanterie indépendantes sur le Golan. Il faut dire que le 1er
corps est moins fiable, les désertions y ont été nombreuses. Ce
n'est que lors de la bataille de Damas, à partir de juillet 2012,
que des unités renforcent la capitale.
A
Damas, la Garde Républicaine et la 4ème division blindée ont
affronté les rebelles dès le début de l'insurrection. Les
manifestations dans les faubourgs entre mars et mai 2011 ont été
dispersées par le 555ème régiment de forces spéciales, les
104ème, 105ème et 106ème brigades de la Garde Républicaine.
Malgré des opérations à l'extérieur, l'essentiel de la 4ème
division blindée et de la Garde Républicaine sont à Damas.
L'offensive rebelle de juillet 2012 a réussi à tenir sur la durée
malgré l'ampleur de la contre-attaque, l'emploi de l'artillerie et
des hélicoptères.
Plutôt
que de se replier dans un réduit côtier, il est fort probable que
Bachar el-Assad cherche à conserver Damas, Homs et Hamas. La
politique de terre brûlée à achever de faire basculer
l'insurrection dans la guerre civile, marquée par des affrontements
de plus en plus sectaires.
Bibliographie :
Lt
Col S. Edward BOXX, « Observations on the Air War in Syria »,
in Air & Space Power Journal, Mars-avril 2013, p.147-168.
Anthony
H. CORDESMAN, If Its Syria: Syrian Military Forces and
Capabilities, Center for Strategic and International Studies, 15
avril 2003.
Joseph
HOLLIDAY, The Syrian Army. Doctrinal Order of Battle, The
Institute for the Study of War, février 2013.
Joseph
HOLLIDAY, The Assad Regime. From Counterinsurgency to Civil War,
MIDDLE EAST SECURITY REPORT 8, Institute for the Study of War, mars
2013.
Kenneth
POLLACK, Arabs at War. Military Effectiveness, 1948-1991,
University of Nebraska Press, 2002.
Eyal
ZISSER, « The Syrian Army: Between the Domestic and the
External Fronts », in Middle East Review of International
Affairs Journal, Vol. 5, No. 1 (Mars 2001), p.1-12.