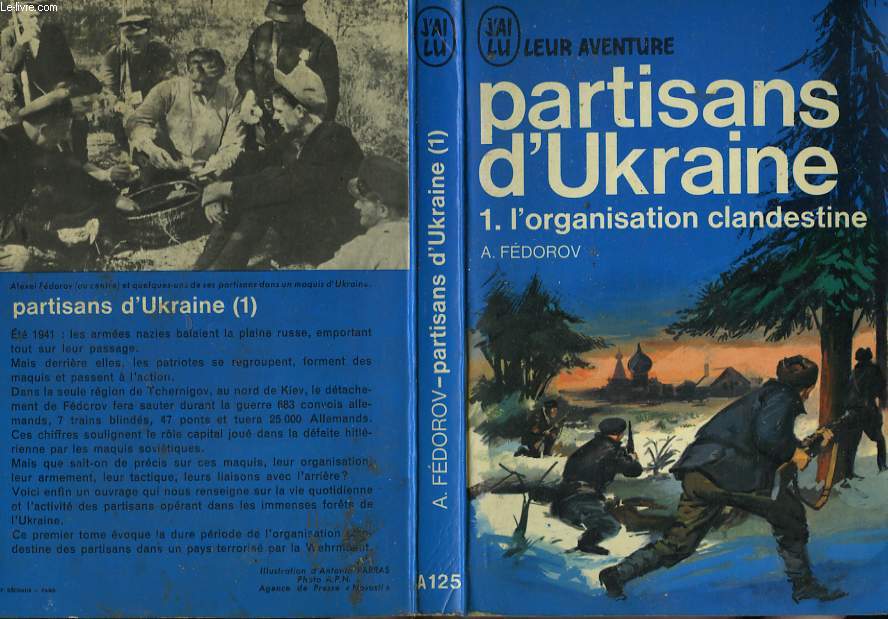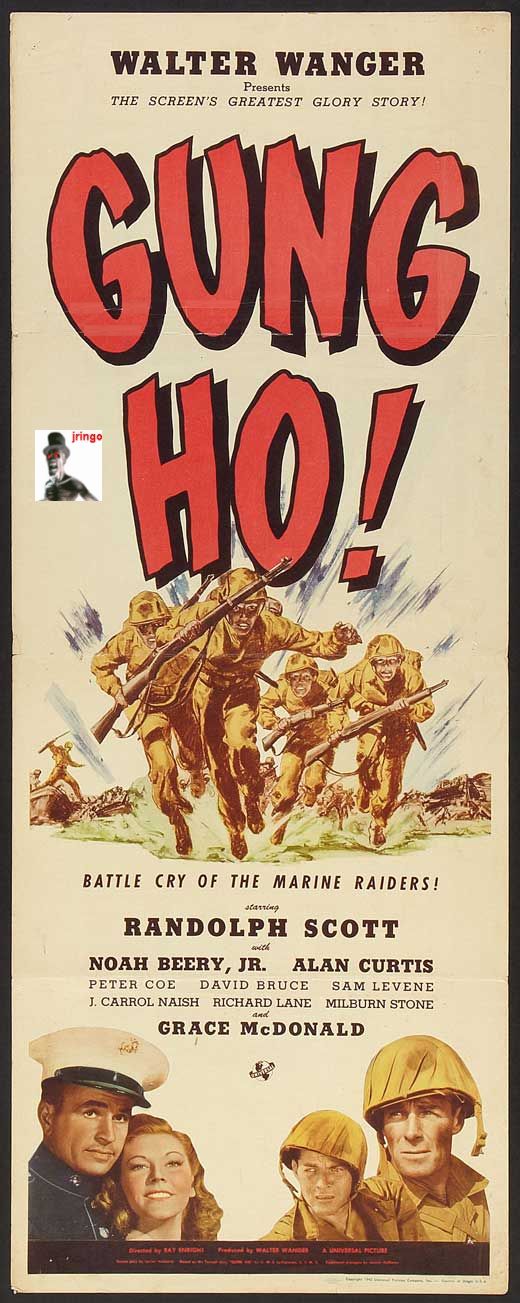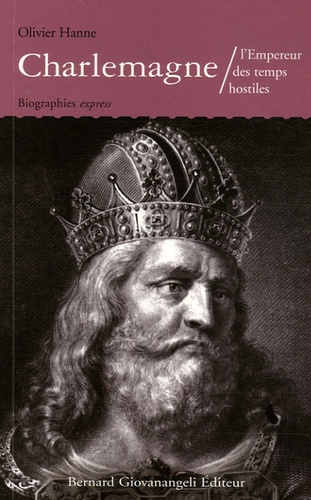Christian Ingrao, historien contemporanéiste, dirige depuis 2008 l'Institut d'Histoire du Temps Présent (IHTP). C'est un spécialiste de l'histoire culturelle du militantisme nazi et des pratiques de violence allemandes, notamment sur le front de l'est. En 2006, il publie cet ouvrage consacré à la Sondereinheit Dirlewanger.
Le travail de Christian Ingrao se situe dans la lignée des nouvelles monographies d'unités, telles celles de Smith ou de Browning. La brigade Dirlewanger a déjà fait l'objet de quelques travaux, notamment dans le monde anglo-saxon, mais d'aucun, alors, qui prennent en compte les nouveaux questionnements de l'historiographie : expérience individuelle et collective de la violence de guerre, culture de guerre, imaginaires cynégétiques et pastoraux, construction sociale des gestuelles de violence, c'est ce que se propose d'étudier ici l'historien à travers le choix de la brigade Dirlewanger. Il s'appuie notamment sur le travail de Bertrand Hell qui traite de l'imaginaire de la chasse. Le problème principal est celui des sources, qui ne couvrent pas toutes les opérations de l'unité et restent donc lacunaires. Il s'agit aussi de rebondir sur la thématique du consentement et de la contrainte qui a agité le monde des historiens français spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, et ce d'autant plus que l'unité a un profil bien particulier.
Christian Ingrao commence par retracer le parcours de l'unité. Créée en mai 1940 à partir de détenus condamnés pour braconnage, la Sondereinheit Dirlewanger est expédiée en septembre dans le district de Lublin, dans le gouvernement général de Pologne. Elle n'y accomplit alors que des tâches de surveillance et non, à proprement parler, une activité antipartisans. En février 1942, l'unité est expédiée en Biélorussie où elle prend part cette fois à la lutte contre les partisans, de plus en plus menaçants. Elle est présente dès la première opération de râtissage d'envergure, Bamberg, et devient un bataillon en septembre 1942. Sous couvert de lutte contre les partisans, les Dirlewangers entreprennent en fait des massacres de Juifs et parfois, aussi, de la population civile, pour faire le vide. En quinze mois d'opérations, l'unité abat au moins 30 000 personnes, invente une nouvelle technique de déminage en expédiant les civils russes dans les champs de mines supposés (!). Elle a d'ailleurs maille à partir avec la hiérarchie civile SS, mais Dirlewanger est couvert par certains responsables. A l'été 1943, l'unité, qui comprend des compagnies d'auxiliaires russes, intègre aussi des détenus de camps de concentration, qui forment des compagnies séparées des braconniers. Devenue régiment, elle subit des pertes plus lourdes en raison de l'efficacité grandissante des partisans et de l'inexpérience des nouvelles recrues. L'opération Cormoran est la dernière avant l'offensive soviétique, Bagration, le 22 juin 1944, qui jette la Dirlewanger dans la débâcle. Réfugiée en Pologne et passée au rang de Sturmbrigade, la Dirlewanger est engagée, à partir du 4 août, contre le soulèvement de l'Armée polonaise clandestine à Varsovie. Le combat urbain est coûteux : l'unité y laisse sans doute 2 000 hommes, mais en un peu plus de mois, elle participe probablement à l'exécution de 30 000 civils, autant que sur deux ans pendant les opérations en Biélorussie. Elle est ensuite engagée, fin octobre 1944, contre les derniers feux du soulèvement en Slovaquie. A ce moment-là, le recrutement repose moins sur les camps de concentration et les braconniers que sur les détenus pour motif disciplinaire de la SS et de la Wehrmacht. En novembre 1944 cependant arrive un premier contingent de détenus politiques des camps de concentration. Engagée en Hongrie, la Dirlewanger connaît ainsi ses premières défections à l'ennemi. Placée sur le Vistule, devenue 36ème division de grenadiers de la Waffen-SS en février 1945, la Dirlewanger est emportée dans la tourmente de l'offensive finale des Soviétiques le 16 avril, en Saxe, et laisse moins d'une cinquantaine de survivants.
L'historien s'intéresse ensuite au chef de l'unité lui-même, Dirlewanger, qui est loin du rebut criminel dont les Allemands se sont accomodés pendant la guerre froide. En réalité, il est le produit d'une époque, le reflet de mécanismes sociaux et culturels qui pèsent lourd dans le destin de l'Allemagne. Devenu soldat très tôt, Dirlewanger sert dans une compagnie de mitrailleuses. Blessé au début de la Grande Guerre, devenu instructeur, il finit en 1918 par rejoindre le front de l'est, sauve son unité de la capture. Vétéran, expert des nouvelles techniques de combat, Dirlewanger ne parvient pas à se réinsérer. Il combat dans les corps francs, dirige sa propre troupe à partir d'un train blindé dans le Wurtemberg. Devenu étudiant, il adhère aussi au NDSAP en 1923, puis en 1926, gravit les échelons de la SA à partir de 1932. Sa thèse prolonge son engagement politique et militaire. Il est condamné pour une affaire de moeurs en 1934 et emprisonné, mais il ne devient pas un véritable marginal dans l'Allemagne nazie. Il sert en Espagne dans la Légion Condor entre 1936 et 1939 avant de prendre la tête, en 1940, de l'unité spéciale qui portera son nom.
Dirlewanger est présenté par ses hommes, dans les interrogatoires réalisés après la guerre, comme un chef charismatique, courageux, proche de ses hommes, un lansquenet d'une autre époque. Mais ce postulat est surtout celui des braconniers, pas des détenus politiques. Dirlewanger a droit de vie ou de mort sur ses hommes -en tout cas il s'octroie cette prérogative- mais son comportement encourage les membres de l'unité à transgresser la discipline militaire : leur chef souhaite simplement la discrétion. Cette domination charismatique ambigüe s'étiole avec le gonflement de l'unité. Dès l'été 1943, la discipline est beaucoup plus brutale, et davantage encore à partir de l'été 1944, où le nombre d'exécutions enfle démesurément. Les désertions commencent dès l'été 1943 mais le cas le plus spectaculaire a lieu en Hongrie en décembre 1944, par les détenus politiques.
La formation de l'unité ne doit rien au hasard. Les nazis ont voulu utiliser le savoir-faire des braconniers dans la lutte anti-partisans, mais l'assimilation de la chasse à la lutte antiguérilla n'est pas une spécificité allemande et a été pensée et expérimentée dès le XVIIIème siècle. Himmler, Goering, von dem Bach-Zelewsky et Berger, deux des supérieurs de Dirlewanger, sont des chasseurs consommés. Il s'agit d'utiliser le braconnier, double noir du chasseur, et sa passion violente, dans des territoires à pacifier, à civiliser, donc à l'est. Mais cela n'est pas sans entraîner des conflits avec les autres autorités, dès la période du gouvernement général de Pologne. La Dirlewanger continue d'être mal vue en Biélorussie : sa réputation en fait une indésirable, alors qu'elle est appréciée dans la lutte contre les partisans. Sa pratique de l'incendie fait associer la Dirlewanger au feu. Les soldats allemands, après la guerre, mettent en exergue la cruauté et la violence de l'unité pour rejeter les massacres sur elle et se disculper, parfois. Or, ce sont les soldats "ordinaires" qui ont commis l'essentiel des exactions sur le front de l'est, la Dirlewanger étant de toute façon trop réduite en nombre pour pouvoir être accusée de tous les crimes. En faisant de l'unité une bande de marginaux, de criminels et de sauvages, l'Allemagne d'après-guerre déplace la culpabilité et refuse l'introspection.
La mission de la Dirlewanger peut-elle relever d'une guerre cynégétique ? Les reconnaissances s'assimilent à la Pirsch, les opérations de râtissage à la battue. La guerre contre les partisans rejoint le modèle de la chasse. Les cruautés sans cesse répétées des partisans visent à souligner le danger pour le chasseur, alors que les pertes sont plutôt réduites, en réalité. Cette situation correspond à la période en Biélorussie. Le butin est systématiquement décompté, les femmes sont elles exécutés ou soumises à des sévices sexuels avant d'être abattues plus tard. En revanche, les enfants sont eux aussi tués en nombre par la Dirlewanger, en particulier pendant les râtissages, ce qui constitue une déviance de la chasse. De chasseurs, les Dirlewangers deviennent d'ailleurs "pasteurs" en considérant l'ennemi comme du bétail, à déporter ou à éliminer, par exemple en le faisant sauter sur les mines. Chasse et massacre : les partisans sont tués par balles, les civils par le feu ou d'autres moyens. La grande guerre à l'est s'assimile donc bien à l'imaginaire cynégétique., en particulier en 1942, au moment où la menace des partisans devient croissante. De chasseurs, les Dirlewangers sont ensuite devenus tueurs d'abattoir.
Ces pratiques continuent lors de la répression du soulèvement de Varsovie, qui n'est pas très éloigné, en fait, des dernières opérations menées en Biélorussie contre un ennemi mieux armé. Il s'agit de détruire les fondements mêmes de la Pologne et le processus d'animalisation de l'adversaire, dans un contexte de défaite larvée, s'accentue. Le territoire de chasse urbain, à Varsovie, devient ainsi l'un des plus grands charniers du conflit. En Slovaquie, les massacre sont moindres mais les pratiques perdurent, notamment à travers le pillage. Noyée ensuite dans les affrontements titanesques en Hongrie et en Lusace, la Dirlewanger perd de sa spécificité et est anéantie. Malgré les désertions, certains résistent jusqu'au bout, les braconniers en particulier tentant de rejoindre l'ouest pour ne pas tomber entre les mains des Soviétiques.
C'est après la guerre qu'une légende naquit sur l'unité. Dirlewanger, qui n'était pas présent dans les derniers combats, est capturé en juin 1945, détenu en Souabe, et battu à mort par ses gardiens. Cependant, certains responsables nazis et vétérans de l'unité continuent à croire qu'il s'est enfui en Egypte ou dans un autre pays sûr. La RFA mène un certain nombre d'enquêtes sur la Dirlewanger, en lien avec l'URSS et les pays du bloc de l'est. Mais les survivants, habitués aux interrogatoires, adoptent une ligne de défense consistant à ne rien évoquer des massacres et autres tueries. Le principal dossier est refermé en 1995 sans que personne ait été condamné. La plupart des survivants sont devenus des marginaux et ne se sont jamais réinsérés. Ils furent aussi des marginaux de la mémoire, même si nombre de publications de vulgarisation commence à créer la légende de l'unité. Le roman de Willi Berthold montre la Dirlewanger comme un ramassis de marginaux, de criminels de droit commun, responsables des violences, même si le héros, antinazi, parvient à récupérer les meilleurs éléments. La Dirlewanger, célèbre par sa lutte antipartisans, ne fut pas mis en lumière par l'un de ces grands procès qui ont contribué à fixer la mémoire du nazisme.
L'histoire montre désormais combien Dirlewanger est le symbole d'une Allemagne refusant la guerre perdue de 1918. Il a associé la lutte antipartisans à la dimension cynégétique. Il a un parcours original au sein de l'ordre noir, mais non marginal. En réalité, la Dirlewanger est loin d'être responsable, par exemple, de tous les massacres commis en Biélorussie : de nombreuses autres unités ont été impliqués, même si l'Allemagne d'après-guerre a accusé de manière commode les braconniers d'être seuls responsables. L'étude de Christian Ingrao met en exergue le lien entre cette chasse ou cette domestication vue par les Dirlewangers et cette impulsion de l'Etat nazi pour exploiter les territoires conquis et les germaniser : le braconnier est indissociable de l'ingénieur.
Au niveau des limites de l'ouvrage, on peut signer l'absence d'une bibliographie récapitulative (il n'y a que les notes, nombreuses, en fin de volume) et quelques erreurs sur le vocabulaire militaire allemand. On peut aussi regretter que Christian Ingrao ne s'attache pas davantage à présenter l'ennemi partisan soviétique, pourtant fondamental dans son propos, de même qu'à la question de la supériorité de l'Armée Rouge sur l'armée allemande, en ce qui concerne les derniers mois de l'unité, et à celles des auxiliaires russes servant dans l'unité. Le lien entre l'imaginaire cynégétique, l'idéologie nazie et la guerre elle-même n'est pas abordé. Les conflits pour les stratégies de contrôle du territoire en Biélorussie, notamment, entre partisans et nazis, non plus.
C'est pourtant un essai brillant d'anthropologie historique, essentiellement à partir de sources en langue allemande. Ingrao montre que la contrainte ne suffit pas à expliquer la cohésion de l'unité, sauf dans les tout derniers mois de la guerre : le consentement tient à la personnalité du chef, à la mission qui leur a été assignée (braconniers contre un ennemi "animalisé"), à la mobilisation d'un imaginaire cynégétique.